Accueil > 03 - HISTORY - HISTOIRE > 4ème chapitre : Révolutions prolétariennes jusqu’à la deuxième guerre mondiale > Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?
Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?
mardi 27 décembre 2011, par ,
La révolution démarrée en Russie en 1917 est contradictoire, au sens dialectique, et à plus d’un titre. Elle est le produit de l’effondrement de la domination, sociale, politique et économique, des impérialismes européens au bout d’une guerre mondiale féroce et pourtant elle débute sur des bases nationales russes. Elle est portée, dès le début, par l’action de l’infime minorité ouvrière de Russie et pourtant elle est la révolution des paysans et des nationalités opprimées de l’immense empire. Les conseils que mettent en place les ouvriers dès février 1917 sont dominés par des partis bourgeois qui ne veulent pas du tout d’une révolution ouvrière ni d’une direction de la société par les soviets. Abattant le tsarisme et la féodalité, cette révolution de février est incapable de prendre des mesures révolutionnaires bourgeoises parce que les partis bourgeois eux-mêmes craignent trop la révolution pour réaliser leurs propres aspirations bourgeoises. C’est le prolétariat qui se trouve ainsi amené à réaliser les tâches bourgeoises de la révolution en Russie, mais, en même temps, il ne peut se contenter d’en rester là et prend ainsi la tête de la révolution prolétarienne communiste en Europe. Mais cette tâche historique nouvelle, il ne peut certainement pas la réaliser dans la seule Russie. Il faut que plusieurs pays avancés d’Europe triomphent de la bourgeoisie pour que cette révolution devienne réellement socialiste. Et, malheureusement, grâce à la trahison des directions réformistes de la classe ouvrière des pays impérialistes d’Europe qui vont voler au secours de la bourgeoisie, le prolétariat des pays les plus avancés, tout en prenant le chemin de la révolution, en constituant ses soviets, en s’affrontant à l’Etat bourgeois, est dans l’incapacité de prendre le pouvoir pour lui-même dans toute l’Europe. Les révolutions finlandaise, autrichienne, allemande, hongroise et italienne échouent. Du coup, les débuts de soulèvement du prolétariat en Angleterre et en France reculent. Le prolétariat est isolé en Russie. Il tient le pouvoir dans le seul espoir d’un renouveau de la révolution en Europe et dans le reste du monde. Mais les forces prolétariennes, isolées dans le monde, se heurtent à l’arriération du pays, à l’épuisement suite à une guerre civile féroce, à l’effondrement économique, au découragement social et politique qui lamine la génération révolutionnaire. L’échec de la révolution prolétarienne en Europe ne provient pas d’une incapacité du prolétariat des pays riches de faire la révolution, mais de la trahison de sa direction politique et, en dehors de Russie, de l’inexistence d’une direction de rechange préparée et instruite de ses tâches. Le principal résultat de cet échec sera la bureaucratisation de l’Etat ouvrier russe due à l’effondrement de la participation ouvrière dans les soviets d’un prolétariat écrasé sous la lourde tâche de battre tous les impérialisme coalisés, d’exercer toutes les tâches de direction d’un Etat à cet échelle et de tenir et de développer un pays arriéré et isolé. Il convient de redire que jamais au grand jamais les communistes russes n’avaient pensé construire le socialisme dans un seul pays, idée absurde et réactionnaire qui sera le drapeau politique des bureaucrates.
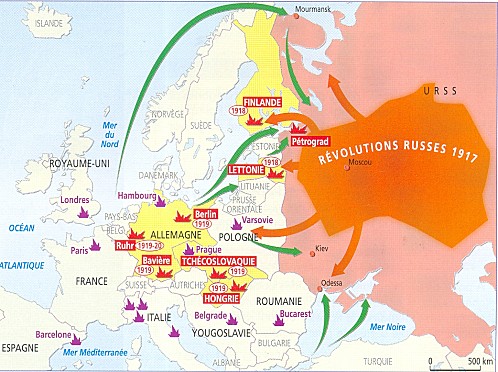
Voilà comment Lénine exprime cette dialectique dans "La troisième internationale et sa place dans l’Histoire" :
"Comment a-t-il pu se faire que le premier pays qui ait réalisé la dictature du prolétariat et fondé la République soviétique, ait été un des pays les plus arriérés de l’Europe ? Nous ne risquons guère de nous tromper, en disant que justement cette contradiction entre le retard de la Russie et le « bond » effectué par elle, pardessus la démocratie bourgeoise, vers la forme supérieure du démocratisme, vers la démocratie soviétique ou prolétarienne, justement cette contradiction a été (en plus des pratiques opportunistes et des préjugés philistins qui pesaient sur la plupart des chefs socialistes) une des raisons qui ont rendu particulièrement difficile ou retardé en Occident la compréhension du rôle des Soviets.
Les masses ouvrières de tous les pays ont saisi d’instinct l’importance des Soviets comme arme de lutte du prolétariat et ferme de l’Etat prolétarien. Mais les « chefs » corrompus par l’opportunisme ont continué, et continuent de vouer un culte à la démocratie bourgeoise en l’appelant « démocratie » en général.
Faut-il s’étonner que la réalisation de la dictature prolétarienne ait révélé avant tout cette « contradiction » entre le retard de la Russie et le « bond » effectué par elle par-dessus la démocratie bourgeoise ? Il eût été étonnant si l’histoire nous gratifiait d’une nouvelle forme de démocratie sans entraîner une série de contradictions.
Tout marxiste, voire toute personne initiée à la science moderne, en général, si on lui posait cette question : « Le passage égal ou harmonieux et proportionnel des divers pays capitalistes à la dictature du prolétariat est-il possible ? » — répondra sans doute par la négative. Ni égalité de développement, ni harmonie, ni proportionnalité n’ont jamais existé et ne pouvaient exister dans le monde capitaliste. Chaque pays a fait ressortir avec un singulier relief tel ou tel autre côté, tel trait ou ensemble de particularités du capitalisme et du mouvement ouvrier. Le processus de développement était inégal."
Pendant les mois de février à octobre 1917, les soviets, les comités, les coordinations, les meetings ont été une véritable université politique du prolétariat de Russie, sans laquelle rien n’aurait été possible ensuite.
La perspective de la révolution russe n’a pas été découverte en 1917 et n’est pas un produit du hasard. Lénine et Trotsky, chacun à sa manière, la défendaient depuis de longues années. Lorsqu’en 1916, le prolétariat irlandais participait à Dublin à la révolution nationale contre l’impérialisme anglais, ce premier soulèvement révolutionnaire en Europe en pleine guerre mondiale soulevait la critique de certains révolutionnaires qui condamnaient la politique du leader communiste James Connolly d’alliance des forces prolétariennes et des forces petites bourgeoises nationalistes (mais une alliance révolutionnaire dans laquelle le prolétariat conservait son indépendance politique, organisationnelle et même militaire). Lénine y répondait en juillet 1916 :
« Croire que la révolution socialiste soit concevable sans explosions révolutionnaire d’une partie de la petite bourgeoisie avec tous ses préjugés, sans mouvement des masses prolétariennes et semi-prolétariennes politiquement inconscientes, contre le joug seigneurial, clérical, monarchiste, national, etc…, c’est répudier la révolution sociale. C’est s’imaginer qu’une armée prendra position en un lieu donné et dira : « Nous sommes pour le socialisme » et qu’une autre, en un autre lieu, dira : « Nous sommes pour l’impérialisme », et que ce sera alors la révolution sociale ! C’est seulement en procédant de ce point de vue pédantesque et ridicule qu’on pouvait qualifier injurieusement de « putsch » l’insurrection irlandaise. Quiconque attend une révolution sociale « pure » ne vivra jamais assez longtemps pour la voir. (…) La Révolution russe de 1905 a été une révolution démocratique bourgeoise Elle a consisté en une série de batailles livrées par toutes les classes, groupes et éléments mécontents de la population. (…) Objectivement, le mouvement des masses ébranlait le tsarisme et frayait la voie à la démocratie, et c’est pourquoi les ouvriers conscients étaient à la tête. La révolution socialiste en Europe ne peut pas être autre chose que l’explosion de la lutte des opprimés et mécontents de toute espèce. Des éléments de la petite bourgeoisie et des ouvriers arriérés y participeront inévitablement – sans cette participation, la lutte de masse n’est pas possible, aucune révolution n’est possible – et, tout aussi inévitablement, ils apporteront au mouvement leurs préjugés, leurs fantaisies réactionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs. Mais, objectivement, ils s’attaqueront au capital. »
Léon Trotsky écrit :
"Le fait que le prolétariat soit arrivé au pouvoir pour la première fois dans un pays aussi arriéré que l’ancienne Russie tsariste n’apparaît mystérieux qu’à première vue ; en réalité, cela est tout à fait logique. On pouvait le prévoir et on l’a prévu. Plus encore : sur la perspective de ce fait, les révolutionnaires marxistes édifièrent leur stratégie longtemps avant les événements décisifs.
L’explication première est la plus générale : la Russie est un pays arriéré mais elle n’est seulement qu’une partie de l’économie mondiale, qu’un élément du système capitaliste mondial. En ce sens, Lénine a résolu l’énigme de la révolution russe par la formule lapidaire : « la chaîne s’est rompue à son maillon le plus faible ».
Une illustration nette : la grande guerre, issue des contradictions de l’impérialisme mondial, entraîna dans son tourbillon des pays qui se trouvaient à des étapes différentes de développement, mais elle posa les mêmes exigences à tous les participants. Il est clair que les charges de la guerre devaient être particulièrement insupportables pour les pays les plus arriérés. La Russie fut la première contrainte à céder le terrain. Mais pour se détacher de la guerre, le peuple russe devait abattre les classes dirigeantes. Ainsi, la chaîne de la guerre se rompit à son plus faible chaînon.
Mais la guerre n’est pas une catastrophe venue du dehors comme un tremblement de terre. C’est, pour parler avec le vieux Clausewitz, la continuation de la politique par d’autres moyens.
Pendant la guerre, les tendances principales du système impérialiste du temps de « paix » ne firent que s’extérioriser plus crûment. Plus hautes sont les forces productives générales, plus tendue la concurrence mondiale, plus aigus les antagonismes, plus effrénée la course aux armements, et d’autant plus pénible est la situation pour les participants les plus faibles. C’est précisément pourquoi les pays arriérés occupent les premières places dans la série des écroulements. La chaîne du capitalisme mondial a toujours tendance à se rompre au chaînon le plus faible.
Si, à la suite de quelques conditions extraordinaires ou extraordinairement défavorables (par exemple, une intervention militaire victorieuse de l’extérieur ou des fautes irréparables du gouvernement soviétique lui-même), le capitalisme russe était rétabli sur l’immense territoire soviétique, en même temps que lui serait aussi inévitablement rétablie son insuffisance historique, et lui même serait bientôt à nouveau la victime des mêmes contradictions qui le conduisirent en 1917 à l’explosion. Aucune recette tactique n’aurait pu donner la vie à la révolution d’Octobre si la Russie ne l’avait portée dans son corps. Le parti révolutionnaire ne peut finalement prétendre pour lui qu’au rôle d’accoucheur qui est obligé d’avoir recours à une opération césarienne.
On pourrait m’objecter : « vos considérations générales peuvent suffisamment expliquer pourquoi la vieille Russie – ce pays où le capitalisme arriéré reposant sur une paysannerie misérable était couronné par une noblesse parasitaire et une monarchie putréfiée – devait faire naufrage. Mais dans l’image de la chaîne et du plus faible maillon, il manque toujours encore la clé de l’énigme proprement dite : comment, dans un pays arriéré, la révolution socialiste pouvait-elle triompher ? Mais l’histoire connaît beaucoup d’exemples de décadence de pays et de cultures, avec l’écroulement simultané des vieilles classes, où il ne s’est trouvé aucune relève progressive. L’écroulement de la vieille Russie aurait dû à première vue transformer le pays en une colonie capitaliste plutôt qu’en un Etat socialiste. »
Cette objection est très intéressante. Elle nous mène directement au cœur de tout le problème. Et cependant cette objection est viciée, je dirais dépourvue de proportion interne. D’une part, elle provient d’une conception exagérée en ce qui concerne le retard de la Russie ; d’autre part d’une fausse conception théorique en ce qui concerne le phénomène du retard historique en général.
Les êtres vivants, entre autres, les hommes naturellement aussi, traversent suivant leur âge des stades de développement semblables. Chez un enfant normal de 5 ans, on trouve une certaine correspondance entre le poids, le tour de taille et les organes internes. Mais il en est déjà autrement avec la conscience humaine. A la différence de l’anatomie et de la physiologie, la psychologie, celle de l’individu comme celle de la collectivité, se distingue par l’extraordinaire capacité d’assimilation, la souplesse et l’élasticité : en cela même consiste aussi l’avantage aristocratique de l’homme sur sa parenté zoologique la plus proche de l’espèce des singes. La conscience, souple et susceptible d’assimiler, confère comme condition nécessaire du progrès historique aux « organismes » dits sociaux, à la différence des organismes réels, c’est-à-dire biologiques, une extraordinaire variabilité de la structure interne. Dans le développement des nations et des Etats, des Etats capitalistes en particulier, il n’y a ni similitude, ni uniformité. Différents degrés de culture, et même leurs pôles se rapprochent et se combinent assez souvent dans la vie d’un seul et même pays.
N’oublions pas, chers auditeurs, que le retard historique est une notion relative. S’il y a des pays arriérés et avancés, il y a aussi une action réciproque entre eux. Il y a la pression des pays avancés sur les retardataires. Il y a la nécessité pour les pays arriérés de rejoindre les pays progressistes, de leur emprunter la technique, la science, etc. Ainsi surgit un type combiné du développement : des traits de retard s’accouplent au dernier mot de la technique mondiale et de la pensée mondiale. Enfin, les pays historiquement arriérés, pour surmonter leur retard, sont parfois contraints de dépasser les autres.
Dans certaines conditions, la souplesse de la conscience collective donne la possibilité d’atteindre sur l’arène sociale le résultat que l’on appelle, dans la psychologie individuelle, la « compensation ». Dans ce sens, on peut dire que la révolution d’Octobre fut pour les peuples de Russie un moyen héroïque de surmonter leur propre infériorité économique et culturelle.
Mais passons sur ces généralisations historico-politiques, peut-être un peu trop abstraites, pour poser la même question sous une forme plus concrète, c’est-à-dire à travers les faits économiques vivants. Le retard de la Russie au XXe siècle s’exprime le plus clairement ainsi : l’industrie occupe dans le pays une place minime en comparaison du village, le prolétariat en comparaison de la paysannerie. Dans l’ensemble, cela signifie une basse productivité du travail national. Il suffit de dire qu’à la veille de la guerre, lorsque la Russie tsariste avait atteint le sommet de sa prospérité, le revenu national était 8 à 10 fois plus bas qu’aux Etats-Unis. Cela exprime numériquement « l’amplitude » du retard, si l’on peut en général se servir du mot amplitude en ce qui concerne le retard.
En même temps, la loi du développement combiné s’exprime dans le domaine économique à chaque pas dans les phénomènes simples comme dans les phénomènes complexes. Presque sans routes nationales, la Russie se vit obligée de construire des chemins de fer. Sans être passée par l’artisanat européen et la manufacture, la Russie passa directement aux entreprises mécaniques. Sauter les étapes intermédiaires, tel est le sort des pays arriérés.
Tandis que l’économie paysanne restait fréquemment au niveau du XVIIe siècle, l’industrie de la Russie, si ce n’est par sa capacité du moins par son type, se trouvait au niveau des pays avancés et dépassait ceux-ci sous maints rapports. Il suffit de dire que les entreprises géantes de plus de mille ouvriers occupaient aux Etats-Unis moins de 18% du total des ouvriers industriels, contre plus de 41% en Russie. Ce fait se laisse mal concilier avec la conception banale du retard économique de la Russie. Toutefois, il ne contredit pas le retard : il le complète dialectiquement.
La structure de classe du pays portait aussi le même caractère contradictoire. Le capital financier de l’Europe industrialisa l’économie russe à un rythme accéléré. La bourgeoisie industrielle acquit aussitôt un caractère de grand capitalisme, ennemi du peuple. De plus, les actionnaires étrangers vivaient hors du pays. Par contre, les ouvriers étaient bien entendu des Russes. Une bourgeoisie russe numériquement faible qui n’avait aucune racine nationale se trouvait de cette manière opposée à un prolétariat relativement fort, avec de puissantes et profondes racines dans le peuple.
Au caractère révolutionnaire du prolétariat contribua le fait que la Russie, précisément comme pays arriéré obligé de rejoindre les adversaires, n’était pas arrivée à élaborer un conservatisme social ou politique propre. Comme pays le plus conservateur de l’Europe, et même du monde entier, le plus ancien pays capitaliste, l’Angleterre, me donne raison. Le pays d’Europe le plus libéré du conservatisme pouvait bien être la Russie.
Le prolétariat russe, jeune, frais, résolu, ne constituait cependant toujours qu’une infime minorité de la nation. Les réserves de sa puissance révolutionnaire se trouvaient en dehors du prolétariat même : dans la paysannerie, vivant dans un semi-servage, et dans les nationalités opprimées.
La question agraire constituait la base de la révolution. L’ancien servage étatique-monarchique était doublement insupportable dans les conditions de la nouvelle exploitation capitaliste. La communauté agraire occupait environ 140 millions de déciatines. A trente milles gros propriétaires fonciers dont chacun possédait en moyenne plus de 2000 déciatines revenaient un total de 70 millions de déciatines, c’est-à-dire autant qu’à environ 10 millions de familles paysannes, ou 50 millions d’êtres formant la population agraire. Cette statistique de la terre constituait un programme achevé du soulèvement paysan.
Un noble, Boborkin, écrivit en 1917 au Chambellan Rodzianko, le président de la dernière Douma d’Etat : « Je suis un propriétaire foncier et il ne me vient pas à l’idée que je doive perdre ma terre, et encore pour un but incroyable, pour expérimenter l’enseignement socialiste ». Mais les révolutions ont précisément pour tâche d’accomplir ce qui ne pénètre pas dans les classes dominantes.
A l’automne 1917, presque tout le pays était atteint par le soulèvement paysan. Sur 621 districts de la vieille Russie, 482 – c’est-à-dire 77% – étaient touchés par le mouvement. Le reflet de l’incendie du village illuminait l’arène du soulèvement dans les villes.
Mais la guerre paysanne contre les propriétaires fonciers, allez-vous m’objecter, est un des éléments classiques de la révolution bourgeoise, et pas du tout de la révolution prolétarienne !
Je réponds : tout à fait juste, il en fut ainsi dans le passé ! Mais c’est précisément l’impuissance de vie de la société capitaliste dans un pays historiquement arriéré qui s’exprime en cela même que le soulèvement paysan ne pousse pas en avant les classes bourgeoises de la Russie, mais au contraire les rejette définitivement dans le camp de la réaction. Si la paysannerie ne voulait pas sombrer, il ne lui restait rien d’autre que l’alliance avec le prolétariat industriel. Cette jonction révolutionnaire des deux classes opprimées, Lénine la prévit génialement, et la prépara de longue main.
Si la question agraire avait été résolue courageusement par la bourgeoisie, alors, assurément le prolétariat russe n’aurait nullement pu arriver au pouvoir en 1917. Venue trop tard, tombée précocement en décrépitude, la bourgeoisie russe, cupide et lâche, n’osa cependant pas lever la main contre la propriété féodale. Ainsi, elle remit le pouvoir au prolétariat, et en même temps le droit de disposer du sort de la société bourgeoise.
Afin que l’Etat soviétique se réalise, l’action combinée de deux facteurs de nature historique différente était par conséquent nécessaire : la guerre paysanne, c’est-à-dire un mouvement qui est caractéristique de l’aurore du développement bourgeois, et le soulèvement prolétarien qui annonce le déclin du mouvement bourgeois. En cela même réside le caractère combiné de la Révolution russe.
Qu’il se dresse une fois sur ses pattes de derrière et l’ours paysan devient redoutable dans son emportement. Cependant, il n’est pas en état de donner à son indignation une expression consciente. Il a besoin d’un dirigeant. Pour la première fois dans l’histoire du monde, la paysannerie insurgée a trouvé dans la personne du prolétariat un dirigeant loyal.
4 millions d’ouvriers de l’industrie et des transports dirigeant 100 millions de paysans. Tel fut le rapport naturel et inévitable entre le prolétariat et la paysannerie dans la révolution.
La seconde réserve révolutionnaire du prolétariat était constituée par les nations opprimées, d’ailleurs également à composition paysanne prédominante. Le caractère extensif du développement de l’Etat, qui s’étend comme une tâche de graisse du centre moscovite jusqu’à la périphérie, est étroitement lié au retard historique du pays. A l’Est, il subordonne les populations encore plus arriérées pour mieux étouffer, en s’appuyant sur elles, les nationalités plus développées de l’Ouest. Aux 70 millions de Grands-Russes qui constituaient la masse principale de la population, s’adjoignaient successivement 90 millions d’« allogènes ».
Ainsi se composait l’empire dans la composition duquel la nation dominante ne constituait que 43% de la population, tandis que les autres 57% relevaient de nationalité, de culture et de régime différents. La pression nationale était en Russie incomparablement plus brutale que dans les Etats voisins, et à vrai dire non seulement de ceux qui étaient de l’autre côté de la frontière occidentale, mais aussi de la frontière orientale. Cela conférait au problème national une force explosive énorme.
La bourgeoisie libérale russe ne voulait, ni dans la question nationale, ni dans la question agraire, aller au-delà de certaines atténuations du régime d’oppression et de violence. Les gouvernements « démocratiques » de Milioukov et de Kérensky, qui reflétaient les intérêts de la bourgeoisie et de la bureaucratie grand-russe, se hâtèrent au cours des huit mois de leur existence précisément de le faire comprendre aux nations mécontentes : vous n’obtiendrez que ce que vous arracherez par la force.
Lénine avait très tôt pris en considération l’inévitabilité du développement centrifuge du mouvement national. Le Parti Bolchevik lutta opiniâtrement, pendant des années, pour le droit d’autodétermination des nations, c’est-à-dire pour le droit à la complète séparation étatique. Ce n’est que par cette courageuse position dans la question nationale que le prolétariat russe put gagner peu à peu la confiance des populations opprimées. Le mouvement de libération nationale, comme aussi le mouvement paysan, se tournèrent forcément contre la démocratie officielle, fortifièrent le prolétariat, et se jetèrent dans le lit de l’insurrection d’Octobre.
Ainsi se dévoile peu à peu devant nous l’énigme de l’insurrection prolétarienne dans un pays historiquement arriéré.
Longtemps avant les événements, les révolutionnaires marxistes ont prévu la marche de la révolution et le rôle historique du jeune prolétariat russe. Peut-être me permettra-t-on de donner ici un extrait de mon propre ouvrage sur l’année 1905, Bilan et Perspectives :
« Dans un pays économiquement plus arriéré, le prolétariat peut arriver plus tôt au pouvoir que dans un pays capitaliste progressif…
« La révolution russe crée… des conditions dans lesquelles le pouvoir peut passer (avec la victoire de la révolution, doit passer) au prolétariat même avant que la politique du libéralisme bourgeois ait eu la possibilité de déployer dans toute son ampleur son génie étatique.
« Le sort des intérêts révolutionnaires les plus élémentaires de la paysannerie… se noue au sort de la révolution, c’est-à-dire au sort du prolétariat. Le prolétariat arrivant au pouvoir apparaîtra à la paysannerie comme le libérateur de classe.
« Le prolétariat entre au gouvernement comme un représentant révolutionnaire de la nation, comme dirigeant reconnu du peuple en lutte contre l’absolutisme et la barbarie du servage…
« Le régime prolétarien devra dès le début se prononcer pour la solution de la question agraire à laquelle est liée la question du sort de puissantes masses populaires de la Russie. »
Je me suis permis d’apporter cette citation pour témoigner que la théorie de la révolution d’Octobre présentée aujourd’hui par moi n’est pas une improvisation rapide et ne fut pas construite après coup sous la pression des événements. Non, elle fut émise sous la forme d’un pronostic politique longtemps avant l’insurrection d’Octobre. Vous serez d’accord que la théorie n’a de valeur en général que dans la mesure où elle aide à prévoir le cours du développement et à l’influencer vers ses buts. En cela même consiste, pour parler de façon générale, l’importance inestimable du marxisme comme arme d’orientation sociale et historique. Je regrette que le cadre étroit de l’exposé ne me permette pas d’étendre la citation précédente d’une façon plus large, c’est pourquoi je me contente d’un court résumé de tout l’écrit de l’année 1905.
D’après ses tâches immédiates, la révolution russe est une révolution bourgeoise. Mais la bourgeoisie russe est anti-révolutionnaire. Par conséquent, la victoire de la révolution n’est possible que comme victoire du prolétariat. Or, le prolétariat victorieux ne s’arrêtera pas au programme de la démocratie bourgeoise ; il passera au programme du socialisme. La révolution russe deviendra la première étape de la révolution socialiste mondiale."
Lénine écrit :
"J’ai eu l’occasion de le répéter souvent : en comparaison des pays avancés, il était plus facile aux Russes de commencer la grande Révolution prolétarienne, mais il leur sera plus difficile de la continuer et de la mener jusqu’à la victoire définitive, dans le sens de l’organisation intégrale de la société socialiste.
Il nous a été plus facile de commencer, d’abord parce que le retard politique peu ordinaire — pour l’Europe du XXe siècle — de la monarchie tsariste provoqua un assaut révolutionnaire des masses, d’une rigueur inaccoutumée. En second lieu, le retard de la Russie unissait d’une façon originale la révolution prolétarienne contre la bourgeoisie, à la révolution paysanne contre les grands propriétaires fonciers... En troisième lieu, la révolution de 1905 a fait énormément pour l’éducation politique de la masse des ouvriers et des paysans ; tant pour initier leur avant-garde au "dernier mot" du socialisme d’Occident, que dans le sens de l’action révolutionnaire des masses.
Sans cette "répétition générale" de 1905, les révolutions de 1917, bourgeoise en février, prolétarienne en octobre, n’eussent pas été possibles. En quatrième lieu, la situation géographique de la Russie lui a permis plus longtemps qu’aux autres pays de tenir, en dépit de la supériorité extérieure des pays capitalistes avancés. (...)"
Lénine, La IIIe Internationale et sa place dans l’histoire, 15 avril 1919.
" Pour quiconque réfléchissait aux prémisses économiques d’une révolution socialiste en Europe, il était évident qu’il est bien plus difficile de commencer la révolution en Europe et bien plus facile de la commencer chez nous, mais qu’ici il sera plus difficile de la continuer..."
Extrait du Rapport de Lénine sur la guerre et la paix au VIIe Congrès du Parti, mars 1918.
Au bout de la vague révolutionnaire, en 1920, Lénine écrivait :
« Les succès obtenus par le pouvoir des Soviets sont colossaux. Lorsqu’il y a trois ans nous posions la question du rôle et des conditions de la victoire de la révolution prolétarienne en Russie, nous disions toujours nettement que cette victoire ne pouvait être solide qu’à condition d’être soutenue par une révolution prolétarienne en Occident, et que notre Révolution ne pouvait être justement appréciée que du point de vue international. Afin d’obtenir que notre victoire soit solide nous devons obtenir la victoire de la révolution prolétarienne dans tous les pays, ou du moins dans quelques-uns des principaux pays capitalistes. Après trois ans de lutte acharnée, nous voyons dans quelle mesure nos prédictions se sont vérifiées et dans quelle mesure elles ne se sont pas vérifiées.
Elles ne se sont pas vérifiées en ce sens que la question n’a pas reçu de solution rapide et simple. Bien sûr, aucun de nous ne s’attendait à voir durer trois ans une lutte aussi inégale que celle de la Russie contre toutes les puissances capitalistes du monde. Si nos prédictions ne se sont pas vérifiées purement et simplement, rapidement et directement, elles se sont vérifiées cependant dans la mesure où nous avons reçu l’essentiel, car l’essentiel était de conserver au pouvoir du prolétariat et à la république soviétiste la possibilité d’exister, même dans le cas où se ferait attendre la révolution socialiste dans le reste de l’univers. Et, à ce point de vue, il faut dire que notre situation internationale actuelle donne la meilleure et la plus exacte confirmation de tous nos calculs et de toute notre politique.
Inutile de prouver qu’aucune comparaison n’était à établir entre les forces militaires de la république soviétique RSFSR et celles de toutes les puissances capitalistes. Nous étions bien des dizaines et des centaines de fois plus faibles qu’elles : néanmoins, après trois ans de guerre, nous avons forcé presque tous ces États à renoncer à toute idée d’intervention. C’est-à-dire que ce qui, il y a trois ans, la guerre impérialiste n’étant pas encore finie, nous sembla possible, à savoir la prolongation durable d’une situation sans décision définitive de part ou d’autre, s’est produit. Mais pour quelle cause ? Ce n’est point que nous ayons été militairement plus forts et l’Entente plus faible. C’est seulement que pendant tout ce temps la dislocation intérieure n’a fait que croître dans les États de l’Entente, tandis que croissait chez nous l’affermissement intérieur, et la guerre sert de confirmation et de pleuve à cette vérité. L’Entente n’a pas pu nous combattre avec ses propres troupes. Les ouvriers et les paysans des pays capitalistes n’ont pas pu être forcés de marcher contre nous. De la guerre impérialiste, les États bourgeois ont réussi à sortir bourgeois. Ils ont réussi à remettre et à reculer la crise qui les menaçait immédiatement, mais ils ont ruiné leur situation dans sa racine à un tel point que, malgré leurs forces armées gigantesques, ils ont dû reconnaître, après trois ans, leur impuissance à étrangler la Russie soviétiste, presque dénuée de forces militaires. Ainsi s’est trouvée confirmée dans sa base notre politique avec nos prévisions, et nous avons eu pour alliés réels les masses opprimées de tous les États capitalistes, puisque ces masses ont fait échouer la guerre. Sans obtenir la victoire universelle, la seule solide pour nous, nous avons conquis une situation dans laquelle nous pouvons exister côte à côte avec les puissances impérialistes, obligées aujourd’hui d’entrer en relations commerciales avec nous. Au cours de cette lutte, nous avons conquis le droit à l’existence indépendante.
Ainsi, lorsque nous jetons un regard sur l’ensemble de notre situation internationale, nous voyons que nous, avons obtenu des succès énormes, nous avons non seulement un répit mais quelque chose de beaucoup plus sérieux. Un répit, c’était pour nous un court espace de temps pendant lequel les puissances impérialistes avaient maintes occasions de reprendre plus violemment encore la guerre. Aujourd’hui, nous ne nous permettons certes point de nier la possibilité d’une intervention militaire des États capitalistes. Nous devons absolument maintenir notre capacité de défense. Mais si nous considérons les conditions dans lesquelles nous avons brisé toutes les tentatives de la contre-révolution russe et obtenu la conclusion formelle de la paix avec tous les États de l’Ouest, il est clair que nous n’avons pas seulement un répit ; nous avons une période nouvelle où nous avons conquis notre droit à l’existence internationale parmi les États capitalistes. La situation intérieure des États capitalistes les plus puissants n’a permis à aucun d’eux de lancer contre la Russie son armée ; c’est la preuve qu’à l’intérieur de ces États la Révolution mûrit et ne leur permet plus de triompher de nous aussi vite qu’ils pourraient le faire. Pendant ces trois ans, le sol russe a vu des armées anglaises, françaises, japonaises. Pas de doute que le moindre effort de ces trois puissances aurait largement suffi pour nous vaincre en l’espace de quelques mois, sinon de quelques semaines. Si nous avons résisté à cette attaque, c’est grâce à la démobilisation des troupes françaises, et à la fermentation commençante des Anglais et des Japonais. »
Lénine
Extraits de « Notre situation extérieure et intérieure et les tâches du parti »
Conférence de la province de Moscou du Parti Communiste (bolchevik) de Russie
21 novembre 1920
Et Trotsky :
« C’est avec mélancolie et regret que la bourgeoisie du monde entier se rappelle les jours d’antan. Tous les fondements de la politique internationale ou intérieure sont bouleversés ou ébranlés. Pour le monde des exploiteurs demain est gros d’orages. La guerre impérialiste a achevé de détruire le vieux système des alliances et des assurances mutuelles sur lequel étaient basés l’équilibre international et la paix armée. Aucun équilibre nouveau ne résulte de la paix de Versailles.
La Russie d’abord, ensuite l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne ont été jetées hors de la lice. Ces puissances de premier ordre, qui avaient occupé la première place parmi les pirates de l’impérialisme mondial, sont devenues elles-mêmes les victimes du pillage et ont été livrées au démembrement. Devant l’impérialisme vainqueur de l’Entente s’est ouvert un champ illimité d’exploitation coloniale, commençant au Rhin, embrassant toute l’Europe centrale et orientale, pour finir à l’Océan Pacifique. Est-ce que le Congo, la Syrie, l’Egypte et le Mexique peuvent entrer en comparaison avec les steppes, les forêts et les montagnes de la Russie, avec les forces ouvrières, avec les ouvriers qualifiés de l’Allemagne ? Le nouveau programme colonial des vainqueurs était bien simple : renverser la république prolétarienne en Russie, faire main basse sur nos matières premières, accaparer la main-d’œuvre allemande, le charbon allemand, imposer à l’entrepreneur allemand le rôle de garde-chiourme et avoir à leur disposition les marchandises ainsi obtenues ainsi que les revenus des entreprises. Le projet « d’organiser l’Europe » qui avait été conçu par l’impérialisme allemand à l’époque de ses succès militaires, a été repris par l’Entente victorieuse. En traduisant à la barre des accusés les chenapans de l’empire allemand les gouvernements de l’Entente les considèrent bien comme leurs pairs.
Mais même dans le camp des vainqueurs il y a des vaincus.
Enivrée par son chauvinisme et par ses victoires, la bourgeoisie française se voit déjà maîtresse de l’Europe. En réalité jamais la France n’a été à tous les points de vue dans une dépendance plus servile vis-à-vis de ses rivales plus puissantes, l’Angleterre et l’Amérique. La France prescrit à la Belgique un programme économique et militaire, et transforme sa faible alliée en province vassale, mais, vis-à-vis de l’Angleterre, elle joue, en plus grand, le rôle de la Belgique. Pour le moment les impérialistes anglais laissent aux usuriers français le soin de se faire justice dans les limites continentales qui leur sont assignées, faisant ainsi retomber sur la France l’indignation des travailleurs de l’Europe et de l’Angleterre même. La puissance de la France, saignée à blanc et ruinée, n’est qu’apparente et factice ; un jour plus tôt ou plus tard les social-patriotes français seront bien obligés de s’en apercevoir. L’Italie a encore plus perdu de son poids dans les relations internationales. Manquant de charbon, manquant de pain, manquant de matières premières, absolument déséquilibrée par la guerre, la bourgeoisie italienne, en dépit de toute sa mauvaise volonté, n’est pas capable de réaliser dans la mesure où elle le voudrait, les droits qu’elle croit avoir au pillage et à la violence, même dans les coins de colonies que l’Angleterre a bien voulu lui abandonner.
Le Japon, en proie aux contradictions inhérentes au régime capitaliste dans une société demeurée féodale, est à la veille d’une crise révolutionnaire des plus profondes ; déjà, malgré des circonstances plutôt favorables dans la politique internationale, cette crise a paralysé son élan impérialiste.
Restent seulement deux véritables grandes puissances mondiales, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
L’impérialisme anglais s’est débarrassé de son rival asiatique, le tsarisme, et de la menaçante concurrence allemande. La puissance de la Grande-Bretagne sur les mers atteint son apogée. Elle entoure les continents d’une chaîne de peuples qui lui sont soumis. Elle a mis la main sur la Finlande, l’Estonie et la Lettonie ; elle enlève à la Suède et à la Norvège les derniers vestiges de leur indépendance ; elle transforme la mer Baltique en un golfe qui appartient aux eaux britanniques. Personne ne lui résiste dans la mer du Nord. Possédant le Cap, l’Egypte, l’Inde, la Perse, l’Afghanistan, elle fait de l’Océan Indien une mer intérieure entièrement soumise a son pouvoir. Etant maîtresse des océans, l’Angleterre contrôle les continents. Souveraine du monde, elle ne trouve des limites à sa puissance que dans la république américaine du dollar et dans la république russe des Soviets.
La guerre mondiale a définitivement obligé les Etats-Unis à renoncer à leur conservatisme continental. Elargissant son essor, le programme de son capitalisme national, - « l’Amérique aux Américains » (doctrine de Monroe) - a été remplacé par le programme de l’impérialisme : « Le monde entier aux Américains ». Ne se contentant plus d’exploiter la guerre par le commerce, par l’industrie et par les opérations de Bourse, cherchant d’autres sources de richesse que celles qu’elle tirait du sang européen, lorsqu’elle était neutre, l’Amérique est entrée dans la guerre, a joué un rôle décisif dans la défaite de l’Allemagne et s’est mêlée de résoudre toutes les questions de politique européenne et mondiale.
Sous le drapeau de la Société des Nations, les Etats-Unis ont tenté de faire passer de l’autre côté de l’océan l’expérience qu’ils avaient déjà faite chez eux d’une association fédérative de grands peuples appartenant à des races diverses ; ils ont voulu enchaîner à leur char triomphal les peuples de l’Europe et des autres parties du monde, en les assujettissant au gouvernement de Washington. La Ligue des Nations ne devait plus être en somme qu’une société jouissant d’un monopole mondial, sous la firme : « Yankee & Co ».
Le Président des Etats-Unis, le grand prophète des lieux communs, est descendu de son Sinaï pour conquérir l’Europe, apportant avec lui ses quatorze articles. Les boursiers, les ministres, les gens d’affaires de la bourgeoisie ne se sont pas trompés une seule minute sur le véritable sens de la nouvelle révélation. En revanche, les « socialistes » européens, travaillés par le ferment de Kautsky, ont été saisis d’une extase religieuse et se sont mis à danser, comme le roi David, en accompagnant l’arche sainte de Wilson.
Lorsqu’il a fallu résoudre des questions pratiques, l’apôtre américain a fort bien vu qu’en dépit de la hausse extraordinaire du dollar, la primauté appartenait encore et toujours à la Grande-Bretagne sur toutes les routes maritimes qui réunissent et qui séparent les nations ; car l’Angleterre dispose de la flotte la plus forte, du câble le plus long, et elle a une antique expérience de la piraterie mondiale. En outre, Wilson s’est heurté à la république soviétique et au communisme. Profondément blessé, le Messie américain a désavoué la Ligue des Nations dont l’Angleterre avait fait une de ses chancelleries diplomatiques, et il a tourné le dos à l’Europe.
Ce serait toutefois un enfantillage de penser qu’après avoir subi un premier échec de la part de l’Angleterre l’impérialisme américain rentrera dans sa coquille, nous voulons dire : se conformera de nouveau à la doctrine de Monroe. Non, continuant à asservir par des moyens de plus en plus violents le continent américain, transformant en colonies les pays de l’Amérique centrale et méridionale, les Etats-Unis, représentés par leurs deux partis dirigeants, les démocrates et les républicains, se préparent, pour faire pièce à la Ligue des Nations créée par l’Angleterre, à constituer leur propre Ligue, dans laquelle l’Amérique du Nord jouerait le rôle d’un centre mondial. Pour prendre les choses par le bon bout, ils ont l’intention de faire de leur flotte, dans le courant des trois ou cinq prochaines années, un instrument de lutte plus puissant que n’est la flotte britannique. C’est ce qui oblige l’Angleterre impérialiste à se poser la question : être ou ne pas être ?
A la rivalité furieuse de ces deux géants dans le domaine des constructions navales s’ajoute une lutte non moins furieuse pour la possession du pétrole.
La France qui comptait jouer un rôle d’arbitre entre l’Angleterre et les Etats-Unis s’est trouvée entraînée dans l’orbite de la Grande-Bretagne, comme un satellite de deuxième grandeur ; la Ligue des Nations est pour elle un fardeau intolérable et elle cherche à s’en défaire en fomentant un antagonisme entre l’Angleterre et l’Amérique du Nord.
Ainsi les forces les plus puissantes travaillent à préparer un nouveau duel mondial.
Le programme de l’émancipation des petits nations, qui avait été mis en avant pendant la guerre, a amené la débâcle complète et l’asservissement absolu des peuples des Balkans, vainqueurs et vaincus, et la balkanisation d’une partie considérable de l’Europe. Les intérêts impérialistes des vainqueurs les ont engagés à détacher des grandes puissances qu’ils avaient battues certains petits Etats représentants des nationalités distinctes. Ici il ne saurait être question de ce que l’on appelle le principe des nationalités : l’impérialisme consiste à briser les cadres nationaux, même ceux des grandes puissances. Les petits Etats bourgeois récemment créés ne sont que les sous-produits de l’impérialisme. En créant, pour y trouver un appui provisoire, toute une série de petites nations, ouvertement opprimées ou officiellement protégées, mais en réalité vassales - l’Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Yougoslavie, la Bohème, la Finlande, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l’Arménie, la Géorgie, etc. - en les dominant au moyen des banques, des chemins de fer, du monopole des charbons l’impérialisme les condamne à souffrir de difficultés économiques et nationales intolérables, de conflits interminables, de querelles sanglantes.
Quelle monstrueuse raillerie est dans l’histoire ce fait que la restauration de la Pologne, après avoir fait partie du programme de la démocratie révolutionnaire et des premières manifestations du prolétariat international, a été réalisée par l’impérialisme afin de faire obstacle à la Révolution ! La Pologne « démocratique », dont les précurseurs moururent sur les barricades de l’Europe entière, est en ce moment un instrument malpropre et sanglant entre les mains des brigands anglo-français qui attaquent la première république prolétarienne que le monde ait jamais vu.
A côté de la Pologne, la Tchécoslovaquie, « démocratique », vendue au capital français, fournit une garde blanche contre la Russie soviétique, contre la Hongrie soviétique.
La tentative héroïque faite par le prolétariat hongrois pour s’arracher au chaos politique et économique de l’Europe centrale et entrer dans la voie de la fédération soviétique, - qui est vraiment l’unique voie de salut - a été étouffée par la réaction capitaliste coalisée, au moment où, trompé par les partis qui le dirigent, le prolétariat des grandes puissances européennes s’est trouvé incapable de remplir son devoir envers la Hongrie socialiste et envers lui-même.
Le gouvernement soviétique de Budapest a été renversé avec l’aide de social-traîtres qui, après s’être maintenus au pouvoir pendant trois ans et demi, ont été jetés à terre par la canaille contre-révolutionnaire déchaînée, dont les crimes sanglants ont surpassé ceux de Koltchak, de Dénikine, de Wrangel et des autres agents de l’Entente... Mais, même abattue pour un temps, la Hongrie soviétique continue à éclairer, comme un phare splendide, les travailleurs de l’Europe centrale.
Le peuple turc ne veut pas se soumettre à la honteuse paix que lui imposent les tyrans de Londres. Pour faire exécuter les clauses du traité, l’Angleterre a armé et lancé la Grèce contre la Turquie. De cette manière la péninsule balkanique et l’Asie-Mineure, Turcs et Grecs, sont condamnés à une dévastation complète, à des massacres mutuels.
Dans la lutte de l’Entente contre la Turquie, l’Arménie a été inscrite au programme, de même que la Belgique dans la lutte contre l’Allemagne, de même que la Serbie dans la lutte contre l’Autriche-Hongrie. Après que l’Arménie a été constituée - sans frontières définies, sans possibilité d’existence - Wilson a refusé d’accepter le mandat arménien que lui proposait « la Ligue des Nations » : car le sol de l’Arménie ne renferme ni naphte, ni platine. L’Arménie « émancipée » est plus que jamais sans défense.
Presque chacun des Etats « nationaux » nouvellement créés a son irrédentisme, c’est-à-dire son abcès national latent.
En même temps la lutte nationale, dans les domaines possédés par les vainqueurs, a atteint sa plus haute tension. La bourgeoisie anglaise qui voudrait prendre sous sa tutelle les peuples des quatre parties du monde, est incapable de résoudre d’une manière satisfaisante la question irlandaise qui se pose dans son voisinage immédiat.
La question nationale dans les colonies est encore plus grosse de menaces. L’Egypte, l’Inde, la Perse sont secoués par les insurrections. Les prolétaires avancés de l’Europe et de l’Amérique transmettent aux travailleurs des colonies la devise de la fédération soviétique.
L’Europe officielle, gouvernementale, nationale, civilisée, bourgeoise, - telle qu’elle est sortie de la guerre et de la paix ce Versailles - suggère l’idée d’une maison de fous. Les petits Etats créés par des moyens artificiels, morcelés, étouffant au point de vue économique dans les bornes qui leur ont été prescrites, se prennent à la gorge et combattent pour s’arracher des ports, des provinces, des petites villes de rien du tout. Ils cherchent la protection des Etats plus forts, dont l’antagonisme s’accroît de jour en jour. L’Italie garde une attitude hostile à la France et serait disposée à soutenir contre elle l’Allemagne, si celle-ci se trouvait capable de relever la tête. La France est empoisonnée par l’envie qu’elle porte à l’Angleterre et, pour obtenir qu’on lui paie ses rentes, elle est prête à mettre de nouveau le feu aux quatre coins de l’Europe. L’Angleterre maintient avec l’aide de la France l’Europe dans un état de chaos et d’impuissance qui lui laisse les main libres pour effectuer ses opérations mondiales, dirigées contre l’Amérique. Les Etats-Unis laissent le Japon s’enliser dans la Sibérie orientale, pour assurer pendant ce temps à leur flotte la supériorité sur celle de la Grande-Bretagne avant 1925, à moins que l’Angleterre ne se décide à se mesurer avec eux avant cette date.
Pour compléter comme il convient ce tableau, l’oracle militaire de la bourgeoisie française, le maréchal Foch nous prévient que la guerre future aura pour point de départ le point où la guerre précédente s’est arrêtée : on verra d’abord apparaître les avions et les tanks, le fusil automatique et les mitrailleuses au lieu du fusil portatif, la grenade au lieu de la baïonnette.
Ouvriers et paysans de l’Europe, de l’Amérique, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Australie ! Vous avez sacrifié dix millions de vies, vingt millions de blessés et d’invalides. Maintenant vous savez du moins ce que vous avez obtenu à ce prix ! »
Trotsky
Juillet 1920
Manifeste du Congrès
Le monde capitaliste et l’Internationale Communiste
« Le mouvement révolutionnaire mondial
Les années d’après-guerre sont marquées par un essor inouï du mouvement révolutionnaire. En mars 1917, se produisit le renversement du tsarisme en Russie ; en mai 1917 se développe, en Angleterre, un mouvement gréviste ; en novembre de la même année, le prolétariat russe s’empare du pouvoir gouvernemental. Je ne dissimulerai pas que, à cette époque, la prise du pouvoir dans les autres pays d’Europe nous semblait bien plus proche qu’elle n’est en réalité. En novembre 1918 se produisit le renversement des monarchies allemande et austro-hongroise. Le mouvement gréviste embrasse une série de pays d’Occident. En mars 1919, la République Soviétiste est proclamée en Hongrie. Depuis la fin de 1919, les Etats-Unis sont bouleversés par les grèves orageuses des métallurgistes, des mineurs et des cheminots. La France atteint l’apogée de sa tension politique intérieure en mai 1920. En Italie se développe en septembre 1920, un mouvement du prolétariat pour prendre possession des usines. Le prolétariat tchèque, en décembre 1920, recourt à la grève générale politique. En mars 1921 se soulèvent les ouvriers de l’Allemagne centrale, et les mineurs anglais commencent leur grève gigantesque.
L’année écoulée a été également marquée par des défaites de la classe ouvrière. En août 1920 se termina malheureusement l’offensive de l’Armée Rouge sur Varsovie. En septembre 1920 demeura sans résultats le mouvement du prolétariat Italien. Si M. Turati déclare que ce mouvement a échoué parce que les ouvriers italiens n’étaient pas mûrs pour s’emparer de l’industrie et la diriger, nous sommes obligés de constater avec regret que le mouvement italien ne s’est pas encore débarrassé de M. Turati et des turatistes. De même se termina sans succès immédiat l’insurrection des ouvriers allemands en mars 1921.
La situation économique mondiale »
Léon Trotsky (13 juin 1921)
Discours au 3e Congrès de l’Internationale Communiste
Le premier affrontement sérieux, en dehors de la Russie eut lieu en Finlande. Partie constitutive de l’empire tsariste, le grand duché de Finlande connaissait une semi-indépendance. Il possédait depuis 1905 sa propre constitution, où le suffrage universel avait donné au parti social-démocrate, en 1916, la majorité absolue au Parlement local, sans que cela change quoi que ce soit, en dehors de la journée de 8 heures, à l’ordre social existant.
Au début de 1917, la bourgeoisie finlandaise se préparait, avec la complicité du gouvernement provisoire russe, à un coup de force destiné à briser le mouvement ouvrier. La victoire de la révolution prolétarienne à Petrograd, aux portes même du pays, posa le problème du pouvoir en termes encore plus aigus. Mais les dirigeants du mouvement ouvrier finlandais n’étaient pas prêts à se battre. L’un deux, Kuusinen, qui devint plus tard l’un des grands chefs de l’Internationale stalinienne, résuma ainsi, après coup, leur état d’esprit :
« Ne désirant pas risquer nos conquêtes démocratiques, et espérant d’ailleurs franchir, grâce à d’habiles manoeuvres parlementaires, ce tournant de l’Histoire, nous décidâmes d’éluder la révolution ... Nous ne croyions pas à la révolution ; nous ne fondions sur elle aucune espérance, nous n’y aspirions pas. »
La classe ouvrière était en armes, mais le parti social-démocrate se refusait à briser l’appareil d’État de la bourgeoisie. Ce fut finalement celle-ci qui prit l’initiative, et cela avec d’autant plus de facilité que le traité de Brest-Litovsk empêchait désormais la Russie soviétique de venir au secours du prolétariat finlandais.
La guerre civile fit rage de janvier à mai 1918.
Mais malgré l’héroïsme dont firent preuve les gardes rouges finlandais, les blancs, mieux armés, mieux entraînés, bénéficiant de l’appui de l’impérialisme allemand, l’emportèrent finalement. La répression fut sans pitié. Des dizaines de milliers de prolétaires payèrent de leur vie l’incapacité, ou les trahisons, de leurs dirigeants.
Pendant ce temps, de nouveaux craquements se faisaient entendre dans l’édifice vermoulu de l’empire allemand. En janvier 1918 de grandes grèves avaient secoué tout le pays ; mais ce fut à la fin octobre que commença vraiment la révolution allemande. De nouveau, le mouvement partit de Kiel. Le 30 octobre, la flotte mutinée arborait le drapeau rouge, immédiatement soutenue par la grève des ouvriers de la ville. Comme une traînée de poudre, le mouvement se répandit dans tout le pays. Le kaiser abdiquait. Le 9 novembre 1918, du haut d’un balcon du palais impérial, Karl Liebknecht sorti de prison proclamait la République allemande, et l’avènement du socialisme.
Mais les révolutionnaires allemands, regroupés dans la ligue Spartacus, ne constituaient qu’une faible minorité. La grande masse des travailleurs et des soldats étaient encore sous l’influence du parti social-démocrate, ou du parti centriste « indépendant » qui s’était formé, avec des hommes aussi compromis que Kautsky, en 1917. Les socialistes de contre-révolution eurent l’intelligence de ne pas prendre le mouvement de front. Ils se laissèrent au contraire porter par la vague révolutionnaire, pour mieux la dominer. Et tandis que partout se formaient des conseils d’ouvriers, et des conseils de soldats, un « Conseil des mandataires du peuple » assurait le gouvernement provisoire de la république. Le titre faisait sans doute très révolutionnaire, mais dès le premier jour de son existence, Ebert, qui présidait, prenait contact avec le haut état-major.
Le prolétariat allemand n’avait pas pris les armes, renversé le kaiser, pour que l’état-major règle ses destinées. Mais il alla au combat en ordre dispersé, et partout il fut finalement vaincu.
Début janvier 1919, ce fut le premier soulèvement des travailleurs berlinois, à l’issu duquel furent assassinés, parmi tant d’autres militants spartakistes, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Février vit les premières opérations des corps-francs contre-révolutionnaires, dirigées contre les conseils ouvriers de Brême et de Hambourg. En mars, le prolétariat berlinois se soulève de nouveau, et de nouveau son insurrection est noyée dans le sang. En avril, les corps-francs s’attaquent aux conseils de Magdebourg, du Brunswick, à la république des conseils de Bavière. En mai, enfin, tombent les derniers conseils ouvriers, ceux de la Saxe rouge. La contre-révolution avait triomphé en Allemagne.
Au printemps 1919, le drapeau rouge flottait également sur la Hongrie. Le 20 mars, Bela Kun avait proclamé la république des conseils ouvriers. La bourgeoisie hongroise, affolée, impuissante, s’était laissée déposséder du pouvoir sans combattre. Mais les révolutionnaires n’avaient pas rompu avec la social-démocratie, ni moralement, ni matériellement. Et lorsque le danger de la contre-révolution se précisa, sous la forme de l’intervention roumaine, la trahison de leurs alliés les laissa désarmés. Fin août, la république soviétique de Hongrie avait cessé de vivre.
Jusque-là, la vague révolutionnaire n’avait touché que des pays appartenant au camp des vaincus de la guerre. Et si l’Angleterre, la Franco et les USA avaient connu de vastes mouvements de grève, nulle part encore la bourgeoisie d’un des vainqueurs n’avait été sérieusement menacée par la révolution.
Cependant, il semblait bien, à l’été 1920, que l’heure de la révolution sonnait pour l’Italie.
Le 19 août, à la suite d’une décision patronale de rompre des négociations engagées sur les salaires, la Fédération de la métallurgie avait lancé un ordre de grève. A la tentative faite par certains patrons de faire occuper leurs usines par les carabiniers, la classe ouvrière riposta en occupant elle-même des centaines d’entreprises. Des conseils de fabrique étaient élus, qui souvent entreprenaient de reprendre la production pour leur propre compte. La vague de grèves gagnait les campagnes dans toute la plaine du Pô. La bourgeoisie italienne s’avérait impuissante de reprendre la situation en main par la force.
La classe ouvrière avait fait tout ce qu’il lui était spontanément possible de faire. Pour aller plus loin, pour briser l’appareil d’État de la bourgeoisie et construire le sien propre, il lui aurait fallu une direction décidée à aller jusqu’au bout. Mais le parti socialiste tergiversait, et alors que le problème de l’heure était celui de la prise du pouvoir, la CGT engageait des négociations avec le gouvernement... sur le principe du contrôle ouvrier sur les entreprises. Un accord fut signé sur cette base le 20 septembre, mais deux semaines s’écoulèrent encore avant que les ouvriers n’acceptent de reprendre le travail, après plus d’un mois et demi de grève.
Le plus formidable mouvement social qu’ait connu l’Italie aboutissait à un projet de loi qui ne serait d’ailleurs jamais déposé devant la chambre. Le prolétariat avait usé ses forces dans des luttes stériles, perdu confiance dans ses directions, et la petite-bourgeoise allait se tourner vers un autre sauveur. Deux ans plus tard, ce serait la marche sur Rome et le fascisme.
A la fin de l’année 1920, la révolution semblait partout refluer. En Allemagne, le putsch de Kapp et von Lüttwitz avait bien été brisé, en mars, par la grève générale, mais le jeune parti communiste avait été incapable de profiter de la situation, laissant toute l’initiative à la social-démocratie. Les détachements rouges organisés dans la Ruhr pour lutter contre Kapp furent finalement les principales victimes du rétablissement de l’ordre par les troupes du général Watter. C’était une nouvelle saignée pour les révolutionnaires allemands.
En Pologne, l’armée rouge qui avait voulu transformer la riposte à l’agression de Pilsudski en guerre révolutionnaire, après avoir atteint les portes de Varsovie, se trouvait contrainte de battre en retraite.
Cependant, en mars 1921, le Parti Communiste Allemand, à la suite de combats armés ayant éclaté entre ouvriers et forces de police dans la région de Mansfold, lançait immédiatement un appel à l’insurrection. Malgré quelques soulèvements locaux, l’ensemble du prolétariat ne bougea pas. L’ordre de grève générale lancé quelques jours plus tard en désespoir de cause ne fut guère plus suivi. L’action de mars, action volontariste déclenché par les révolutionnaires allemands pour essayer de sortir la révolution russe de son isolement se terminait par un désastre : le parti communiste interdit, un grand nombre de ses militants emprisonnés.
Grève en France en novembre 1918

La révolution spartakiste en Allemagne en 1918

Berlin aux mains des ouvriers en armes

CHRONOLOGIE
1918
8 janvier : Le dirigeant de l’impérialisme américain Wilson, qui a pris la tête des impérialismes français et anglais, proclame ses « 14 points » dont le "droit des peuples à disposer d’eux-mêmes", et la fondation de la société des nations pour contrer l’appel aux nationalités opprimées de la révolution russe dont la direction bolchevique de Lénine et Trotsky s’affirme publiquement comme le premier pas de la révolution communiste pour renverser mondialement l’impérialisme et la domination bourgeoise sur la société humaine.
Janvier 1918 : grèves en Autriche –Hongrie
28 au 31 janvier : grève ouvrière à Berlin et dans plusieurs villes ouvrières.
25 janvier-15 mai : Guerre civile finlandaise qui se termine par l’écrasement militaire des comités populaires et communistes par les troupes blanches.
Mars-mai : Grèves à Paris et Saint-Étienne.
Mars : formation des armées blanches contre la révolution russe.
25 octobre : Trois partis d’opposition, le parti radical, le parti social-démocrate et le parti d’indépendance du comte Károlyi forment en Hongrie le Conseil national.
30 octobre : Début de la Révolution allemande. La marine allemande se mutine à Kiel.
Révolution à Vienne et chute de la monarchie austro-hongroise.
Le Conseil national hongrois est porté au pouvoir par la « révolution des Asters ». Début du gouvernement de coalition du comte Mihály Károlyi en Hongrie.
31 octobre : Allemagne : Le Conseil des ministres se prononce pour l’abdication de Guillaume II d’Allemagne.
4 novembre : Fondation du parti communiste hongrois dirigé par le journaliste proche de Lénine, Béla Kun.
5 au 9 novembre : vague révolutionnaire en Allemagne portée par des conseils ouvriers et soldats.
7 novembre : Allemagne : Kurt Eisner prend la tête d’un conseil d’ouvriers et de soldats à Munich et tente de fonder une Confédération des États du Sud. Fuite du roi de Bavière.
9 novembre : Révolution à Berlin, abdication du Kaiser Guillaume II face à des insurrections qui enflamment le pays. Le social-démocrate Friedrich Ebert forme le nouveau gouvernement qui se prétend « conseil des commissaires du peuple » pour imiter le nom du gouvernement russe et cacher qu’il s’agit d’un gouvernement bourgeois contre-révolutionnaire. Fin de l’Empire allemand, proclamation de la république.
10 novembre : Allemagne - Formation d’un conseil suprême des conseils d’ouvriers et de soldats. L’empereur Guillaume II s’enfuit aux Pays-Bas.
12 novembre : Charles Ier d’Autriche renonce au pouvoir sans abdiquer. Proclamation de la république allemande d’Autriche. Le droit de vote est accordé aux femmes en Autriche.
12 novembre-14 novembre : Grève générale en Suisse, 250 000 ouvriers se mettent en grève, le Conseil fédéral répond par la force en envoyant l’armée.
14 novembre : En Pologne, Józef Piłsudski obtient les pleins pouvoirs du Conseil de régence et met en place la terreur blanche.
16 novembre :
Proclamation de la République démocratique hongroise, indépendante de l’Autriche-Hongrie. Le gouvernement Károlyi prend des mesures radicales pour démocratiser le pays et alléger la condition ouvrière et paysanne.
Suffrage universel en Roumanie.
18 novembre : Déclaration d’indépendance de la Lettonie. Les troupes bolchéviques s’emparent de Rīga et remplacent le gouvernement letton modéré par un régime prosoviétique. Guerre civile (1918-1920).
4 décembre : formation des corps francs allemands qui vont écraser la révolution ouvrière et les révolutionnaires.
23 et 24 décembre : combats armées entre ouvriers et armée allemande à Berlin.
26 décembre : Manifestations ouvrières à Bucarest. La police tire sur la foule, faisant plus de cent morts et de nombreux blessés.

Proclamation de la république hongroise des soviets
1919
1er janvier : Fondation du parti communiste d’Allemagne (KPD) ou Ligue Spartakus.
5 janvier :
• Création du Parti des travailleurs allemands, qui devient en 1920 le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP).
• Début de l’insurrection spartakiste menée par les dirigeants berlinois du parti social-démocrate indépendant, les délégués révolutionnaires et les spartakistes. L’insurrection est écrasée par le ministre social-démocrate de la Reichswehr Gustav Noske et par les corps francs. Une république soviétique est proclamée à Brême en janvier. Elle dure quatre semaines.
6 au 12 janvier, les corps francs organisés par le haut Etat-Major et la direction « socialiste » de l’Etat assassinent les conseils ouvriers à Berlin.
15 janvier : Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont assassinés par des membres de la garde montée.
21 janvier : Début de la guerre d’indépendance irlandaise. Affrontements en Irlande entre troupes britanniques et forces nationalistes (1919-1922).
31 janvier : Battle of George Square. Charge de la police à Glasgow lors d’une grève pour la réduction du temps de travail.
Crise sociale au Royaume-Uni : 146 millions de journées de travail perdues pour cause de grèves entre 1919 et 1921. La vague de grèves des mineurs, des cheminots, des dockers et des employés des transports pour des augmentations de salaires, influencée par la révolution russe, a été limitée, canalisée puis arrêtée grâce à la collaboration des dirigeants syndicalistes Hodges, Thomas et Bevin.
Février : Allemagne - grève dans la Rhur. Les corps francs font la tournée des villes allemandes et y assassinent les conseils ouvriers.
21 février : Assassinat du dirigeant social-démocrate des Conseils de Bavière, Kurt Eisner, à Munich.
2 mars : L’extrême gauche est, de nouveau, maîtresse de Munich. Des grèves ont éclaté à Madrid, Barcelone et Valence.
3 mars : À l’appel du Parti communiste allemand, les conseils ouvriers de Berlin déclenchent une grève générale. Le ministre de la Reichswehr proclame l’état de siège suivi le lendemain par des affrontements entre les manifestants et l’armée. Le plus grand trouble continue à régner à Munich. La République des Conseils a été proclamée à Brunswick L’état de siège a été proclamé à Madrid.
4 mars : Le gouvernement allemand, qu’effraie de plus en plus la tournure prise par les événements, vient de lancer une proclamation pour dénoncer le péril d’anarchie. La grève générale semble imminente à Berlin. Trente-quatre villes de l’Allemagne centrale sont déjà en grève. Les troupes gouvernementales sont rentrées dans Halle.
Le gouvernement espagnol met à l’étude un vaste programme de réformes sociales pour faire face à la montée ouvrière révolutionnaire.
5 mars : La grève générale menace en Espagne.
7 mars : Les batailles de rues continuent à Berlin où les tanks circulent pour abattre les barricades. Le nombre des grévistes augmente dans la capitale.
9 mars : Les combats de rue, se poursuivent à Berlin. Le gouvernement d’Ebert se dit maître du centre de la ville, mais les spartaciens résistent dans les faubourgs.
10 mars : Allemagne - La grève de Berlin est terminée. On compte qu’au cours des récentes batailles de rues, dans la capitale allemande, il y a eu 1.000 morts et blessés. Les indépendants essaient de se rapprocher des spartaciens. Le travail a repris dans les mines de l’Allemagne centrale.
11 mars : Allemagne - Les combats, qui ont continué à Berlin, ont été très sanglants. On parle de 1.000 à 1200 morts et blessés. Des tanks et des avions ont participé à la lutte.
12 mars : Allemagne - Les combats n’ont pas encore cessé dans les faubourgs de Berlin. Ebert est rentré dans la capitale. Le siège du Grand Conseil ouvrier de Berlin est occupé par la troupe. La répression fait près de 1 200 victimes.
15 mars : La bataille de rues n’est pas finie à Berlin où les insurgés garderaient encore un faubourg. Noske, ministre de la Guerre, a prononcé un discours pour flétrir les spartaciens. De nouvelles grèves sont en perspective outre-Rhin. L’état de siège a été proclamé dans plusieurs villes de l’Allemagne centrale.
16 mars : L’ordre à Berlin reste précaire. Les fusillades d’insurgés y continuent. Un mouvement se manifeste dans la région de Cologne, en faveur de la création d’une république occidentale allemande.
17 mars : Les combats diminuent à Berlin.
Mars : fondation de l’internationale communiste ou troisième internationale.
22 mars : les dirigeants syndicaux anglais décommandent la grève générale…
23 mars : Fondation à Milan, des Faisceaux italiens de combat (Fasci Italiani di Combattimento), par des Arditi, des interventionnistes de gauche, des nationalistes et des futuristes, dont Benito Mussolini. Ces groupes paramilitaires formeront l’embryon du parti fasciste.
25 mars : France - Création des conventions collectives.
Un gouvernement communiste s’est constitué à Budapest - les fractions socialistes ayant opéré leur fusion. Il a lancé une proclamation pour dire qu’il réalisera le socialisme. Il a télégraphié un message à Lénine pour lui demander une alliance et Lénine l’a félicité.
26 mars Le gouvernement révolutionnaire de Budapest a édicté un certain nombre de mesures. Il annonce en particulier la séparation de l’Eglise et de l’Etat et la formation d’une armée rouge. D’après les nouvelles informations qu’on reçoit, le passage de l’état ancien à l’état nouveau ne s’est pas opéré sans effusion de sang.
La grève générale a éclaté à Barcelone.
28 mars : L’état de siège a été proclamé en Bohême.
29 mars : La tentative contre-révolutionnaire se prépare en Hongrie. Grève des chemins de fer à Vienne (jusqu’au 31 mars). Grèves minières du pays de Galles
3 avril : Allemagne - Des troubles sanglants ont éclaté à Francfort-sur-Mein où quatre cents arrestations ont eu lieu. Il y a des morts et des blessés. La grève générale recommence dans le bassin houiller de Westphalie. Les extrémistes ont obtenu la majorité aux C. O. S. de Brunswick
4 avril : De nouveaux troubles ont éclaté en Allemagne. Il y a grève générale à Stuttgart, où l’état de siège a été proclamé. La situation est grave dans le bassin de la Ruhr. Des troubles sanglants ont eu lieu à Francfort.
5 avril : Allemagne - Grève générale des mineurs dans le bassin de la Ruhr..
7 avril : Tentative de révolution communiste en Bavière. Proclamation de la première république des conseils soviétiques de Bavière.
13 avril : deuxième république des conseils de Bavière.
Avril : mutineries de la flotte française de la mer Noire qui intervenait contre la révolution russe.
15 avril : Des batailles de rues ont eu lieu à Dusseldorf et à Brunswick.
16 avril : Des désordres se sont produits à Milan.
18-19 avril : A la suite de troubles qui se sont produits à Milan, des grèves ont éclaté dans plusieurs villes d’Italie, entre autres, à Turin et à Bologne.
20 avril : Les combats ont commencé près de Munich entre les communistes et Ies troupes d’Hoffmann.
22 avril : Occupation temporaire de la Rhénanie par les troupes françaises. Les combats ont commencé à Munich. Ils ont été défavorables aux troupes du gouvernement de Bamberg et favorables aux révolutionnaires.
23 avril : France - Une loi fixe la durée du travail à 8 heures par jour et à 48 heures par semaine. Allemagne : les troupes gouvernernentales bavaroises ont repris Augsbourg.
26 avril : La révolution hongroise est prise en tenailles entre l’armée tchécoslovaque et l’armée roumaine. Les combats se poursuivent aux abords de Munich.
27 avril : Les escarmouches continuent dans Munich.
28 avril : Les forces prussiennes entrent en Bavière pour écraser l’insurrection déclenchée le 7 avril.
1er mai : France - Manifestation C.G.T., atmosphère d’émeute à Paris. La ville est quadrillée par la troupe lors de la grève du 1er mai (2 morts).
3 mai La bataille se déploie autour de Munich, et les troupes de Noske ont pénétré en Bavière.
5 mai : Munich est tout entière aux mains de l’armée d’Hoffmann. Plusieurs chefs communistes ont été fusillés.
11 mai : Allemagne : les corps francs prennent Leipzig.
28 mai : fin de la grève générale dans la Rhur.
Allemagne - Les forces gouvernementales d’Hoffmann ont commencé l’assaut de Munich. De nombreuses arrestations de socialistes ont eu lieu à Nuremberg.
Printemps : Italie - Série de grèves sauvages dans les villes provoquées par la vie chère. Des centaines de magasins et de dépôts de vivres sont pillés à Forlì, Milan et Florence, où se constitue une république des Soviet qui dure trois jours.
10 juin au 13 juin : France - Grèves dans la métallurgie.
17 juin : De nouveaux troubles se sont produits à Zurich.
17 juin : Des troubles sanglants ont eu lieu à Vienne. Il y a des morts et des blessés.
20 juin : Allemagne – Début de la grève des cheminots.
25 juin : Grèves des transports à Paris.
28 juin : Signature du Traité de Versailles qui partage le monde entre les grandes puissances vainqueurs de la guerre mondiale, aux dépens en particulier de l’Allemagne et de l’empire ottoman.
3 juillet : Allemagne – fin de la grève des cheminots.
Juillet : Italie - Dans le Latium, dans le Sud puis dans la vallée du Pô, les paysans revenus du front occupent, drapeau rouge en tête, les terres des latifundia. Le gouvernement Nitti autorise l’occupation des terres en échange de garanties de mise en culture. Fermiers et braccianti (journaliers) s’organisent en coopératives et en syndicats pour négocier leurs salaires. Le parti populaire italien de don Sturzo prend en charge les nouveaux groupements. La superficie des terres « occupées » ne dépasse pas 180 000 ha, mais cela suffit pour que les agrariens mettent en place des milices privées pour récupérer leurs terres.
1er août : Liquidation de la république hongroise des conseils ouvriers et soldats.
5 octobre : Italie - Ouverture à Bologne du 16e congrès socialiste italien : le parti, qui compte 200 000 adhérents, décide d’adhérer à la IIIe Internationale.
9 octobre : Italie - Ouverture à Florence du premier congrès des Faisceaux de combat : Mussolini se prononce en faveur de la participation aux élections et de l’alliance avec les groupes interventionnistes de gauche.
Grève des cheminots de France en 1920
1920
14 janvier : En Sibérie, l’amiral Koltchak, commandant en chef des Armées blanches, est arrêté et livré aux bolcheviks.
16 janvier : Les Alliés mettent fin au blocus de la Russie bolchevique.
En février : France - vagues de grèves des mineurs et des cheminots (février-mai).
13 mars : Putsch de Kapp. Le général von Lüttwitz et Wolfgang Kapp tentent un putsch réactionnaire en Allemagne.
14 mars : Une grève générale fait échouer la tentative de putsch de Kapp.
22 mars : fin de la grève générale : les dirigeants syndicalistes et social-démocrates sauvent l’Etat bourgeois une nouvelle fois…
Italie - Reprise des grèves au début de l’année. En août, plusieurs centaines d’usines sont occupées.
1er mai : France - A l’initiative de la CGT, la Fédération des cheminots tente en vain de déclencher une grève générale.
Juillet : France - Scission CGT-CGTU (proche du PC).
Juillet : deuxième congrès de l’internationale communiste
13-25 août : L’Armée rouge est refoulée devant Varsovie par les Polonais aidés par la mission militaire française commandée par le général Weygand.
8 septembre :
Italie - Les ouvriers occupent les usines et procèdent à l’élection de « conseil d’entreprise ». Giolitti ne fait pas appel à la force et laisse le mouvement s’essouffler.
19 septembre : Italie - Les représentants des ouvriers signent à Rome un document qui reconnaît le principe du contrôle ouvrier, mais qui restera lettre morte.
7 novembre : Défaite définitive des armées blanches du général Piotr Vrangel en Crimée. 146 000 personnes dont 70 000 soldats sont évacuées en trois jours par bateaux vers Constantinople.
Novembre-décembre : Alliance entre les industriels, banquiers et agrariens, adeptes d’une contre-révolution préventive, et les fascistes, dirigée contre les socialistes et les syndicalistes de la CGL (automne). Les escouades (squadre) fascistes passent à l’action violente, d’abord contre les paysans et les organisations rurales (bourse du travail, coopératives, ligues agraires). La police n’intervient pas, sauf quand se manifeste un début de résistance de la part des paysans. L’assassinat d’un conseiller municipal fasciste à Bologne provoque des affrontements sanglants entre fascistes et socialistes.
Le 20 décembre, à Ferrare, les fascistes émiliens, rassemblés dans la ville, s’adonnent à de violentes représailles. Giolitti profite de la situation pour dissoudre les municipalités socialistes d’une centaine de villes (Ferrare, Bologne, Modène…).
1921
21 janvier : fondation du parti communiste italien
Mars : Combats en Allemagne centrale et « action de mars » du parti communiste allemand
Avril – juin : Grève des mineurs britanniques
LA VAGUE REVOLUTIONNAIRE EN EUROPE 1918-1920
La classe ouvrière dans la révolution irlandaise
La révolution russe de 1917 et la vague révolutionnaire en
Europe
La révolution russe vue par Rosa Luxemburg
La révolution allemande de 1918-19
La révolution hongroise de 1919
La révolution italienne de 1919
Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?
En 1918, le premier ministre anglais Lloyd George écrivait à Clémenceau, chef du gouvernement français :
« Toute l’Europe est remplie d’un esprit révolutionnaire. Il existe parmi les travailleurs un sentiment profond non seulement de mécontentement mais de colère et de révolte contre les conditions de l’avant-guerre. Tout l’ordre existant, dans ses aspects politiques, sociaux et économiques, est mis en question par la masse de la population d’un bout à l’autre de l’Europe. »
Le journal Times du 19 juillet 1918 écrivait :
« L’esprit de désordre domine le monde entier. De l’Amérique à l’ouest jusqu’à la Chine, de la mer Noire à la mer Baltique, aucune société, aucune civilisation n’est assez assurée, aucune constitution assez démocratique pour se dérober à son influence néfaste. Partout existent des signes montrant que les liens élémentaires de la société sont déchirés et décomposés par une longue fatigue. »
Les révolutions prolétariennes éclatent à la fin de l’année 1918 en Allemagne, en Autriche et dans toute l’Europe orientale et centrale.
Le 14 janvier 1918, des ouvriers autrichiens se mirent en grève pour exiger une paix « sans annexions ni contributions de guerre » et un meilleur ravitaillement. Ils constituèrent à Vienne un conseil ouvrier avec lequel le gouvernement fut contraint de traiter. À Berlin, le 28 janvier 1918, près de 400 000 ouvriers et ouvrières cessèrent le travail. Dans les usines, on procéda à l’élection de délégués qui constituèrent un comité central de grève et formulèrent des revendications précises : paix sans annexions, amélioration du ravitaillement, rétablissement des droits et libertés publics, libération des prisonniers politiques. Partout, suivant l’exemple des travailleurs russes, des conseils se formaient. Mais après un moment d’affolement, début février 1918, les autorités allemandes reprirent le dessus et la répression s’abattit.
Les marins de Kiel, qui craignaient que leurs officiers n’envisagent une dernière sortie meurtrière, un baroud d’honneur, s’insurgèrent le 3 novembre 1918.
Le 4 novembre, malgré la répression qui s’était abattue la veille, d’autres unités de l’armée entrèrent en rébellion. On comptait ce jour-là environ 20 000 mutinés. Deux semaines plus tard un délégué de Kiel relata ainsi les circonstances de l’insurrection des marins : « C’est à cette réunion du lundi (4 novembre) que fut décidée la grève générale du mardi. Pour éviter que des éléments timorés ne se rendent à leur travail, nous fîmes occuper les usines par les soldats. De fait, le mardi la grève fut totale. Pas un fonctionnaire, pas un apprenti n’alla travailler.
Dès le mardi matin, on désigna une délégation chargée de négocier avec le gouverneur ; les camarades étaient accompagnés de plusieurs marins. On exigea du gouverneur qu’il fasse relâcher les matelots emprisonnés. S’ils n’étaient pas relâchés, tous les navires de la rade pointeraient leurs canons sur la ville. Si vous connaissez Kiel, vous comprendrez ce que cela signifie. Le gouverneur, lui, le savait : il a cédé sur-le-champ et fait libérer les prisonniers. (...) Réunis le mardi à 5 heures, nous avons élu président du conseil ouvrier le camarade Garbe, secrétaire du syndicat des métallurgistes. Un conseil de soldats fut constitué également. »
Des détachements de marins se rendaient dans les villes voisines et s’en rendaient maîtres facilement.
La révolution gagna ainsi Hambourg, puis tout le nord de l’Allemagne. Et dans le Sud, le 8 novembre, le conseil d’ouvriers, de soldats et de paysans de Munich annonça à la population la création d’une République socialiste de Bavière. Le 9 novembre la révolution gagna Berlin. Les travailleurs berlinois contraignirent de fait l’empereur à abandonner le pouvoir.
Les conseils d’ouvriers et de soldats surgissaient de partout. Des milliers de militants, issus pour la plupart des rangs du Parti social-démocrate allemand, le SPD, et qui pour beaucoup avaient accepté les sacrifices demandés au nom de l’effort de guerre, espéraient cette fois que la fin de la guerre marquerait l’avènement du socialisme. Ils ne voulaient plus attendre. Le renversement du capitalisme leur semblait proche.
La révolution austro-hongroise de novembre 1918 remet le 21 mars 1919 le pouvoir « aux partis ouvriers ». Mais elle n’en a pas la politique. Le parti communiste est né en novembre 1918. Lorsque le pouvoir bourgeois tombe, son dirigeant, Bela Kun, est en prison où il a failli être assassiné par une action de l’extrême droite. Les dirigeants social-démocrates hongrois, après une rupture où la droite du parti a rompu, ont déclaré être prêts, avec les communistes, de mettre en place un gouvernement soviétique et communiste… Sur cette seule déclaration, le parti communiste hongrois accepte la fusion avec le parti social-démocrate qui n’a pourtant pas changé de nature. Ses dirigeants, arrivés au pouvoir au nom du communisme, ne vont faire que trahir cette perspective. En même temps, ils affirment un socialisme sourcilleux, puisqu’au nom de ce prétendu collectivisme, ils refusent de partager les terres des féodaux entre les paysans pauvres, privant le mouvement ouvrier du soutien des opprimés des campagnes. Sur le terrain militaire, cela ne va pas mieux. Les anciens dirigeants socialistes ont fait confiance à la hiérarchie militaire hongroise qui trahit ouvertement en entrant en contact avec les troupes impérialistes et en les favorisant. Alors que les forces militaires impérialistes lancent une offensive, un général français ayant pris la tête des troupes roumaines, tchèques et serbes. Le 1er août 1919, devant l’échec complet de la révolution hongroise, Bela Kun remet la démission du gouvernement. Les « socialistes » se maintiennent cependant jusqu’à la mise en place de la dictature fasciste sanglante de l’amiral Horthy. Le mouvement ouvrier hongrois fut saigné à blanc.
Dans la même période, la révolution touchait l’Allemagne. Des mouvements de grève ouvrière puissants parcouraient le pays. La Bavière était la première touchée par la révolution ouvrière qui imposait aux partis socialistes de prendre le pouvoir le 7 avril 1918. Mais ce n’était qu’un gouvernement socialiste de pacotille et le parti communiste dirigé par Eugène Léviné refusait d’y prendre part et le dénonçait comme une « république socialiste de pacotille ». Des véritables conseils ouvriers en armes virent alors le jour sous l’égide de ce tout jeune parti communiste.
Du 13 au 29 avril 1919, une brève république des conseils ouvriers et soldats de Bavière a lieu. Le 5 juin, Léviné était exécuté et la répression frappait la classe ouvrière. Mais la révolution allemande n’était pas finie et la classe ouvrière y disposait encore de forces considérables, comme l’année 1920 allait le montrer.
Mais la révolution en Europe était encore en pleine montée, les gouvernements français et anglais étant toujours en train de naviguer dans les grandes vagues ouvrières avec la grève de la région industrielle de la Clyde et la grève du 1er mai en France. Clémenceau y est contraint, à la veille de la grève, d’annoncer une loi instaurant la journée de huit heures. Les social-démocrates réformistes, attachés aux intérêts de la bourgeoisie depuis la guerre mondiale mais sous la pression des travailleurs européens, prétendent qu’ils vont organiser une journée internationale de grève le 21 juillet 1919, mais ils la torpillent puis la décommandent …
La révolution se propage dans l’empire Ottoman qui est menacé par une vague révolutionnaire des classes ouvrières et des peuples opprimés.
En Europe, la montée révolutionnaire affecte l’Europe centrale, les Balkans, l’Italie, l’Espagne. En France, la situation sociale se radicalise au point que le terme de soviet devient très populaire dans la classe ouvrière et qu’à la veille du premier mai, le gouvernement ultra-réactionnaire de Clémenceau est contraint de céder à une revendication traditionnelle du mouvement ouvrier : la journée de huit heures. En Grande Bretagne, la même radicalisation ouvrière se manifeste avec notamment la grève de la région industrielle de la Clyde. En même temps, des mutineries de soldats se produisent dans les marines française et anglaise.
Finlande
De Victor Serge dans « l’An I de la révolution russe » :
« En Finlande, les prolétaires tentent une révolution démocratique
La bourgeoisie finlandaise se préparait depuis 1914 à conquérir par les armes, à la faveur de la guerre impérialiste, son indépendance nationale. Trois mille jeunes Finlandais des classes aisées ou riches formant le 27ème bataillon de chasseurs de l’armée allemande se battaient contre le Russe, ennemi héréditaire. Des écoles militaires clandestines existaient en divers endroits du pays. A la chute de l’autocratie, un corps de fusiliers volontaires se constitue dans le nord afin d’assurer le maintien de l’ordre. C’est le « schutzkorps » du général Herrich, première garde blanche formée au grand jour. (…) La révolution d’Octobre eut pour écho, en Finlande, la grande grève générale de la mi-novembre suscitée par une disette grave qui n’atteignait que les classes pauvres et par la politique réactionnaire du Sénat, enclin à placer à la tête d’un Directoire dictatorial le réactionnaire Swinhufwud. Le travail cessa partout. Les chemins de fer s’immobilisèrent. Les gardes rouges ouvrières, soutenues ça et là, des soldats russes, occupèrent les édifices publics. Des collisions sanglantes se produisirent un peu partout entre blancs et rouges. Les députés discutaient. La bourgeoisie apeurée consentit à l’application de la loi des huit heures et de la nouvelle législation communale, ainsi qu’à la démocratisation du pouvoir exécutif qui passa du Sénat au Djem (diète). Et la grève générale, la victoire ouvrière se termina par la constitution d’un cabinet bourgeois, présidé par le réactionnaire Swinhufwud ! C’était l’avortement d’une révolution. De l’avis des révolutionnaires finlandais, la prise du pouvoir était à ce moment possible ; elle était même facile ; l’appui des bolcheviks eut été décisif. Mais, écrivit plus tard le camarade O.W.Kuussinen, alors l’un des dirigeants du centre de la social-démocratie finlandaise, « ne désirant pas risquer nos conquêtes démocratiques et espérant d’ailleurs franchir, grâce à d’habiles manœuvres parlementaires, ce tournant de l’Histoire, nous décidâmes d’éluder la révolution (…). Nous ne croyions pas à la révolution, nous ne fondions sur elle aucune espérance, nous n’y aspirions point ». Avec des chefs animés d’un tel esprit, la cause du prolétariat finlandais était bien compromise.
Or, la grève générale avait révélé aux prolétaires leur force, à la bourgeoisie le péril. La bourgeoisie finlandaise comprit que, livrée à elle-même, elle était perdue. Swinhufwud sollicita l’intervention de la Suède. L’armement des blancs se poursuivit avec énergie dans le nord où ils constituèrent des stocks de vivre. Le gouvernement entretint habilement la disette dans les centres ouvriers auxquels il importait de ne pas donner des stocks de vivres. La proclamation de l’indépendance de la Finlande ne changea rien. (…) Le problème du pouvoir se posa de nouveau, en termes plus graves qu’à la veille de la grève générale de novembre. Il apparut, cette fois, aux social-démocrates que toutes les chances de la résoudre par les voies parlementaires étaient épuisées. Il fallait se battre.
Le drapeau rouge fut hissé sur la Maison ouvrière de Helsingfors dans la nuit du 14 janvier. La ville tout de suite prise, le Sénat et le gouvernement se réfugièrent à Vasa. Les rouges se rendirent maîtres en quelques jours, presque sans combat, des plus grandes villes, Abo, Vyborg, Tammerfors et tout le sud du pays. Cette victoire trop pacifique était inquiétante. Les dirigeants social-démocrates (Manner, Sirola, Kuussinen, etc) formèrent un gouvernement ouvrier, le Conseil des mandataires du peuple, placé sous le contrôle d’un grand conseil ouvrier formé de trente cinq délégués (dix des syndicats, dix du parti social-démocrate, dix des gardes rouges, cinq des organisations ouvrières de Helsingfors). Qu’allait-on faire ? « Marcher jour après jour vers la révolution socialiste », déclaraient les mandataires du peuple. Ils instituaient le contrôle ouvrier de la production, facilité par la concentration très élevée des industries dominantes du bois, du papier, du textile ; ils réussissaient à enrayer le sabotage des banques. La vie publique et la production reprirent très promptement un cours à peu près normal. La dictature du prolétariat était-elle possible ? S’imposait-elle ? Les dirigeants du mouvement ne le pensaient pas, bien que l’industrie occupât cinq cent mille personnes environ sur une population de trois millions d’âmes Prolétaires et journaliers agricoles formaient une masse d’un demi-million d’hommes. Les agriculteurs petits et moyens, en majorité dans les campagnes, pouvaient être conquis à la révolution ou neutralisés par elle. Par malheur, « jusqu’à la défaite, la plupart des dirigeants ne se rendirent pas nettement compte des buts de la révolution » (O. W. Kuusinen). Ils entendaient établir, sans expropriation des classes riches ni dictature du travail, une démocratie parlementaire au sein de laquelle le prolétariat eût été la classe politiquement dirigeante.
Les principales mesures appliquées par le conseil des mandataires du peuple furent : la journée de huit heures, le paiement obligatoire des salaires des journées de grève révolutionnaire, l’émancipation des domestiques et valets de ferme (loués à l’année par les agriculteurs et soumis à un statut d’une extrême sévérité), l’abolition du vieux système de location des terres fondé sur les corvées et les tributs, l’exonération des petits tenants du loyer, la réforme judiciaire, l’abolition de la peine de mort (très rarement appliquée auparavant), l’exonération fiscale des pauvres, l’impôt sur les logements de plus d’une pièce, la libération de la presse…, le contrôle des usines par les ouvriers.
D’autres mesures s’imposèrent un peu plus tard au cours de la guerre civile, telles que les réquisitions du blé et des pommes de terre, la fermeture des journaux bourgeois, la défense de l’exportation des valeurs, l’obligation générale du travail pour tous les adultes valides de dix-huit à cinquante-cinq ans. Cette révolution ouvrière se poursuivit au nom d’une démocratie idéale dont la conception fut précisée dès la fin de février par un projet de constitution appelé à faire au printemps l’objet d’un référendum. Parcourons ce beau projet.
Une assemblée des représentants du peuple, élue tous les trois ans au suffrage universel direct et secret (vote des femmes, majorité électorale : vingt ans) au système de représentation proportionnelle, serait l’autorité suprême dans la « République populaire de Finlande ». Outre les libertés démocratiques usuelles, la constitution consacrerait l’inviolabilité des personnes, le droit de grève et la surveillance des entreprises par les grévistes (contre l’emploi des jaunes), la neutralité de la force armée dans les conflits du travail… Un révolutionnaire finlandais a formulé sur ce projet le jugement suivant : « Le plus haut degré de développement de la démocratie bourgeoise (degré irréalisable en pratique au sein de la société capitaliste) était atteint en théorie… »
« La faiblesse de la bourgeoisie, dit Kuussinen, nous laissait sous le charme de la démocratie, et nous décidâmes de marcher vers le socialisme par l’action parlementaire et la démocratisation de la représentation nationale. » Te était, sur les socialistes finlandais, l’empire des illusions réformistes. Telle était leur funeste méconnaissance des lois de la lutte des classes.
La bourgeoisie faisait preuve d’un réalisme beaucoup plus grand. Elle mit promptement sur pied une petite armée blanche, dont le schutzkorps, le 27ème bataillon de l’armée allemande, une brigade de volontaires suédois et des volontaires recrutés dans la jeunesse bourgeoise et petite-bourgeoise fournirent le gros des forces (cinq mille hommes environ). Un général de l’armée russe (d’origine suédoise) Mannerheim, accepta le commandement de ces troupes et promit d’abord de « rétablir l’ordre en quinze jours ». Le butin de quelques agressions heureuses contre les garnisons russes du Nord, perpétrées avec la complicité du commandement de celles-ci, compléta l’armement des blancs.
Les gardes rouges ne comprenaient, au début des hostilités, que mille cinq cent hommes environ, d’ailleurs mal armés. L’initiative appartint aux blancs qui, maîtres des cités du golfe de Bothnie, Uléaborg, Vasa, Kuopio, et de la Finlande agraire (septentrionale), formèrent un front continu du golfe de Bothnie au lac Lagoda. (…)
Au gouvernement ouvrier, la tendance modérée était représentée par Tanner si forte que l’on n’adopta des mesures de rigueur contre les blancs de l’intérieur que lorsqu’il fut trop tard. Les tribunaux condamnaient souvent les contre-révolutionnaires à l’amende ou à des peines bénignes d’emprisonnement. (…)
Mannerheim cerna Tammerfors où dix mille rouges dirigés par quelques officiers russes résistèrent avec acharnement. La ville fut prise maison par maison après une bataille de rues de plusieurs jours… Deux mille assiégés succombèrent ou furent massac’és, cinq mille furent fait prisonniers.
C’est à Tavastehus, entre Tammerfors et Helsingfors, que se livra la bataille décisive. Vingt à vingt cinq mille rouges se concentraient vers ce point… Les blancs les arrosèrent de shrapnells. Cernés, ils se battirent héroïquement avant de capituler… La capitulation fut suivie d’un massacre… Depuis la saignée infligée à la Commune de Paris par la bourgeoisie française, le monde n’avait rien vu de comparable à l’horreur de ce qui se passa en Finlande. Dès le début de la guerre civile, il suffisait, dans la zone occupée par les blancs, pour être arrêté d’appartenir à une organisation ouvrière, et pour être fusillé d’y avoir rempli une fonction. Le massacre des socialistes atteignit de telles proportions qu’il finit par n’intéresser personne… Au 25 juillet, il y avait encore dans les prisons finlandaises cinquante mille huit cent dix-huit révolutionnaires… La terreur blanche confond les réformistes – dont la bourgeoisie triomphante n’a plus besoin – et les révolutionnaires… Au total, il ne semble pas exagéré d’admettre que plus de cent mille prolétaires finlandais furent frappés par la terreur blanche : le quart environ du prolétariat. Tous les ouvriers organisés….
LA REVOLUTION EN AUTRICHE
« Une malheureuse tentative insurrectionnelle en Autriche allemande »
Octobre 1919
Texte de Karl Radek
I.— Les révélations de Bettelheim1
Celui qui, au cours de ces derniers mois, a observé la marche du mouvement communiste en Autriche allemande (même s’il en a été réduit aux seuls communiqués de journaux) a pu se persuader que ce mouvement traverse une crise sérieuse. Déjà, dès les premiers jours de la révolution prolétarienne de Hongrie des tentatives avaient eu lieu, à Vienne, de provoquer une explosion de révolte. Les initiateurs de ce plan partaient de la supposition profondément erronée que c’était là un moyen de porter secours à la République soviétiste hongroise. Pour atteindre ce but ils distribuèrent à droite et à gauche des sommes d’argent qui n’eurent d’autre effet que d’apporter la décomposition dans le mouvement communiste autrichien. Cette tactique eut l’inévitable résultat que le mouvement fut abandonné par tous les camarades qui ne voulaient en aucun cas porter la responsabilité de la décomposition du Parti et qui en même temps considéraient comme impossible, vu la situation embarrassante de la République soviétiste hongroise, de combattre ouvertement ses agents.
Cela eut pour conséquence, après la chute de la République soviétiste hongroise, de créer une pénible atmosphère d’accusations réciproques de caractère politique et purement personnel, qui entraîna la démission du Parti de toute une série de camarades et qui entrava l’action de ceux qui restaient. Grâce à l’intervention des militants dirigeants des autres organisations de l’Internationale Communiste, on réussit à si bien purifier l’atmosphère que désormais on put espérer en la possibilité d’une action combinée des représentants des divers courants du Parti autrichien.
Cependant des difficultés ultérieures surgirent, motivées par l’impossibilité d’examiner publiquement ce qu’on avait réussi à élucider dans l’intimité d’un petit cercle. De plus, on fut obligé de compter avec les camarades hongrois qui, tels que le docteur Bettelheim, jouèrent pendant la crise un rôle marquant et qui, par la suite, furent arrêtés à Vienne. Ces difficultés sont maintenant dissipées. Le docteur Friedrich Adler a publié dans le Kampf de Vienne, du 4 octobre 1919, un manuscrit saisi chez Bettelheim lors de son arrestation, dans lequel est exposée la marche de ces événements. Ce faisant M. Friedrich Adler voulait, disait-il, jeter un rayon de lumière sur ce « marécage qu’on appelle le Parti Communiste ». Nous ne pouvons en être que reconnaissants envers Friedrich Adler, bien que la lâcheté et la vénalité dont il dénonça jadis le règne au sein de la social-démocratie autrichienne (voir son discours d’accusation dans l’édition berlinoise des procès-verbaux de son procès rédigés par lui-même) dussent bien l’inciter plutôt à s’occuper de ce « marais » dans lequel, après sa coalition avec les antisémites, la social-démocratie s’est certainement bien plus profondément enlisée qu’en 1916. Mais, comme nous l’avons déjà dit, nous ne pouvons qu’être reconnaissants à Bettelheim et Adler d’avoir rendu possible l’examen public de cette question. Et cette possibilité nous avons l’intention de la mettre à profit d’ores et déjà.
II. — Naissance du Parti Communiste en Autriche allemande
Pour comprendre comme il convient la crise qui s’est manifestée si nettement de mai en août, il est nécessaire de ne pas perdre de vue que le Parti Communiste autrichien était considérablement plus faible que le Parti Communiste allemand.
En Allemagne, déjà bien avant la guerre, il existait dans la social-démocratie une tendance radicale de gauche qui s’était formée dans la lutte contre l’opportunisme tant avoué que voilé (tendance Kautsky, Haase) et qui jetait les fondements du futur Parti Communiste allemand. Pendant la guerre cette tendance élargit son idéologie, acquit au milieu de difficultés exceptionnelles et au prix de pertes considérables toute une pléiade de nouveaux partisans, créa des organisations illégales et gagna rapidement les masses. La scission qui se produisit en 1917 dans la social-démocratie allemande facilita ce travail. La fondation d’un Parti Communiste autonome fut le résultat d’une activité de huit années de lutte d’idées et de quatre années d’organisation menée par des centaines de personnalités marquantes.
En général, dans l’Autriche allemande il n’existait pas, avant la guerre, d’opposition marxiste au sein de la social-démocratie. A l’exception de Josef Strasser, tous les marxistes autrichiens, Otto Bauer et Fritz2 Adler les premiers, se donnaient pour tâche non de lutter avec l’opportunisme, mais de l’éclairer théoriquement. Cette circonstance fait que dans l’Autriche allemande les Partis ne furent pas obligés de voter pour les crédits militaires ; les sessions de parlement autrichien n’eurent généralement pas lieu, ce qui donna aux dirigeants du Parti social-démocrate autrichien, qui avait en Viktor Adler un chef d’une grande — et légitime — autorité morale et en Renner un guide politique éprouvé, la possibilité de masquer et de confondre les oppositions existantes dans le Parti. Jusqu’à quel point se sentait faible l’opposition modérée qui apparut dans le Parti autrichien pendant la guerre, c’est ce que démontre l’attentat de Fritz Adler, qui usa du revolver parce qu’il savait que les masses ne le suivaient pas et se sentait incapable d’une vaste action politique. Surgissant en pleine guerre et se groupant autour du camarade Franz Koritschoner, l’opposition radicale de gauche ne compta que quelques partisans.
Lorsque la révolution éclata, les éléments qui se groupèrent bientôt dans un Parti Communiste d’Autriche allemande formèrent un groupe insignifiant de très jeunes intellectuels qui sous l’influence de la guerre se pénétrèrent de tendances révolutionnaires prolétariennes, mais qui n’en étaient pas moins étrangers à toute expérience politique ; les prisonniers de guerre de retour de Russie se joignirent à eux, mais il va de soi qu’ils n’étaient guère au courant de la situation en Autriche. Dès lors il est évident qu’un Parti composé de semblables éléments ne pouvait pas, dans un court laps de temps, devenir le centre des tendances révolutionnaires qui apparurent dans le prolétariat lorsque la social-démocratie autrichienne, dirigée par Renner et Seitz3 avec le concours de Fritz Adler (qui après avoir perdu dès 1916, sous l’influence de la guerre, toute maîtrise de soi-même, fut pendant la révolution le plus paisible des petits bourgeois) conclut une alliance avec la bourgeoisie.
Le jeune Parti Communiste autrichien devait inévitablement commettre beaucoup d’erreurs avant de pouvoir trouver sa voie légitime dans la lutte. La politique communiste n’est pas une simple application des principes inventés et brevetés à Moscou, elle consiste à conduire les masses révolutionnaires, dont les conditions sont de beaucoup différentes dans les divers pays.
Ce n’est qu’après s’être enrichies de l’expérience de leur lutte naturelle et avoir appris à tirer les conclusions de cette expérience que les masses ouvrières peuvent se frayer une voie vers le communisme. Et plus les combattants d’avant-garde du prolétariat seront instruits et expérimentés, plus vite ils sauront évaluer l’importance de cette expérience, plus et mieux ils aideront le prolétariat à s’orienter.
Le Parti Communiste d’Autriche allemande, vu la jeunesse de ses chefs, n’a pu faire dans les premiers mois de son existence que de timides tentatives dans la voie de la propagande et de l’organisation. Il n’avait pas pu prévoir combien la route qui mène au but serait longue et sinueuse. L’impétuosité du mouvement révolutionnaire d’Allemagne qui se prolongea de janvier en avril, les grèves d’Angleterre leur paraissaient être le présage de la victoire prochaine de la révolution universelle. Et c’est dans l’état d’esprit suscité par ces espoirs que venait les surprendre la proclamation de la République soviétiste hongroise et peu après celle des soviets de Munich.
III. — La tactique insurrectionnelle hongroise à Vienne
Les travailleurs révolutionnaires de Vienne, non seulement les communistes, mais aussi les social-démocrates, furent absolument électrisés par les événements de Hongrie et de Bavière. Les chefs communistes se considéraient comme obligés de mener la propagande la plus énergique en faveur de la proclamation de la république soviétiste. Ils avaient pleinement raison, lorsqu’ils répliquaient aux social-démocrates que l’établissement de la république des Soviets à Vienne élargirait le champ d’action et donnerait la possibilité de lutter avec les difficultés alimentaires qui prenaient alors, à Vienne, une grave tournure et qui servaient d’argument principal à F. Adler et ses disciples contre l’institution du pouvoir soviétiste en Autriche allemande.
La proclamation de la République des Soviets austro-allemande n’entraînait pas que la nécessité de nourrir une plus grande quantité d’hommes, ce que criaient les social-démocrates, mais eût réuni au fougueux prolétariat hongrois des centaines de milliers d’ouvriers autrichiens aptes à l’organisation ; il est certain qu’elle eût considérablement accru la force militaire des républiques soviétistes alliées et leur eût donné la possibilité d’occuper les territoires, si riches en blé, de la Hongrie, la victoire du prolétariat austro-allemand d’Autriche eût été incontestablement suivie d’une réponse chez les ouvriers tchèques et eût servi de calmant à l’Entente, en changeant radicalement la situation qui se créa lors de l’isolement de Budapest. Les communistes d’Autriche allemande n’ont donc fait que leur devoir, en tendant toutes leurs forces pour entraîner le prolétariat autrichien à proclamer la république des Soviets.
Les « réalistes », Fritz Adler et Bauer en tête en mettant en garde le prolétariat contre cette « expérience », le trahirent en fait, aidant les Renner et les Ellenbogen à le livrer pieds et poings liés à la bourgeoisie ; et si le prolétariat est aujourd’hui définitivement vendu à la bourgeoisie par ces mêmes Ellenbogen et Renner, c’est là le résultat de leur tactique de renoncement à tonte lutte. Le même sort a été réservé aux Renner et aux Ellenbogen d’une part, aux Haase et aux Dittmann, leurs frères en esprit, de l’autre.
Mais l’agitation en faveur de la dictature des Soviets semblait à une partie des camarades hongrois un soutien trop insuffisant de la part du prolétariat autrichien. Il ne faut pas perdre de vue que le Parti Communiste hongrois ne disposait que d’un tout petit nombre de militants éduqués et expérimentés, qu’après sa facile victoire il fut obligé de désigner à beaucoup de postes importants des camarades dépourvus de toute expérience, sans parler de tous les aventuriers qui s’étaient glissés dans ses rangs uniquement parce qu’il était victorieux. Il est bien difficile d’établir en ce moment dans quelle mesure participèrent à la propagande étrangère de la république des Soviets ces éléments inexpérimentés, ces aventuriers et ces chacals qui se risquent toujours sur les champs de bataille après le combat. C’est un fait que ces éléments menèrent à Vienne une agitation active, poussant le jeune Parti Communiste autrichien à la révolte.
Vers le milieu de mai, le docteur Bettelheim arriva à Vienne, en qualité d’émissaire hongrois, il se donna comme fondé de pouvoir de la 3e Internationale qui l’avait soi-disant mandaté à l’effet de proclamer au plus tôt la république des Soviets en Autriche allemande. En réalité, le Comité Exécutif de l’Internationale Communiste connaissait Bettelheim — personnage qui jusqu’alors avait été totalement étranger au mouvement — tout juste autant que Bettelheim connaissait l’Internationale Communiste : c’est dire qu’il l’ignorait absolument.
Nous ignorons si ce fut le docteur Bettelheim lui-même qui inventa la fable de cette fantastique mission, afin de pouvoir agir plus facilement sur les camarades inexpérimentés de Vienne ou si une institution quelconque de la République des Soviets hongroise l’induisit consciemment en erreur, désirant donner plus de hardiesse pour l’accomplissement d’un plan élaboré en Hongrie. En tout cas, le « mandat de Moscou » du docteur Bettelheim est le produit de la fantaisie d’un jeune camarade n’ayant pas la moindre idée du communisme ou la manœuvre frauduleuse d’un aventurier.
A aucun moment le Parti Communiste russe — avant et après la fondation de la 3e Internationale — n’a mandaté aucun camarade à l’effet de se rendre dans un pays déterminé pour y proclamer à un moment donné la République des Soviets.
Le Parti Communiste russe et le Comité Exécutif de l’Internationale Communiste dirigé par lui ne se sont jamais leurrés de cette pensée qu’ils pouvaient de Moscou diriger la politique concrète des Partis Communistes étrangers qui travaillent en pleine action de leur propre mouvement.
Celui qui écrit ces lignes et qui dirigea jusqu’en décembre 1918 la propagande étrangère des bolcheviks, dans ses pourparlers avec les communistes allemands, hongrois, tchèques, yougoslaves, lesquels, entre autres, visitèrent en octobre 1918 l’Autriche-Hongrie, les mit en garde catégoriquement au nom du Parti Communiste russe contre une simple copie des exemples russes dans la première phase de la révolution austro-allemande et leur conseilla même de modifier leur position vis-à-vis de l’Assemblée nationale par rapport aux conditions de lieu et de temps, et à la phase déjà atteinte par le mouvement.
Le Comité Exécutif de l’Internationale Communiste, dirigé par des tacticiens aussi avisés que Zinoviev et Trotsky, disciples de Marx, qui travaillent dans le parti depuis de longues années (Trotsky depuis 25 ans, Zinoviev depuis 17 ans) ne prouvait assurément pas recommander une autre politique. Le Parti Communiste russe sait que la victoire définitive de la Révolution russe n’est possible que si la Révolution universelle est victorieuse. Et la Révolution universelle ne peut se développer que comme un mouvement créé dans chaque pays par ses propres masses prolétariennes et non par les premiers « émissaires » venus.
Si la révolution prolétarienne dans les pays étrangers ne se développe pas dans un avenir plus ou moins rapproché suffisamment pour vaincre l’impérialisme de l’Entente, la République des Soviets russes peut mourir d’une hémorragie ; car la guerre défensive contre l’Entente paralyse toutes ses forces dirigées vers la réorganisation économique de la société. Ce fut le sort de la Hongrie soviétiste par suite de sa base trop restreinte. Mais la conscience de ce danger ne doit pas nous empêcher de nous rendre compte que seul le développement de la révolution prolétarienne (et non pas les révoltes provoquées artificiellement) peut aider les républiques soviétistes menacées ; de semblables insurrections ne peuvent qu’affaiblir le mouvement dans les autres pays, et par conséquent la Russie soviétiste et les autres centres révolutionnaires, tout en compromettant, en général, les idées communistes.
Si en Autriche allemande, le prolétariat eût accepté dans sa majorité et réalisé l’idée de la dictature des soviets, la république soviétiste de Hongrie en eût été renforcée. Mais si le Parti Communiste autrichien se fût emparé du « pouvoir » par l’insurrection — ce qui n’était nullement impossible, vue la faiblesse du gouvernement — tout en n’ayant pas derrière lui la majorité du prolétariat, cette victoire n’eût qu’affaibli la république soviétiste de Hongrie. La république des Soviets autrichiens n’eût point été dans ce cas « soviétiste », car les soviets étaient contre sa proclamation. Les syndicats ne l’admettaient pas non plus. Sur qui donc se fût-elle appuyée ? Contrainte d’avoir recours au soutien d’une garde rouge recrutée au hasard et de lutter contre la majorité de la classe ouvrière, où eût-elle pu puiser encore des forces pour venir en aide à la Hongrie des Soviets ? Celle simple considération était suffisamment persuasive pour démontrer toute la folie de la tactique insurrectionnelle à tous ceux qui connaissent la République des Soviets autrement que par ouï-dire. Mais en l’occurrence c’est à une malheureuse ignorance que nous avons affaire ici ; le Messie du bureau de la propagande de Budapest n’a pas la moindre conception du Communisme ; c’est ce que prouve chaque mot de ses attaques contre le Parti Communiste d’Autriche allemande.
IV. — La révolte du 15 juin
Voici ce que communique Bettelheim sur la force du Parti Communiste vers le 15 mai, lorsqu’il arriva à Vienne avec son fantaisiste mandat. Le comité central du Parti n’avait pas pu se déciderà une seule action de quelque peu d’importance — plus loin nous verrons ce que ce naïf personnage entend par le mot « action » — il ne pouvait se glorifier d’aucun succès. Le comité ne connaissait pas la composition du Parti, le nombre des camarades qui travaillaient dans les entreprises isolées ; il n’avait pas pu convoquer des fondés de pouvoir de ces entreprises. Les organisations étaient littéralement dépourvues d’agitateurs et aucun travail systématique de parti ne se faisait. Une masse énorme de chômeurs restait en dehors de toute organisation, les relations avec la campagne étaient négligées. De cet état de choses, tout homme judicieux n’aurait pu tirer qu’une seule conclusion bien simple : It’s a Long Way to Tipperary. Tout le travail est encore à faire : il faut organiser le Parti, pénétrer dans les entreprises et y poser le fondement des organisations ; établir des rapports avec la campagne, mener énergiquement l’action de propagande, utiliser chaque manifestation de la vie politique sociale pour l’action qui mobiliserait la classe ouvrière, l’organiserait et peu à peu ramènerait sur le terrain de la lutte.
Mais les Messies et les prophètes, comme on le sait, ne labourent pas et ne sèment pas ; ils ont une baguette magique avec laquelle ils accomplissent des miracles. Il est vrai que le docteur Bettelheim, qui n’était qu’un pseudo-prophète, n’a pu accomplir que des pseudo-miracles. Au lieu d’organiser le Parti, il le désorganise, en dissolvant son centre de direction et en nommant un « directoire ».
Comme il convient à un faiseur de miracles, il veut moissonner là où il n’a pas semé et décide précisément le 15 juin — par conséquent juste au bout de son premier mois, si riche en succès, de séjour à Vienne — d’affranchir le prolétariat du joug capitaliste en proclamant la République des Soviets. Il ne put pas se décider à quelque chose de plus modeste car il l’écrit textuellement dans son œuvre remarquable : « J’entends par action la proclamation de la République Soviétiste ».
En attendant, le docteur Bettelheim n’a fait qu’évincer du centre de direction du Parti Josef Strasser, le communiste autrichien le plus actif, et nommer le « directoire ». Ce fut malgré tout suffisant. La cause avança rapidement. Des organisations dans les entreprises surgissaient, dans les casernes de forts mouvements se manifestaient, les chômeurs, les mobilisés, les invalides organisaient des démonstrations. La force de la révolution prolétarienne surgissait au grand jour comme par enchantement, à Vienne et dans les campagnes, de sorte que l’on pouvait pleinement escompter le succès de l’avènement de la République des Soviets précisément pour le 15 juin.
« Jusqu’à quel point la force de la révolution prolétarienne était grande », c’est ce que nous verrons à l’instant. Le phénomène vraiment miraculeux que le docteur Bettelheim ait pu à l’avance prévoir le jour de la révolution est facilement explicable : comme il le communique, elle avait été simplement décidée pour ce jour et même aucun détail d’une révolution bien préparée n’avait été négligé. En un mot, le 15 juin, une insurrection dans les formes requises devait avoir lieu... Il n’y avait rien de surnaturel dans ces moyens miraculeux grâce auxquels avant le déclenchement de l’action à date fixe apparurent l’organisation, les troubles nombreux, etc. Le docteur Bettelheim avait lâché sur Vienne toute une nuée d’agitateurs qui répandaient de l’argent et qui préparaient « l’action » selon toutes les règles de l’art. Celle-ci fut décidée pour le 15 juin, mais la veille de ce jour, le 14, le directoire était arrêté (Bettelheim affirme — au reste sans aucune preuve — que le directoire fut arrêté sur sa propre demande).
Le même jour, les chômeurs et les soldats démobilisés organisèrent une démonstration, exigeant la mise en liberté des chefs. Il y eut des morts. Pourquoi donc la « révolution prolétarienne » n’a-t-elle pas triomphé ? Le prolétariat délivre ses chefs et exige qu’ils réalisent en fait la révolution. « Provoquée comme par enchantement » la révolution prolétarienne présente à ses chefs cette revendication : « Vous m’avez provoquée, vous devez mener l’œuvre jusqu’au bout ». La révolution doit être réalisée par Toman4, Koritschoner, autrement il n’en résultera rien. La vieille devise que l’émancipation des travailleurs ne sera l’œuvre que des travailleurs eux-mêmes est transformée par des « communistes » tout frais moulus en celle-ci : le « prolétariat ne peut être affranchi et sauvé que pas ses chefs ». Ici on sent évidemment la proximité des Bettelheim et des Renner situés officiellement aux antipodes les uns des autres ; ces derniers « sauvent » le prolétariat, comme les mendiants qui demandent du pain pour les affamés, les Bettelheim les sauvent en « proclamant » la République. Dans le premier cas, les prolétaires doivent se tenir tranquilles ; dans le second, ils doivent agir sur un mot de leurs chefs, mais dans les deux cas ils sont des figurants. Les sauveurs ce sont les chefs. Mais ici commence une délicieuse opérette : les « chefs » élus par Bettelheim pour sauver le prolétariat refusent de marcher. Les chefs ont promis de faire la révolution, mais ils avaient si peu confiance en eux-mêmes qu’ils ne se décidèrent même pas à paraître devant la masse. Tout désir d’émanciper le prolétariat les avait abandonnés.
Voici de bien mauvais hommes qui auraient pu affranchir le prolétariat et qui ne l’ont pas voulu. Mais le 15 mai le docteur Bettelheim est arrivé à Vienne envoyé par l’Internationale, avec la mission de frayer la voie à la domination du prolétariat. Pourquoi n’a-t-il pas rempli sa mission et affranchi le prolétariat ? Qu’il n’ait pas eu confiance en ses propres forces, la chose est inadmissible, car cet intrépide agitateur croyait aveuglément en ses forces. Il « s’est abstenu, c’est vrai, d’émanciper le prolétariat » de crainte que les militants de la révolution viennoise qui ne savaient pas que la révolution a été provoquée « par enchantement » pussent lui déclarer : « Excusez, monsieur Bettelheim, nous ne vous connaissons pas et vous ne pouvez pas nous émanciper ». Ces « révélations » de Bettelheim seraient plutôt plaisantes, si toute cette histoire n’avait pas exigé des victimes. Bettelheim lui-même racheta en partie sa faute en imaginant ses révélations et en démontrant —, contre son gré — à tout ouvrier judicieux, la stupidité et le vide de la tactique insurrectionnelle. Cependant après l’expérience du 15 juin il ne s’est pas persuadé de l’inadmissibilité d’une tactique semblable et il faut croire que nous avons affaire à une sorte de Rinaldo Rinaldini5 incurable.
Mais les travailleurs communistes ne sont pas frappés d’aliénation mentale et grâce aux révélations de Bettelheim ils auront la plus profonde méfiance vis-à-vis de la détestable action miraculeuse des insurrections. Les communistes qui composaient l’avant-garde diu prolétariat autrichien, ont, dans les journées de juin, fait une croix sur la tactique insurrectionnelle de Bettelheim. Ils ne se sont pas laissés entraîner dans l’aventure de « proclamer » la République Soviétiste. Ils doivent bien se persuader désormais de l’inadmissibilité et de la honte des émeutes, et aussi de la nécessité d’extirper dans la pratique l’aspiration même à de semblables mouvements.
V. — La tactique du communisme et la lutte social-démocrate
Il est cependant clair que contre les crises du mouvement il convient de lutter, non par des recherches historiques quelque bienfaisantes qu’elles soient, mais par des manifestations actives du prolétariat. Il est certain qu’il n’est pas question de « proclamations » à la Bettelheim, mais d’un travail obstiné d’organisation, de la création de groupements correspondants, de la lutte en masse quotidienne contre les crises chaque jour plus graves — lutte qui coopérera à l’accumulation de l’énergie latente du prolétariat autrichien, jusqu’au jour où la proclamation de la République des Soviets hongrois ne sera plus une simple boutade insurrectionnelle, mais l’expression réelle de la vie même.
Adler, qui se débat dans les filets de Renner, sait bien pourquoi il marche maintenant contre le « marais » du Parti Communiste. Il se trouve après la première année de révolution devant « l’épave » de sa politique qui, au reste, ne fut pas la sienne, mais celle de ses amis et de laquelle, malgré tout, il porte aussi la responsabilité. La démocratie (c’est-à-dire le « pouvoir populaire ») n’a été en fait que la domination insatiable du capital de l’Entente. La « socialisation » législative s’est terminée par l’achat de la société minière des Alpes par des capitalistes italiens, excellente affaire que M. Adler saupoudra d’une légère couche de « socialisation » ; le dossier de cette affaire pourrait être déposé dans les archives de la 2e Internationale avec cette inscription : « La socialisation démocratique du patrimoine national en Autriche allemande ou sa remise aux capitalistes de l’Entente ». Les Soviets de députés ouvriers, auxquels Adler chantait des hymnes enthousiastes, se préparent à une mort indolore. Quelles sont les causes de tout cela ?
Une crise effroyable que ces messieurs avaient prédite comme devant être la conséquence inévitable de la dictature des Soviets et qu’ils avaient voulu éviter au moyen de la coalition avec la bourgeoisie sévit en ce moment et est le résultat de leurs craintes pitoyables de toute lutte. Mais les masses ouvrières ne peuvent pas se détourner de la lutte. Elles souffrent de la faim et du froid et elles demanderont infailliblement : « Est-il possible que nous périssions sans résister ? » Les masses lutteront, elles marcheront dans notre voie. C’est ce que sait Adler qui s’est empêtré dans ses propres filets et comme il ne se sent plus la force de s’arracher à son propre marécage, il se met en devoir de dévoiler le marais communiste.
Mais le Parti Communiste n’a jamais rien caché et ne cachera rien. Il a pu commettre des fautes politiques, parce qu’il est jeune, et qu’il est obligé de chercher des voies nouvelles. Dans ses égarements il a pu rejaillir sur lui quelques éclaboussures. Mais il saura se blanchir ; l’avenir lui appartient, car il s’est engagé dans la lutte que dictent les exigences de ce moment historique. Le marais, c’est de l’eau stagnante ; nous irons donc en avant avec le torrent déchaîné de la révolution prolétarienne. Le docteur Adler nous a jeté une bombe à gaz empoisonné dont certains pourraient bien se trouver mal. Mais bientôt, après avoir enjambé cette vague empoisonnée, nous passerons à l’offensive et les masses nous suivront
Karl RADEK. Octobre 1919.
Notes
1 Il s’agit d’Ernö (ou Ernst) Bettelheim, membre du Comité Central du Parti Communiste Hongrois en 1919 et envoyé cette même année à Vienne sur les instructions de Béla Kun. Voir au sujet de l’insurrection viennoise, Révolution en Allemagne de Pierre Broué, chapitre XIII. (note de la MIA)
2 Diminutif de Friedrich. (Note de la MIA)
3 Karl Seitz (1869-1950). (Note de la MIA)
4 Karl Toman (1884-1950). (Note de la MIA)
5 Rinaldo Rinaldini, chef de brigands est un roman de l’écrivain allemand Christian August Vulpius paru en 1799. (Note de la MIA)
REVOLUTION HONGROISE
Le 21 mars 1919 on proclamait la République soviétique de Hongrie. Deux ans après la Russie, un pays relativement moderne, cette fois-ci, entamait ainsi la construction du socialisme. Méconnue, la Révolution hongroise fut pourtant originale et riche d’enseignements.
La Hongrie rouge
L’année 1918 marque l’étape finale de la décomposition de l’empire austro-hongrois. Allié de l’Allemagne, l’empire s’effondre sous les coups de la défaite militaire et de l’extension internationale du processus révolutionnaire initié en Russie. En janvier, 300.000 ouvriers hongrois se mettent en grève contre la guerre et la détérioration des conditions de vie. Les premiers soviets ouvriers font leur apparition tandis que des mutineries éclatent dans l’armée.
En octobre, les soldats refusent de monter au front et ceux qui s’y trouvent désertent en masse et affluent dans la capitale où les armes à la main, ils constituent le 29 octobre des Conseils de soldats. Le 31 octobre, sans pratiquement tirer un seul coup de feu, les Conseils de soldats et d’ouvriers renversent le régime. La monarchie est abolie et le mariage forcé avec l’Autriche est rompu. Le 16 novembre, la République de Hongrie est proclamée. Dans l’euphorie des premiers jours, on ne s’aperçois pas qu’une situation de dualité de pouvoir s’instaure entre le nouveau gouvernement, composé de bourgeois et de social-démocrates - et avec à sa tête le comte Karolyi - et les conseils d’ouvriers et de soldats. Le premier acte de la Révolution hongroise commence.
Faillite de la révolution bourgeoise
La Hongrie sort ruinée par la guerre et étranglée par le blocus imposé par les forces de l’Entente. Faute de matière première, les usines s’arrêtent et un chômage massif s’étend. Comme en Russie, le peuple veut la paix, la terre et le pain. Nationaliste et démocrate, Karolyi et son gouvernement tentent de liquider le féodalisme, d’instaurer un régime démocratique bourgeois, de mener une réforme agraire et de s’attirer la sympathie des puissances occidentales. Il échouera sur tous les tableaux. Les réformes démocratiques tardent à venir - la loi électorale date de 1848 et seuls 6,7% de la population peuvent voter. La réforme agraire est limitée et freinée par l’aristocratie terrienne - dont Karolyi lui-même est issu. Enfin, les puissances capitalistes occidentales n’ont que faire de cette « démocratie » hongroise. Face à la menace de contagion de la Révolution bolchévique, il faut encercler la Russie de pays dirigés par un pouvoir dictatorial capable d’écraser toute révolution intérieure. Les doux rêves de Karolyi n’entraient donc pas dans ces calculs. C’est pourquoi l’Entente poussa la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Serbie à envahir la Hongrie.
Vers une seconde révolution
L’année 1919 sera « l’année terrible » pour le capitalisme en Europe. Le Premier ministre britannique, Lloyd George, résume bien la situation en écrivant dans une note confidentielle : « L’ensemble de l’ordre social existant, dans ses aspects politiques, sociaux et économiques est mis en question par les masses de la population d’une extrémité à l’autre de l’Europe ». A Budapest, les manifestations se succèdent : les chômeurs s’organisent et les soldats réclament une indemnisation. Des soviets de tout genre éclosent : chez les paysans, parmi les étudiants, dans les quartiers, chez les notaires (!), etc. Même l’Eglise est traversée par un vent de contestation ; le bas clergé revendique la séparation intégrale de l’Eglise et de l’Etat ainsi que la fin du célibat des prêtres. Partout, l’exemple de la Révolution russe est dans les esprits. En janvier et février, dans plusieurs usines de la capitale, les ouvriers chassent les administrateurs et élisent les nouveaux « directeurs » parmi leurs rangs. Le 20 février, des paysans pauvres chassent quant à eux de grands propriétaires terriens et se partagent les terres. Le gouvernement est désemparé, ses ministres socialistes sont débordés par l’aile gauche de leur parti tandis que le jeune Parti des communistes gagne chaque jours plus d’audience et d’adhésions (il passe de 5.000 membres en novembre 1918 à 70.000 en 1919) et dispute la direction des soviets aux social-démocrates. Ses principales revendications font mouche : contrôle ouvrier et nationalisation de l’industrie ; expropriation des grands propriétaires terriens ; désarmement de la bourgeoisie est armement du prolétariat ; alliance révolutionnaire avec la Russie soviétique ; remise du pouvoir aux seuls conseils d’ouvriers, de soldats et de paysans. Le tout est résumé par la formule de dictature du prolétariat.
La bourgeoisie abdique !
La défaite de la Révolution allemande et l’assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht (le 15 janvier) poussent le gouvernement Karolyi, soutenu par l’aile droite du Parti social-démocrate, à réprimer les communistes. Le 21 février, suite à une provocation policière ; la direction du Parti est arrêtée ainsi que son leader, Bela Kun. La manoeuvre se retourne pourtant contre le gouvernement.
D’une part parce que le mouvement de masse s’accroît, tout comme la sympathie envers les communistes et d’autre part parce que l’Entente envoie, le 12 mars, un véritable ultimatum En échange de la paix, la Hongrie doit accepter d’être amputée de vastes territoires (les plus riches) en faveur de ses voisins roumains, tchèques et serbes. Pour la bourgeoisie et l’aristocratie démocrate nationaliste, c’est l’électrochoc. Le gouvernement rejette l’ultimatum mais ne peut mener aucune résistance armée.
La situation est sans issue. Aussi, le 20 mars, conscient que le mouvement ouvrier - seule force organisée de la nation - peut sauver l’intégrité territoriale avec l’aide du mouvement ouvrier international, le comte Karolyi propose de constituer un gouvernement social-démocrate homogène et d’entamer des négociations avec le Parti des communistes. Mais les social-démocrates de gauche, sous la pression des masses, vont plus loin. Ils négocient avec Bela Kun en prison et décident ensemble d’unifier les deux partis (qui s’appelera désormais Parti socialiste), de prendre le pouvoir en instaurant la dictature du prolétariat et d’organiser une armée rouge !
Les Conseils d’ouvriers et de soldats approuvent avec enthousiasme et donnent les pleins pouvoirs au nouveau Parti socialiste pour former un Conseil des Commissaires du peuple Le 21 mars, devant le fait accomplis, la bourgeoisie ne peut que se plier. Karolyi abdique par ces mots : « Je démissionne et je remets le pouvoir au prolétariat des peuples de Hongrie » ! Le même jour, on proclame la République soviétique hongroise. Tout comme en octobre, la Révolution de mars fut réalisée sans violence. Et fait unique dans l’histoire, la bourgeoisie a cédé le pouvoir sans résistance... parce qu’elle en était incapable à ce moment-là ! Les choses seront différentes par la suite...
La République soviétique hongroise La Révolution hongroise allait provoquer un immense espoir, non seulement parmi les masses de ce pays, mais également en Russie et parmi les travailleurs d’Europe. Pour la Russie, soviétique, cette victoire signifiait la fin de l’isolement et le signe tangible que la révolution mondiale avait démarrée. Le 21 mars, le Parti bolchévique était en congrès. La situation était grave : la guerre civile et la famine faisaient rage, la contre-révolution et l’intervention militaire étrangère menée par les capitalistes occidentaux menaçaient de toute part de renverser le pouvoir des soviets. Au début, Lénine crut que l’annonce de la victoire de la révolution en Hongrie était un bobard. Lorsqu’il fut convaincu de la véracité des faits, l’atmosphère pessimiste du congrès changea radicalement.
En Hongrie, le nouveau pouvoir entama la construction du socialisme ; la bourgeoisie fut expropriée de son pouvoir politique et économique, une réforme agraire est décrétée le 4 avril ; l’armée et la police furent dissoutes et remplacées par une armée rouges de volontaires ; de profondes mesures sociales et culturelles, analogues à celles de la Russie soviétique, sont prises (enseignement, égalité hommes-femmes, accès à la culture, droits sociaux, etc.).Mais le 20 avril, après un mois d’existence, on proclame « La révolution en danger ».
L’impérialisme, comprenant le danger mortel d’extension de la révolution vers l’ouest (vers l’Autriche et l’Allemagne) que représentaient les soviets hongrois, lance de nouveau à l’assaut les armées roumaines, à l’est, serbes, au sud et tchèques au nord. La nouvelle armée rouge ne peut résister au choc. Le 1er mai, les troupes roumaines ne sont plus qu’à une centaine de Km de Budapest. Dans un sursaut, les Conseils ouvriers décrètent la résistance et la mobilisation générale du prolétariat. En 6 jours, 40.000 ouvriers de la capitale montent au front : l’offensive impérialiste est brisée et reflue même, en Tchécoslovaquie notamment, où, sous l’avance de l’armée rouge hongroise, une République soviétique slovaque est proclamée. La fin Le 10 juin, l’Entente envoyait une proposition de paix à Budapest. Cette proposition impliquait le retrait de l’armée rouge en échange du retrait des troupes roumaines. Bela Kun, commissaire du peuple aux Affaires étrangères et leader de la révolution tente de manoeuvrer diplomatiquement pour gagner du temps. Mais en définitive, le 20 juillet, il refuse l’offre et pour tenter de relancer l’ardeur révolutionnaire des masses, il décide d’une nouvelle contre-offensive militaire. C’est que la dictature du prolétariat est en crise : Les masses sont affaiblies et déboussolées par les privations (la famine), par les erreurs du régime (le production est désorganisée) et par la division croissante au sein du Parti socialiste entre ses ailes gauche, centriste et droitière. Dans ce contexte, la contre-révolution intérieure relève la tête. Aristocrates et bourgeois complotent et provoquent des attentats contre le pouvoir des soviets.
Après quelques succès initiaux, l’armée rouge est battue et en fuite : les officiers ont saboté les ordres et les fournitures matérielles manquent. Le moral n’y est plus. Fin juillet, les troupes roumaines sont de nouveau aux portes de la capitale. Les social-démocrates de droite, soutenus par la puissante bureaucratie syndicale, exigèrent et obtinrent la démission du Conseil des commissaires du peuple. Un gouvernement dit « syndical » est constitué dont la volonté est de rétablir l’ordre social capitaliste et d’instaurer une démocratie bourgeoise de type occidentale pour séduire l’impérialisme et empêcher l’invasion du territoire.
Mais en vérité, il n’y avait pas de place pour une telle « alternative ». En supprimant la dictature du prolétariat au nom de la « démocratie » formelle, c’est à la dictature sanglante de la bourgeoisie qu’on ouvrait la porte. Ainsi, dès le 6 août, le gouvernement « syndical » est renversé par la contre-révolution, dont les troupes roumaines, qui font leur entrée à Budapest, servent de fer de lance. Un ancien amiral de la flotte austro-hongroise, Horthy, est mis au pouvoir par l’impérialisme et un régime pré (puis complètement) fasciste s’instaure. La répression est terrible : les communistes qui ne se sont pas exilés à temps sont traqués, emprisonnés, torturés et exécutés - il y eut 5.000 exécution et 75.000 arrestations en quelques semaines.
Quels enseignements ?
Les causes de l’échec de la Révolution hongroise furent multiples. La cause première est bien entendu l’agression impérialiste, facilitée par l’échec de la Révolution allemande. Mais la gestion du nouveau régime et la politique des dirigeants communistes fit le reste : « Bela Kun avait vu trois choses qui étaient d’une importance fondamentale pour une révolution hongroise : la révolution agraire, la lutte acharnée de Lénine contre les réformistes et les négociations de paix avec les Allemands à Brest-Litovsk.
De ces trois expériences, il semble avoir tiré les surprenants principes qu’il ne fallait pas donner la terre aux paysans, qu’il fallait à tout prix faire la guerre et qu’au moment décisif un révolutionnaire doit conclure une alliance avec les réformistes. ». En effet, la réforme agraire nationalisait les terres mais, au lieu de les distribuer aux paysans, les collectivisait en grands domaines dont la gestion fut souvent confiée aux anciens grands propriétaires ! L’insatisfaction des paysans n’allait donc pas les pousser à soutenir en masse la défense de la Révolution. Le chaos et la chute de la production industrielle fut renforcée par des mesures hâtives de socialisation.
Toute l’industrie ainsi que le petit commerce furent socialisés d’un seul coup, sans attendre que ce dernier dépérisse par lui-même, ce qui dressa la petite-bourgeoisie contre le régime. Si les communistes avaient eu raison de fusionner avec le Parti social-démocrate, ils n’auraient pas dû accepter que les membres de ce dernier prennent une place prépondérante dans le nouveau parti unifié ainsi qu’au Conseil des commissaire du peuple. De plus, le Parti unifié gardait les mêmes structures que l’ancien Parti social-démocrate, à savoir que chaque membre du syndicat était automatiquement membre du Parti. La démarcation en son sein avec les réformistes et avec les travailleurs non politisés et purement syndicaux ne se fit pas, ce qui démontre une incompréhension du rôle et de la nature du parti d’avant-garde révolutionnaire.
La jeunesse, le manque de maturité et la vision livresque du socialisme du Parti des communistes hongrois expliquent beaucoup de choses. Ils n’avaient pas, comme leurs frères russes, de longues années d’expérience derrière eux. Enfin, rajoutons que l’aide miliaire et économique de la Russie soviétique ne put avoir lieu. La région jouxtant les deux pays, l’Ukraine, était ravagée par la guerre civile et largement aux mains des « blancs ».
REVOLUTION PROLETARIENNE PUIS CONTRE-REVOLUTION EN ALLEMAGNE
« Ainsi, le parti de Lénine fut-il le seul en Russie à comprendre les intérêts véritables de la révolution dans cette première période, il en fut l’élément moteur en tant que seul parti qui pratiquât une politique réellement socialiste.
On comprend aussi pourquoi les bolcheviks, minorité bannie, calomniée et traquée de toutes parts au début de la révolution, parvinrent en très peu de temps à la tête du mouvement et purent rassembler sous leur drapeau toutes les masses réellement populaires : le prolétariat des villes, l’armée, la paysannerie, ainsi que les éléments révolutionnaires de la démocratie, l’aile gauche des socialistes révolutionnaires.
A l’issue de quelques mois, la situation réelle de la révolution se résumait dans l’alternative suivante : Victoire de la contre-révolution ou dictature du prolétariat, Kalédine ou Lénine. Toute révolution en arrive objectivement là une fois dissipée la première ivresse ; en Russie, c’était le résultat de deux questions brûlantes et concrètes, celle de la paix et celle de la terre qui ne pouvaient être résolues dans le cadre de la révolution bourgeoise.
En cela, la révolution russe n’a fait que confirmer l’enseignement fondamental de toute grande révolution, dont la loi vitale se formule ainsi : il lui faut avancer très rapidement et résolument, renverser d’une main de fer tous les obstacles, placer ses objectifs toujours plus loin, si elle ne veut pas être très bientôt ramenée à son fragile point de départ ni être écrasée par la contre-révolution. Une révolution ne peut pas stagner, piétiner sur place, se contenter du premier objectif atteint. En transposant les vérités terre à terre des guerres parlementaires à la petite semaine sur la tactique révolutionnaire, on fait tout juste preuve d’un manque de psychologie de la révolution, d’une méconnaissance profonde de ses lois vitales, toute expérience historique est alors un livre sept fois scellé.
Dans le déroulement de la révolution anglaise à partir du moment où elle a éclaté en 1642, comment, par la logique des choses, les tergiversations débiles des presbytériens, la guerre hésitante contre l’armée royaliste, au cours de laquelle les chefs presbytériens évitèrent délibérément une bataille décisive et une victoire contre Charles 1er, furent ce qui contraignit inéluctablement les Indépendants à les chasser du Parlement et à prendre le pouvoir. Et par la suite, il en fut de même au sein de l’armée des Indépendants : la masse subalterne et petite-bourgeoise des soldats, les « niveleurs » de Lilburn constituait les troupes de choc de tout le mouvement indépendant, et enfin les éléments prolétariens de la masse des soldats, ceux qui allaient le plus loin dans leurs perspectives de bouleversement social et s’exprimaient dans le mouvement des « diggers » représentaient pour leur part le levain du parti démocratique des « niveleurs ».
Si les éléments révolutionnaires prolétariens n’avaient pas agi sur l’esprit de la masse des soldats, si la masse démocratique des soldats n’avait exercé aucune pression sur la couche bourgeoise dirigeante du parti des Indépendants, le Long Parlement n’aurait pas été « nettoyé » des presbytériens, la guerre contre l’armée des Cavaliers et contre les Écossais n’aurait pas connu une issue victorieuse, Charles 1" n’aurait été ni jugé ni exécuté, la Chambre des Lords n’aurait pas été supprimée et la république n’aurait pas été proclamée.
Et la grande révolution française ? Après quatre ans de combat, la prise de pouvoir par les Jacobins s’avéra être le seul moyen susceptible de sauver les conquêtes de la révolution, de faire prendre corps à la république, de réduire le féodalisme en poussière, d’organiser la défense révolutionnaire à l’intérieur comme à l’extérieur, d’étouffer la conspiration de la contre-révolution, de propager la vague révolutionnaire française dans toute l’Europe.
Aucune révolution ne peut garder le « juste milieu », sa loi naturelle exige des décisions rapides : ou bien la locomotive grimpe la côte historique à toute vapeur jusqu’au bout, ou bien, entraînée par son propre poids, elle redescend la pente jusqu’au creux d’où elle était partie et elle précipite avec elle dans l’abîme, sans espoir de salut tous ceux qui, de leurs faibles forces, voulaient la retenir à mi-chemin. (...) Les bolcheviks ont aussitôt défini comme objectif à cette prise du pouvoir le programme révolutionnaire le plus avancé dans son intégralité ; il ne s’agissait pas d’assurer la démocratie bourgeoise mais d’instaurer la dictature du prolétariat pour réaliser le socialisme. Ils ont ainsi acquis devant l’histoire le mérite impérissable d’avoir proclame pour la première fois les objectifs ultimes du socialisme comme programme immédiat de politique pratique.
Tout le courage, l’énergie, la perspicacité révolutionnaire, la logique dont un parti révolutionnaire peut faire preuve en un moment historique a été le fait de Lénine, de Trotski et de leurs amis. Tout l’honneur et toute la faculté d’action révolutionnaires qui ont fait défaut à la social-démocratie occidentale, se sont retrouvés chez les bolcheviks. L’insurrection d’octobre n’aura pas seulement servi à sauver effectivement la révolution russe, mais aussi l’honneur du socialisme international. (...) A cet égard, Lénine, Trotski et leurs amis ont les premiers, par leur exemple, ouvert la voie au prolétariat mondial, ils sont jusqu’à présent encore les seuls qui puissent s’écrier comme Hutten :« J’ai osé » !
Voilà ce que la politique des bolcheviks comporte d’essentiel et de durable. En ce sens, ils conservent le mérite impérissable d’avoir ouvert la voie au prolétariat international en prenant le pouvoir politique et en posant le problème pratique de la réalisation du socialisme, d’avoir fait progresser considérablement le conflit entre capital et travail dans le monde entier. En Russie, le problème ne pouvait être que posé. Il ne pouvait être résolu en Russie. Et en ce sens, l’avenir appartient partout au ’’Bolchevisme’’. »
Rosa Luxemburg dans « La révolution russe » de Janvier 1918
« L’ordre règne à Berlin
« ( ..) Cette « Semaine Spartakiste » de Berlin, que nous a-t-elle apporté, que nous enseigne-t-elle ? Au cœur de la mêlée, au milieu des clameurs de triomphe de la contre-révolution, les prolétaires révolutionnaires doivent déjà faire le bilan des événements, les mesurer, eux et leurs résultats, au grand étalon de l’histoire. La révolution n’a pas de temps à perdre, elle poursuit sa marche en avant, - par-dessus les tombes encore ouvertes, par-delà les « victoires » et les « défaites » - vers ses objectifs grandioses. Et le premier devoir de ceux qui luttent pour le socialisme internationaliste, c’est d’étudier avec lucidité sa marche et ses lignes de force. Pouvait-on s’attendre, dans le présent affrontement, à une victoire décisive du prolétariat révolutionnaire, pouvait-on escompter la chute des Ebert-Scheidemann et l’instauration de la dictature socialiste ? Certainement pas, si l’on fait entrer en ligne de compte tous les éléments qui décident de la réponse. Il suffit de mettre le doigt sur ce qui est à l’heure actuelle la plaie de la révolution : le manque de maturité politique de la masse des soldats qui continuent de se laisser abuser par leurs officiers et utiliser à des fins contre-révolutionnaires est à lui seul la preuve que, dans ce choc-ci, une victoire durable de la révolution n’était pas possible. D’autre part, ce manque de maturité n’est lui-même que le symptôme du manque général de maturité de la révolution allemande. (...) Mais ce qui fait défaut, c’est la coordination de la marche en avant, l’action commune qui donnerait aux coups de boutoir et aux ripostes de la classe ouvrière berlinoise une tout autre efficacité. Ensuite - et c’est de cette cause plus profonde que proviennent ces imperfections politiques - les luttes économiques, ce volcan qui alimente sans cesse la lutte de classe révolutionnaire, ces luttes économiques n’en sont encore qu’à leur stade initial. (...) De cette contradiction entre la tâche qui s’impose et l’absence, à l’étape actuelle de la révolution, des conditions préalables permettant de la résoudre, il résulte que les luttes se terminent par une défaite formelle. Mais la révolution est la seule forme de « guerre » - c’est encore une des lois de son développement - où la victoire finale ne saurait être obtenue que par une série de « défaites ». Que nous enseigne toute l’histoire des révolutions modernes et du socialisme ? La première flambée de la lutte de classe en Europe s’est achevée par une défaite. Le soulèvement des canuts de Lyon, en 1831, s’est soldé par un lourd échec. Défaite aussi pour le mouvement chartiste en Angleterre. Défaite écrasante pour la levée du prolétariat parisien au cours des journées de juin 1848. La Commune de Paris enfin a connu une terrible défaite. La route du socialisme - à considérer les luttes révolutionnaires - est pavée de défaites. Et pourtant cette histoire mène irrésistiblement, pas à pas, à la victoire finale ! Où en serions-nous aujourd’hui sans toutes ces « défaites », où nous avons puisé notre expérience, nos connaissances, la force et l’idéalisme qui nous animent ? Aujourd’hui que nous sommes tout juste parvenus à la veille du combat final de la lutte prolétarienne, nous sommes campés sur ces défaites et nous ne pouvons renoncer à une seule d’entre elles, car de chacune nous tirons une portion de notre force, une partie de notre lucidité. Les combats révolutionnaires sont à l’opposé des luttes parlementaires. En Allemagne, pendant quatre décennies, nous n’avons connu sur le plan parlementaire que des « victoires » ; nous volions littéralement de victoire en victoire. Et quel a été le résultat lors de la grande épreuve historique du 4 août 1914 : une défaite morale et politique écrasante, un effondrement inouï, une banqueroute sans exemple. Les révolutions par contre ne nous ont jusqu’ici apporté que défaites, mais ces échecs inévitables sont précisément la caution réitérée de la victoire finale. A une condition il est vrai ! Car il faut étudier dans quelles conditions la défaite s’est chaque fois produite. Résulte-t-elle du fait que l’énergie des masses est venue se briser contre la barrière des conditions historiques qui n’avaient pas atteint une maturité suffisante, ou bien est-elle imputable aux demi-mesures, à l’irrésolution, à la faiblesse interne qui ont paralysé l’action révolutionnaire ? (...) La direction a été défaillante. Mais on peut et on doit instaurer une direction nouvelle, une direction qui émane des masses et que les masses choisissent. Les masses constituent l’élément décisif, le roc sur lequel on bâtira la victoire finale de la révolution. Les masses ont été à la hauteur de leur tâche. Elles ont fait de cette « défaite » un maillon dans la série des défaites historiques, qui constituent la fierté et la force du socialisme international. Et voilà pourquoi la victoire fleurira sur le sol de cette défaite. « L’ordre règne à Berlin ! » sbires stupides ! Votre « ordre » est bâti sur le sable. Dès demain la révolution « se dressera de nouveau avec fracas » proclamant à son de trompe pour votre plus grand effroi. » Rosa Luxemburg dans « J’étais, je suis, je serai ! »
En 1919, peu après la défaite de la révolution à Berlin et peu avant l’assassinat de Rosa Luxemburg par les corps francs, fascistes armés et organisés par les dirigeants socialistes comme Ebert alliés à l’Etat Major de l’armée.
1919 Première publication le 18 janvier 1919, première parution française à Paris en mars 1920, dans la Revue Communiste, éditions de L’Internationale Communiste. Texte transcrit à partir d’un exemplaire du Bulletin Communiste.
Œuvres - janvier 1919 Léon Trotsky
Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg
L’inflexible Karl Liebknecht
Nous venons d’éprouver la plus lourde perte. Un double deuil nous atteint. Deux chefs ont été brutalement enlevés, deux chefs dont les noms resteront à jamais inscrits au livre d’or de la révolution prolétarienne : Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Le nom de Karl Liebknecht a été universellement connu dès les premiers jours de la grande guerre européenne. Dans les premières semaines de cette guerre, au moment où le militarisme allemand fêtait ses premières victoires, ses premières orgies sanglantes, où les armées allemandes développaient leur offensive en Belgique, détruisaient les forteresses belges, où les canons de 420 millimètres promettaient, semble-t-il, de mettre tout l’univers aux pieds de Guillaume II, au moment où la social-démocratie officielle, Scheidemann et Ebert en tête , s’agenouillait devant le militarisme allemands et l’impérialisme allemands auxquels tout semblait se soumettre - le monde extérieur avec la France envahie au nord et le monde intérieur non seulement avec la caste militaire et la bourgeoisie, mais aussi avec les représentants officiels de la classe ouvrière - dans ces sombres et tragiques journées, une seule voix s’éleva en Allemagne pour protester et pour maudire : celle de Karl Liebknecht. Et cette voix retentit par le monde entier .En France, où l’esprit des masses ouvrières se trouvait alors sous la hantise de l’occupation allemande où le parti des social-patriotes au pouvoir prêchait une lutte sans trêve ni merci contre l’ennemi qui menaçait Paris, la bourgeoisie et les chauvins eux-mêmes reconnurent que seul Liebknecht faisait exception aux sentiments qui animaient le peuple allemand tout entier. Liebknecht, en réalité, n’était déjà plus isolé : Rosa Luxemburg , femme du plus grand courage, luttait à ses côtés, bien que les lois bourgeoises du parlementarisme allemand ne lui aient pas permis de jeter sa protestation du haut de la tribune, ainsi que l’avait fait Karl Liebknecht. Il convient de remarquer qu’elle était secondée par les éléments les plus conscients de la classe ouvrière, où la puissance de sa pensée et de sa parole avaient semé des germes féconds. Ces deux personnalités, ces deux militants, se complétaient mutuellement et marchaient ensemble au même but. Karl Liebknecht incarnait le type du révolutionnaire inébranlable dans le sens le plus large de ce mot. Des légendes sans nombre se tissaient autour de lui, entourant son nom de ces renseignements et de ces communications dont notre presse était si généreuse au temps où elle était au pouvoir. Karl Liebknecht était - hélas ! nous ne pouvons plus en parler qu’au passé - dans la vie courante, l’incarnation même de la bonté et de l’amitié. On peut dire que son caractère était d’une douceur toute féminine, dans le meilleur sens de ce mot, tandis que sa volonté de révolutionnaire, d’une trempe exceptionnelle, le rendait capable de combattre à outrance au nom des principes qu’il professait. Il l’a prouvé en élevant ses protestations contre les représentants de la bourgeoisie et des traîtres social-démocrates du Reichstag allemand, où l’atmosphère était saturée des miasmes du chauvinisme et du militarisme triomphants. Il l’a prouvé lorsque, il leva, sur la place de Potsdam, à Berlin, l’étendard de la révolte contre les Hohenzollern et le militarisme bourgeois. Il fut arrêté. Mais ni la prison, ni les travaux forcés n’arrivèrent à briser sa volonté et, délivré par la révolution de novembre, Liebknecht se mit à la tête des éléments les plus valeureux de la classe ouvrière allemande . Rosa Luxemburg - Puissance de ses idées.
Le nom de Rosa Luxemburg est moins connu dans les autres pays et en Russie, mais on peut dire, sans craindre d’exagérer, que sa personnalité ne le cède en à celle de Liebknecht. Petite de taille, frêle et maladive, elle étonnait par la puissance de sa pensée . J’ai dit que ces deux leaders se complétaient mutuellement. L’intransigeance et la fermeté révolutionnaire de Liebknecht se combinaient avec une douceur et une aménité féminines, et Rosa Luxemburg, malgré sa fragilité, était douée d’une puissance de pensée virile. Nous trouvons chez Ferdinand Lassalle des appréciations sur le travail physique de la pensée et sur la tension surnaturelle dont l’esprit humain est capable pour vaincre et renverser les obstacles matériels ; telle était bien l’impression de puissance que donnait Rosa Luxemburg lorsqu’elle parlait à la tribune, entourée d’ennemis. Et ses ennemis étaient nombreux. Malgré sa petite taille et la fragilité de toute sa personne, Rosa Luxemburg savait dominer et tenir en suspens un large auditoire, même hostile à ses idées. Par la rigueur de sa logique, elle savait réduire au silence ses ennemis les plus résolus, surtout lorsque ses paroles s’adressaient aux masses ouvrières.
Ce qui aurait pu arriver chez nous pendant les journées de juillet
Nous savons trop bien comment procède la réaction pour organiser certaines émeutes populaires. Nous nous souvenons tous des journées que nous avons vécues en juillet dans le murs de Petrograd, alors que les bandes noires rassemblées par Kérensky et Tseretelli contre les bolcheviks organisaient le massacre des ouvriers, assommant les militants, fusillant et passant au fil de la baïonnette les ouvriers isolés surpris dans la rue. Les noms des martyrs prolétariens, tel celui de Veinoff, sont encore présents à l’esprit de la plupart d’entre nous. Si nous avons conservé alors Lénine, si nous avons conservé Zinoviev, c’est qu’ils ont su échapper aux mains des assassins. Il s’est trouvé alors parmi les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires des voix pour reprocher à Lénine et à Zinoviev de se soustraire au jugement, tandis qu’il leur eût été si facile de se laver de l’accusation élevée contre eux, et qui les dénonçait comme des espions allemands. De quel tribunal voulait-on parler ? De celui probablement auquel on mena plus tard Liebknecht, et à mi-chemin duquel Lénine et Zinoviev auraient été fusillés pour tentative d’évasion ? Telle aurait été sans nul doute la déclaration officielle. Après la terrible expérience de Berlin, nous avons tout lieu de nous féliciter de ce que Lénine et Zinoviev se soient abstenus de comparaître devant le tribunal du gouvernement bourgeois.
Aberration historique
Perte irréparable, trahison sans exemple ! Les chefs du parti communiste allemand ne sont plus. Nous avons perdu les meilleurs de nos frères, et leurs assassins demeurent sous le drapeau du parti social-démocrate qui a l’audace de commencer sa généalogie à Karl Max ! Voilà ce qui se passe, camarades ! Ce même parti, qui a trahi les intérêts de la classe ouvrière dès le début de la guerre, qui a soutenu le militarisme allemand, qui a encouragé la destruction de la Belgique et l’envahissement des provinces françaises du Nord, ce parti dont les chefs nous livraient à nos ennemis les militaristes allemands aux jours de la paix de Brest-Litovsk ; ce parti et ses chefs - Scheidemann et Ebert - s’intitulent toujours marxistes tout en organisant les bandes noires qui ont assassiné Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg ! Nous avons déjà été les témoins d’une semblable aberration historique, d’une semblable félonie historique, car le même tour a déjà été joué avec le christianisme. Le christianisme évangélique, idéologie de pêcheurs opprimés, d’esclaves, de travailleurs écrasés par la société idéologie du prolétariat , n’a-t-il pas été accaparé par ceux qui monopolisaient la richesse par les rois, les patriarches et les papes ? Il est hors de doute que l’abîme qui sépare le christianisme primitif tel qu’il surgit de la conscience du peuple et des bas-fonds de la société, est séparé du catholicisme et des théories orthodoxes par un abîme tout aussi profond que celui qui s’est maintenant creusé entre les théories de Marx, fruits purs de la pensée et des sentiments révolutionnaires, et les résidus d’idées bourgeoises dont trafiquent les Scheidemann et les Ebert de tous les pays. Le sang des militants assassinés crie vengeance !
Camarades ! Je suis convaincu que ce crime abominable sera le dernier sur la liste des forfaits commis par les Scheidemann et les Ebert. Le prolétariat a supporté longtemps les iniquités de ceux que l’histoire a placés à sa tête ; mais sa patience est à bout et ce dernier crime ne restera pas impuni. Le sang de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg crie vengeance ; il fera parler les pavés des rues de Berlin et ceux de la place de Potsdam, où Karl Liebknecht a le premier levé l’étendard de la révolte contre les Hohenzollern. Et ces pavés - n’en doutez pas - serviront à ériger de nouvelles barricades contre les exécuteurs de basses œuvres, les chiens de garde de la société bourgeoise - contre les Scheidemann et les Ebert !
La lutte ne fait que commencer
Scheidemann et Ebert ont étouffé, pour un moment, le mouvement Spartakiste (communistes allemands) ; ils ont tué deux des meilleurs chefs de ce mouvement et peut-être fêtent-ils encore à l’heure qu’il est leur victoire ; mais cette victoire est illusoire, car il n’y a pas encore eu, en fait, d’action décisive. Le prolétariat allemand ne s’est pas encore soulevé pour conquérir le pouvoir politique. Tout ce qui a précédé les événements actuels n’a été de sa part qu’une puissante reconnaissance pour découvrir les positions de l’ennemi. Ce sont les préliminaires de la bataille, mais ce n’est pas encore la bataille même. Et ces manœuvres de reconnaissance étaient indispensables au prolétariat allemand, de même qu’elles nous étaient indispensables dans les journées de Juillet. Le rôle historique des journées de juillet
Vous connaissez le cours des événements et leur logique intérieure. A la fin de février 1917 (ancien style), le peuple avait renversé l’autocratie, et pendant les premières semaines qui suivirent, il sembla que l’essentiel était accompli. Les hommes de nouvelle trempe qui surgissent des autres partis - des partis qui n’avaient jamais joué chez nous un rôle dominant - ces hommes jouirent au début de la confiance ou plutôt de la demi-confiance des masses ouvrières. Mais Petrograd se trouvait comme il le fallait - à la tête du mouvement ; en février, comme en juillet, il représentait l’avant-garde appelant les ouvriers à une guerre déclarée contre le gouvernement bourgeois, contre les ententistes, c’est cette avant-garde qui accomplit les grandes manœuvres de reconnaissance. Elle se heurta précisément, dans les journées de juillet, au gouvernement de Kérensky. Ce ne fut pas encore la révolution, telle que nous l’avons accomplie en octobre : ce fut une expérience dont le sens n’était pas encore clair à ce moment à l’esprit des masses ouvrières. Les travailleurs de Petrograd s’étaient bornés à déclarer la guerre de Kérensky ; mais dans la collision qui eut lieu, ils purent se convaincre et prouver aux masses ouvrières du monde entier qu’aucune force révolutionnaire réelle ne soutenait Kérensky et que son parti était composé des forces réunies de la bourgeoisie, de la garde blanche et de la contre-révolution. Comme il vous en souvient, les journées de juillet se terminèrent pour nous par une défaite au sens formel de ce mot : les camarades Lénine et Zinoviev furent contraints de se cacher. Beaucoup d’entre nous furent emprisonnés ; nos journaux furent bâillonnés, le soviet des députés ouvriers et soldats réduit à l’impuissance, les typographies ouvrières saccagées, les locaux des organisations ouvrières mis sous scellés ; les bandes noires avaient tout envahi, tout détruit. Il se passait à Petrograd exactement ce qui s’est passé en janvier 1919 dans les rues de Berlin ; mais pas in instant nous n’avons douté alors de ce que les journées de juillet ne seraient que le prélude de notre victoire. Ces journées nous ont permis d’évaluer le nombre et la composition des forces de l’ennemi ; elles ont démontré avec évidence que le gouvernement de Kérensky et de Tseretelli représentait en réalité un pouvoir au service des bourgeois et des gros propriétaires contre-révolutionnaires.
Les mêmes faits se sont produits à Berlin
Des événements analogues ont eu lieu à Berlin. A Berlin, comme à Petrograd, le mouvement révolutionnaire a devancé celui des masses ouvrières arriérées. Tout comme chez nous, les ennemis de la classe ouvrière criaient : " Nous ne pouvons pas nous soumettre à la volonté de Berlin ; Berlin est isolé ; il faut réunir une Assemblée Constituante et la transporter dans une ville provinciale de traditions plus saines. Berlin est perverti par la propagande de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg ! " Tout ce qui a été entrepris dans ce sens chez nous, toutes les calomnies et toute la propagande contre-révolutionnaire que nous avons entendues ici, tout cela a été répandu en traduction allemande par Scheidemann et Ebert contre le prolétariat berlinois et contre les chefs du Parti communiste, Liebknecht et Rosa Luxemburg . Il est vrai que cette campagne de reconnaissances a revêtu en Allemagne des proportions plus larges que chez nous, mais cela s’explique par le fait que les Allemands répètent une manœuvre qui a déjà été accomplie une fois chez nous ; de plus, les antagonismes de classes sont plus nettement établis chez eux. Chez nous, camarades, quatre mois se sont écoulés entre la révolution de février et les journées de juillet. Il a fallu quatre mois au prolétariat de Petrograd pour éprouver la nécessité absolue de descendre dans la rue afin d’ébranler les colonnes qui servaient d’appui au temple de Kérensky et de Tseretelli. Quatre mois se sont écoulés après les journées de juillet avant que les lourdes réserves de la province arrivassent à Petrograd, nous permettant de compter sur une victoire certaine et de monter à l’assaut des positions de la classe ennemie en octobre 1917 ou en novembre, nouveau style). En Allemagne où la première explosion de la révolution a eu lieu en novembre, les événements correspondant à nos journées de juillet la suivent déjà au début de janvier. Le prolétariat allemand accomplit sa révolution selon un calendrier plus serré. Là où il nous a fallu quatre mois, il ne lui en faut plus que deux. Et nul doute que cette mesure proportionnelle se poursuivra jusqu’au bout. Des journées de juillet allemandes à l’octobre allemand il ne se passera peut-être pas quatre mois comme chez nous ; Il ne se passera peut-être pas deux mois. Et les coups de feu tirés dans le dos de Karl Liebknecht ont, n’en doutez pas, réveillé de puissants échos par toute l’Allemagne. Et ces échos ont dû sonner comme un glas funèbre aux oreilles des Scheidemann et des Ebert. Nous venons ici de chanter le Requiem pour Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Nos chefs ont péri. Nous ne les reverrons plus. Mais combien d’entre vous camarades, les ont-ils approchés de leur vivant ? Une minorité insignifiante. Et néanmoins, Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg ont toujours été présents parmi vous. Dans vos réunions, dans vos congrès vous avez souvent élu Karl Liebknecht président d’honneur . Absent, il assistait à vos réunions, il occupait la place d’honneur à votre table. Car le nom de Karl Liebknecht ne désigne pas seulement une personne déterminée et isolée, ce nom incarne pour nous tout ce qu’il y a de bon, de noble et de grand dans la classe ouvrière, dans son avant-garde révolutionnaire. C’est tout cela que nous voyons en Karl Liebknecht. Et quand l’un d’entre nous voulait se représenter un homme invulnérablement cuirassé contre la peur et la faiblesse ; un homme qui n’avait jamais failli - nous nommons Karl Liebknecht. Il n’était pas seulement capable de verser son sang (ce n’est peut-être pas le trait le plus grand de son caractère), il a osé lever la voix au camp de nos ennemis déchaînés, dans une atmosphère saturée des miasmes du chauvinisme, alors que toute la société allemande gardait le silence et que la militarisme primait. Il a osé élever la voix dans ces conditions et dire ceci : " Kaiser, généreux, capitalistes et vous - Scheidemann qui étouffez la Belgique, qui dévastez le nord de la France, qui voulez dominer le monde entier - je vous méprise, je vous hais, je vous déclare la guerre et cette guerre je la mènerai jusqu’au bout. Camarades si l’enveloppe matérielle de Liebknecht a disparu, sa mémoire demeure et demeurera ineffaçable ! Mais avec le nom de Karl Liebknecht celui de Rosa Luxemburg se conservera à jamais dans les fastes du mouvement révolutionnaire universel. Connaissez-vous l’origine des légendes des saints et de leur vie éternelle ? Ces légendes reposent sur le besoin qu’éprouvent les hommes de conserver la mémoire de ceux qui, placés à leur tête, les ont servis dans le bien et la vérité ; elles reposent sur le besoin de les immortaliser en les entourant d’une auréole de pureté. Camarades, les légendes sont superflues pour nous ; nous n’avons nul besoin de canoniser nos héros - la réalité des événements que nous vivons actuellement nous suffit, car cette réalité est par elle-même légendaire. Elle éveille une puissance légendaire dans l’âme de nos chefs, elle crée des caractères qui s’élèvent au-dessus de l’humanité. Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg vivront éternellement dans l’esprit des hommes. Toujours, dans toutes les réunions où nous évoquions Liebknecht nous avons senti sa présence et celle de Rosa Luxemburg avec une netteté extraordinaire - presque matérielle. Nous la sentons encore, à cette heure tragique, qui nous unit spirituellement avec les plus nobles travailleurs d’Allemagne, d’Angleterre et du monde entier tous accablés par le même deuil, par la même immense douleur. Dans cette lutte et dans ces épreuves nos sentiments aussi ne connaissent pas de frontières.
Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont nos frères spirituels
Liebknecht n’est pas à nos yeux un leader allemand, pas plus que Rosa Luxemburg n’est une socialiste polonaise qui s’est mise à la tête des ouvriers allemands... Tous deux sont nos frères ; nous sommes unis à eux par des liens moraux indissolubles. Camarades ! cela nous ne répéterons jamais assez car Liebknecht et Rosa Luxemburg avaient des liens étroits avec le prolétariat révolutionnaire russe. La demeure de Liebknecht à Berlin était le centre de ralliement de nos meilleurs émigrés. Lorsqu’il s’agissait de protester au parlement allemand ou dans la presse allemande contre les services que rendaient les impérialistes allemands à la réaction russe c’est à Karl Liebknecht que nous nous adressions. Il frappait à toutes les portes et agissait sur tous les cerveaux - y compris ceux de Scheidemann et d’Ebert - pour les déterminer à réagir contre les crimes de l’impérialisme. Rosa Luxemburg avait été à la tête du parti social-démocrate polonais qui forme aujourd’hui avec le parti socialiste le Parti Communiste. En Allemagne, Rosa Luxemburg avait, avec le talent qui la caractérisait, approfondi la langue et la vie politique du pays ; elle occupa bientôt un poste de plus en vue dans l’ancien parti social-démocrate. En 1905, Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg prirent part à tous les événements de la révolution russe. Rosa Luxemburg fut même arrêtée en sa qualité de militante active puis relâchée de la citadelle de Varsovie sous caution ; c’est alors qu’elle vint illégalement (1906) à Petrograd où elle fréquenta nos milieux révolutionnaires, visitant dans les prisons ceux d’entre nous qui étaient alors détenus et nous servant dans le sens le plus large de ce mot d’agent de liaison avec le monde socialiste d’alors. Mais en plus de ces relations toutes personnelles, nous gardons de notre communion morale avec elle - de cette communion que crée la lutte au nom des grands principes et des grands espoirs - le plus beau souvenir. Nous avons partagé avec elle le plus grand des malheurs qui aient atteint la classe ouvrière universelle - la banqueroute honteuse de la IIe Internationale, au mois d’août 1914. Et c’est avec elle encore que les meilleurs d’entre nous ont élevé le drapeau de la IIIe Internationale et l’ont tenu fièrement dressé sans faillir un seul instant. Aujourd’hui, camarades, dans la lutte que nous poursuivons, nous mettons en pratique les préceptes de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg. Ce sont leurs idées qui nous animent quand nous travaillons, dans Petrograd sans pain et sans feu , à la construction du nouveau régime soviétiste ; et quand nos armées avancent victorieusement sur tous les fronts c’est encore l’esprit de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg qui les anime. A Berlin, l’avant-garde du Parti Communiste n’avait pas encore pour se défendre de forces puissamment organisées ; elle n’avait pas encore d’armée rouge comme nous n’en avions pas dans les journées de juillet quand la première vague d’un mouvement puissant mais organisé fut brisée par des bandes organisées quoique peu nombreuses. Il n’y a pas encore d’armée rouge en Allemagne mais il y a une en Russie ; l’armée rouge est un fait ; elle s’organise et croît en nombre tous les jours. Chacun de nous se fera un devoir d’expliquer aux soldats comment et pourquoi ont péri Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg ce qu’ils étaient et quelle place leur mémoire doit occuper dans l’esprit de tout soldat, de tout paysan ; ces deux héros sont entrés à jamais dans notre panthéon spirituel. Bien que le flot de la réaction ne cesse de monter en Allemagne, nous ne doutons pas un instant que l’octobre rouge n’y soit proche. Et nous pouvons bien dire en nous adressant à l’esprit des deux grands défunts : Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, vous n’êtes plus de ce monde, mais vous restez parmi nous ; nous allons vivre et lutter sous le drapeau de vos idées, dans l’auréole de votre charme moral et nous jurons si notre heure vient, de mourir debout face à l’ennemi comme vous l’avez fait, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht.
LA REPUBLIQUE DES CONSEILS DE BAVIERE
Les Conseils ouvriers en Bavière René Furth
La "République des conseils de Bavière" n’a dure que trois semaines, et sa zone d’influence effective n’a pas dépassé la région comprise entre Munich, Augsbourg et Rosenheim. Mais l’existence des Conseils munichois s’étend sur une durée de six mois, de novembre 1918 au 1er mai 1919. Aucun ouvrage d’ensemble n’a été consacré a leur histoire, qui fait partie encore du "refoulé" allemand. Les historiens de la "Révolution Allemande" n’évoquent que très accessoirement la tentative bavaroise, ou les Spartakistes ne jouent qu’au tout dernier moment un rôle prédominant.
Deux facteurs particuliers caractérisent la situation en Bavière : une population rurale plus importante que dans le reste de l’Empire (51 % contre une moyenne générale de 34 %, selon les statistiques de 1907) un séparatisme commun s toute la population, le militarisme prussien étant considéré à la fois comme le principal responsable de la guerre et comme l’incarnation parfaite d’un centralisme autoritaire et envahissant. Le séparatisme bavarois s’est cependant révélé comme une arme à double tranchant la bourgeoisie ne tardera pas à l’utiliser contre les "étrangers" (juifs de surcroît) qui sont venus semer la pagaille en Bavière.
1) LE DOUBLE POUVOlR
Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1918, après une manifestation de masse organisés dans l’après-midi par le parti social-démocrate indépendant, la République est proclamée. Un Conseil provisoire des ouvriers, des soldats et des paysans est constitué. Le roi, Louis III de Bavière, apprenant qu’aucun régiment ne tirera sur les rebelles, a quitté Munich.
Le président du Conseil provisoire, Kurt EISNER, est un journaliste et écrivain originaire de Berlin, animateur du Parti social-démocrate indépendant (U. S. P. D.) de Bavière. En février 1918, il a été condamné à la prison comme principal instigateur de la grève de la métallurgie (fin janvier). L’espoir d’EISNER, c’est qu’une Bavière démocratique subira moins durement les exigences de l’Entente victorieuse.
EISNER forme un nouveau gouvernement comprenant quatre social-démocrates "majoritaires" (S.P.D.), deux indépendants, un non-affilié. Il annonce en même temps la convocation d’une Assemblés constituante. Fonctionnaires et employés, à la demande du nouveau gouvernement ; se mettent à sa disposition. D’emblée, EISNER proclame le respect de la propriété privée et refuse toute socialisation. Il se montre préoccupé surtout du rôle respectif de l’Assemblée qu’il veut susciter et des Conseils, dans lesquels il voit essentiellement un organe de contrôle et une école de démocratie active. La ligne de partage se fera bientôt entre partisans du parlementarisme et partisans des conseils, le refus de l’Assemblée devenant un des principaux mots d’ordre des éléments les plus radicaux. En fait, il n’y aura jamais coexistence réelle des deux pouvoirs. L’alternative, Conseils ou Parlement, se pose d’ailleurs dans tout l’Empire. Le premier congrès des Conseils d’ouvriers et de soldats (du 16 au 21 décembre i918 à Berlin), à forte majorité S. P. D. se prononce pour une Assemblée nationale. En Bavière, EISNER cherche à mettre sur pied une formule de synthèse, "Conseils et Parlement". Il juge qu’il n’a pas derrière lui des forces populaires suffisantes pour imposer les Conseils, et il sait en même temps qu’un régime strictement parlementaire l’éliminerait du pouvoir. Les élections sont fixées au 12 janvier 1919 (l’Assemblée nationale de Weimar doit être élue le 19) ; Le parti d’EISNER ne recueille que 3 mandats sur 156 (S.P.D. et Ligue paysanne 68 ; Parti démocrate 27 ; Parti populaire bavarois, le plus réactionnaire 38). Les communistes (un groupe Spartakiste s’est formé le 6 décembre) se prononcent pour le boycottage des élections, de même que le Conseil ouvrier révolutionnaire, dont un des animateurs est l’anarchiste Erich MUHSAM. Le 10 janvier, EISNER fait d’ailleurs arrêter douze membres du Parti communiste et du Conseil révolutionnaire, dont Max LEVIEN et MUHSAM. Une manifestation spontanée les fait libérer.
Dès que les résultats des élections sont connus, le S.P.D. et les partis de droite demandent à EISNER de se retirer.
Le 16 février, une nouvelle manifestation de masse, préparée. sur l’initiative du Conseil ouvrier révolutionnaire, exige tout le pou-voir pour les conseils. Le 21, EISNER se rend à la première réunion du Landtag (le Parlement de Bavière) pour présenter se démission de président du ministère. Il est assassiné à coups de revolver dans la rue par un jeune aristocrate. Le lendemain, l’état de siège est décrété à Munich les journaux sont occupés et suspendus pendant dix jours, La situation devient de plus en plus confuse au niveau des institutions qui sont censées exercer le pouvoir. Le landtag se disperse. Un Conseil révolutionnaire central se constitue : il est composé de représentants des conseils et du Conseil ouvrier révolutionnaire, d’un représentant des syndicats et d’un représentant du S.P.D. Le congrès des Conseils bavarois continue de fonctionner parallèlement à ce Conseil central ; il élit le 5 mars un nouveau gouvernement qui n’aura pas l’occasion de se manifester. De plus, à la suite d’un accord intervenu entre social-démocrates majoritaires et indépendants, le Congrès décide de remettre ses pouvoirs au Landtag, qui doit se réunir à nouveau la 17 mars. Cette réunion peut avoir lieu, et le Landtag met en place un ministère présidé par le social-démocrate HOFFMANN, dont la tâche essentielle sera par la suite la liquidation et la répression de la République des conseils.
En fait, pendant 45 jours, aucun pouvoir n’arrive à se faire reconnaître ni à se donner les moyens d’agir. C’est le Conseil central qui s’oppose le plus résolument au gouvernement HOFFMMAN, dénoncé dès sa formation comme un instrument de la réaction. Les communistes, représentés au Conseil central, restent dans l’expectative et s’opposent à ceux qui réclament la proclamation d’une République des conseils (Max LEVIEN, pourtant, s’était prononcé en ce sens après l’assassinat d’EISNER). Les liens des communistes munichois avec les instances centrales à Berlin semblent avoir été lâches. Leurs principaux représentants sont Max LEVIEN et Eugen LEVINE, deux émigrés russes, anciens socialistes révolutionnaires qui ont quitté leur pays après la révolution da 1905. LEVINE, un des fondateurs du K. P, D., est venu de Berlin à Munich début mars pour réorganiser la rédaction du "Drapeau Rouge" et le parti. C’est sous son influence que les communistes munichois renonceront à réclamer comme premier objectif l’instauration d’une République des conseils,
L’armée reste la force la plus stable. Le 1er mars, une "résolution des délégués des casernes munichoises" a assuré le commandant militaire de la ville de la confiance des différents corps de troupe. Le S.P.D. fait bloc avec l’autorité militaire (qui proclame son attachement au "vrai socialisme") en attendant qu’une solution parlementaire redevienne possible. La seule opposition organisée contre les conseils est menée par la "société Thule", groupement d’extrême droite où militent de futurs chefs de file nazis.
2) "LES REPUBLIOUES DES CONSEILS"
La stagnation devient de plus en plus manifeste. Depuis les élections, plus aucun passage "légal" au socialisme n’est envisageable ; la République déçoit le prolétariat munichois, qui commence à exiger qu’à la révolution politique suive la révolution sociale. L’idée d’une République des conseils se répand. Dans les premiers jours d’avril, les conseils empêchent le Landtag de se réunir. Le 5, les différentes assemblées prennent des résolutions en faveur de la République des conseils.
Elle est proclamée dans la nuit du 6 au 7 par le Conseil central, avec l’accord du S. P. D., des indépendants, des syndicats et de la Ligue paysanne. Les atermoiements du S. P. D. ont sérieusement entamé sa base ouvrière il ne prend pas le risque de se prononcer contre la République des conseils, mais ne fera rien pour la soutenir. La décision, proposée au Conseil central par l’anarchiste Gustav LANDAUER, est donc adoptée à l’unanimité. Une proclamation au peuple de Bavière, signée par le Conseil central révolutionnaire et le Conseil révolutionnaire des soldats annonce que la dictature du prolétariat est entrée dans les faits, et, comme décisions immédiates, la dissolution du Landtag et de la bureaucratie, la socialisation de la presse, la formation d’une armée rouge. "La République des conseils de Bavière suit l’exemple des peuples russes et hongrois".
Les communistes, invités à cette réunion, n’y participent pas. LEVIWE fait une apparition au milieu Des débats, pour déclarer que le K. P. D. refuse de s’associer à toute initiative à laquelle participerait le S. P. D., compromis par sa politique de guerre, que le prolétariat n’est pas mûr pour une République des conseils qui de toute façon ne pourrait pas tenir sans l’appui de l’Allemagne du nord.
D’autres villes de Bavière proclament la République des conseils. A Munich, de pleine pouvoirs sont conférés à des "délégués du peuple". Parmi d’autres, LANIDAUER est chargé de l’éducation, Sivio CESELL (théoricien de "l’économie libre" et de la "monnaie libre") des finances. Un certain Dr. LIPP, chargé des affaires étrangères, devra vite être suspendu pour troubles mentaux. Mais ces "délégués" ne disposent d’aucun moyen d’action, sinon de leur éloquence dans les réunions qui se succèdent. Pour l’opinion publique, trois hommes représentent la République des conseils ; LANDAUER, orateur entraînant, qui a une certaine influence auprès du prolétariat politisé, MUHSAM, connu comme poète et comme agitateur, le poète Ernst TOLLER, (affilié à l’U.S.P.D.), nommé président du Conseil central. Pour la bourgeoisie et pour une partie de la population bavaroise, ils incarnent la "bohême littéraire juive".
Ce sont des hommes qui comptent moins sur leurs "pleins pouvoirs" que sur l’initiative créatrice et l’action autonome des masses. La suppression de l’ancien pouvoir doit laisser le champ libre à la reconstruction sociale. Mais l’annonce de la libération ne suffit pas à déclencher le processus qu’ils attendent. De toute façon, leur temps est mesuré.
Dès le 13 avril, sur l’incitation du gouvernement H0FFMAN, réfugié à Bamberg, les "troupes de sécurité républicaines" tentent un putsch contre les conseils. Certains membres du Conseil central, dont MUHSAM, sont arrêtés. L’armée rouge résiste, soutenue par les ouvriers acquis aux conseils. Le putsch est vaincu, mais il y a déjà deja victimes : 20 morts, plus de 100 blesssés.
Les communistes, qui ont jusque là concrétisé leur opposition à la "pseudo-République des conseils" (Scheinräterepublick) en regroupant dans un nouveau Conseil central des "hommes de confiance" révolutionnaires élus dans les entreprises et les casernes, affirment à présent que la classe ouvrière a montre sa maturité en s’opposant au putsch et déclarent à leur tour la République des conseils. Ils ne se font sans doute guère d’illusions. Au moins, veulent-ils saisir une chance de galvaniser les forces révolutionnaires dans le reste de l’Allemagne, et laisser un exemple qui puisse stimuler les luttes dans l’avenir, C’est une illustration de ce que les Prudhommeaux appellent la "tragédie spartakiste".
Le pouvoir, désormais, est représenté par le Conseil des "hommes de confiance" auquel participent des Indépendants et des social-démocrates ralliés au programme communiste. Il forme un comité d’action avec un exécutif de quatre hommes : LEVIEN, LEVINE, TOLLER et un troisième russe, AXELROD. Une série de décisions est prise pour radicaliser la situation, grève générale (elle durera jusqu’au 22), confiscation du ravitaillement et des armes, socialisation du logement, arrestation d’otages. La situation devient de plus en plus difficile. Les vivres et le charbon manquent, les paysans s’opposent aux commandos de réquisition. Le manque d’informations aussi commence à ce faire sentir (les journaux ne paraissent plus). Les rumeurs les plus insensées circulent en Allemagne sur la terreur à Munich. L’antisémitisme, cette fois-ci, s’en prend aux "juifs russes". Des corps-francs se rassemblent dans le Nord et en Haute-Bavière à partir du 20 avril, les troupes gouvernementales se mettent un marche vers Munich.
Au sein du comité d’action, les tensions se font de plus en plus vives. Le 27, l’assemblée des conseils d’entreprise rejette la politique des communistes, et élit un nouveau comité d’action, où se retrouve TULLER (qui avait été promu commandant de l’armée rouge pour le secteur nord de Munich). Les communistes se retirent du Conseil, et demandent aux travailleurs de ne pas suivre le nouveau comité d’action. EGELHOFER, un marin de Kiel, est à la tête de l’armée rouge. Le 30 avril, il fait fusiller 10 otages, dont 6 en fait sont des membres de la Société Thulé qui ont pratiqué la réquisition pour leur propre compte... avec des tampons de l’armée rouge.
Le 1er mai, les troupes gouvernementales et les corps-francs entrent dans la ville. Les combats durent plusieurs jours. Il y aura 600 morts. La répression dépasse en sauvagerie celle qui a sévi ailleurs dans la même période. LANDAUER est frappé à mort, EGELHOFER fusillé sans jugement, LEVINE est condamné à mort et fusillé. TOLLER (sauvé par un mouvement de protestation international) s’en tire avec cinq ans de forteresse. LEWIEN parvient à s’enfuir, mais disparaît en 1937 dans les purges staliniennes. Plus de 4000 peines sont prononcées. En septembre 1919 encore tombent des condamnations à mort.
ITALIE
Entre la fin de la première guerre mondiale et la première après-guerre se crée en Italie un climat de veille de révolution : les protestations du mouvement antimilitariste, celle du chômage alarmant, l’objectif difficile de la vie quotidienne et les espoirs suscités par les événements révolutionnaires qui secouaient la Russie, explosèrent en une succession de grèves et de désordres divers.
Les premiers signaux de mécontentement populaire se manifestèrent à Turin. Le 22 août 1917, spontanément, les travailleurs et travailleuses croisèrent les bras contre la guerre et les patronat ; les anarchistes _della Barriera di Milano_ furent parmi les principaux protagonistes des émeutes qui éclatèrent dans toute la ville. Une semaine plus tard, la violente répression de la police(50 morts parmi les grèvistes, 10 parmi la force publique et plus de 1000 arrestations) met fin aux protestations (Voir les motions de Turin (1917)[1]).
Les évênements de 1919
Après les élections de 1919 (gagnée par Francesco Saverio Nitti du Partito Radicale Storico), la grave situation économique du pays explosa en une série innumérable de grèves et d’occupations. Au mois d’août a commencé l’occupation des terres abandonnées (le 24 août, les terres agricoles romaines sont occupées) qui continueront au mois de septembre (100000 journaliers/ères (braccianti) occupent les terres_ di 15 feudi del trapanese)_. Déjà au mois de mars, à Dalmine dans la province de Bergame,_ si realizzarono le prime estemporanee occupazioni di fabbriche, ovunque sorsero i Soviet locali_ et dans la commune de Fiorentino se constitua une éphémère République du Soviet (elle ne dura que 3 jours). À Turin, en grande partie grâce au travail des anarchistes (Maurizio Garino, Italo Garinei et Pietro Ferrero), fut constitué, au mois de Septembre, le premier Conseil d’usine, ou bien des organismes avec lesquels les travailleurs/euses cherchent à prendre le contrôle de la production et à jeter les bases de la révolution prochaine.
Les occupations d’usines
Les élections du mois de Juin 1920 (gagnée par Giovanni Giolitti) et la continuation de la grave crise, amenèrent comme conséquence l’augmentation du nombre de grèves : en janvier 1920 les postiers et les cheminots firent la grève(souvent les cheminots arrêtaient le trains dans lesquels voyageaient les troupes ou les armes qui étaient destinées à combattre les soviets russes). Durant les mois de février et de mars se multiplièrent les grèves des journaliers (braccianti) et les affrontements entre manifestant(e)s et force publique devinrent chose du quotidien. Le 30 août 1920, la direction d’Alfa Romeo de Milan annonce la fermeture de l’usine. Spontanément, les ouvriers l’en empêchèrent en occupant l’établissement et en étendant, avec la participation de près d’un demi-million de travailleurs/euses, un mouvement de protestation et des occupations dans 280 autres établissements de Milan, pour ensuite atteindre le reste de l’Italie. Les occupations se sont concentrées en particulier dans le soi-disant triangle industriel : Milan, Gênes et Turin.
Les anarchistes, autrement que comme minorité de la CGL (ils et elles furent surtout présent dans le FIOM, syndicat des travailleurs du métal adhérant à la CGL), étaient plus actifs/ves dans l’Unione Anarchica Italiana et l’USI, très différents des organisations syndicales ordinaires dans leur opposition à la mentalité du salarié, en éduquant et instruisant les ouvriers/ères à l’autogestion et à l’abolition de toute hiérarchie.
Le Conseil d’usine
Le premier conseil d’usine fut établit à Turin en Septembre 1919, duquel jaillit à la suite un débat interne dans le mouvement ouvrier sur la fonction que les conseils devraient assumer dans le contexte social, ouvrier et politique.
Se distinguèrent trois courants de pensée : un propre aux réformistes, un propre aux socialistes maximalistes (dont, entre autres, le Mouvement de l’Ordre Nouveau de Gramsci qui forme, en 1921, le Parti Communiste d’Italie) et un courant anarchiste. Le premier désirait que les conseils soient au sein des syndicats, de façon à détruire leur indépendance.
Le second considérait le conseil comme un organe révolutionnaire amenant à la conquête du pouvoir politique.
Les anarchistes, au contraire voyaient les conseils d’usines comme des corps révolutionnaires, réprésentants de tous les travailleurs/euses (et pas seulement ceux et celles qui ont payé leur carte du syndicat) et capable, non de conquérir le pouvoir, mais de l’abolir.
Maurizio Garino, conclua son rapport sur les conseils d’usine au Conrès de l’Unione Anarchica Italiana, du premier au 4 juillet 1920 à Bologne, en affirmant que "comme moyen de lutte immédiate et révolutionnaire, le conseil est parfaitement apte à la lutte, puisqu’il ne reçoit pas l’influence constante des éléments non-communistes". Le Conseil d’usine était composé d’ouvriers avec des compétences techniques élevées, donc capables de gérer le cycle de production. L’idée des anarchistes fut de former un Conseil structuré horizontalement, sans chef, ni subordonné :
Pendant ce temps, au niveau national, ils et elles cherchèrent à relier, sur la base d’un fédéralisme structuré horizontalement, tous les conseils d’usines, afin d’échapper au contrôle des partis politiques et des syndicats.
La révolution manquée et le rôle des réformistes
Le Premier ministre italien, Giovanni Giolitti, n’évacua pas les usines, comme beaucoup lui demandaient de faire, mais il savait que le mouvement de protestation perdait graduellement sa charge aggressive, confiant en la collaboration qu’allaient fournir les réformistes du PSI et de la CGL, qui sont isolés du réel mouvement ouvrier et distancié des demandes des travailleurs/euses, garantissant ce projet en échange de quelques conquêtes syndicales.
Tout ceci porta à augmenter la méfiance, la fatigue et la confusion entre les ouvriers, à les convaincre qu’il était nécessaire de se désarmer et d’abandonner les usines occupées, favorisant ainsi la réaction patronale et l’instauration de la dictature fasciste.
Le point de vue anarchiste de Pier Carlo Masini
ANARCHISTES ET COMMUNISTES DANS LE MOUVEMENT DES CONSEILS À TURIN PREMIER APRES-GUERRE ROUGE 1919-1920
Ce n’est pas seulement pour satisfaire une curiosité - d’ailleurs vive chez beaucoup de camarades - que nous rappelons aujourd’hui le mouvement des Conseils, mais plutôt pour reproposer un thème de façon critique et polémique, ainsi que sur la base d’une expérience, à la classe ouvrière en général, aux travailleurs communistes en particulier et enfin à nos propres camarades. En fait, dans la recherche d’une tradition révolutionnaire dans le mouvement ouvrier italien, nous ne pouvons faire abstraction du mouvement des Conseils, de même que nous ne pouvons en faire abstraction dans la revendication et dans la reconstruction d’une « constante historique » de classe du mouvement anarchiste italien.
C’est dans ce but que nous avons commencé cette étude, déficiente et incomplète par beaucoup d’aspects, mais qui dans l’ensemble résume le problème dans ses aspects théoriques et pratiques en tenant compte des éléments contextuels.
Nous sommes certains qu’à peine aurons-nous écrit les derniers mots de cette série de notes, nous sentirons aussitôt le besoin de les revoir, de les compléter et de les amplifier : ce que nous ferons sûrement une autre fois dans la mesure où nous posséderons toujours mieux le sujet et où nous accumulerons une documentation plus abondante.
I LE CERVEAU DU PROLETARIAT : TURIN
Le mouvement des Conseils, dans ses traits particuliers et distinctifs, a à Turin et seulement à Turin ses fondements historiques basés sur la dure roche d’une organisation industrielle avancée et d’un système capitaliste très concentré.
Turin, qui après l’unification (1), avec le transfert de la capitale à Florence, s’était vidée, providenciellement vidée de toutes ses « toiles d’araignée » bureaucratiques et de tous ses privilèges de courtisans, réagit après une véhémente explosion de colère, impitoyablement réprimée par le gouvernement d’une dynastie qui à ce moment précis cessait d’être « piémontaise ». Elle réagit donc à la nouvelle situation par un rapide effort de reconstruction sur le plan économique dont nous avons la première preuve convaincante avec l’Exposition de 1884.
La ville, bien que géographiquement défavorisée par rapport à Milan - centre de la vallée du Po et base des communications avec la Suisse, ou à Gênes - grand port et grande place commerciale, se place bien vite à l’avant-garde du progrès industriel de tout le pays et se développe vigoureusement dans son ossature démographique et urbaine.
La ville double puis triple sa superficie, ses surfaces bâties : elle s’étend dans la plaine, elle assaille les collines environnantes, elle grossit ses faubourgs. Examinons les statistiques de l’ascension démographique : 1808 = 65.000 habitants ; 1848 = 136.849 habitants ; 1868 = 191.500 habitants. La population triple au cours des soixantes premières années. Mais l’augmentation continue avec le même rythme incessant durant les soixantes années qui suivent : 1871 = 212.644 ; 1881=252.852 ; 1901=335.656 ; 1911=427.106 ; 1921 = 502.274.
Dans le premier après-guerre, au temps des Conseils, nous en sommes donc au demi-million (après la seconde guerre, la population approchait le million, elle le dépasse largement aujourd’hui). Le développement de certains quartiers ouvriers est encore plus significatif. En 50 ans, de 1871 à 1921, le quartier de la « Barrière de Milan » passe de 1901 habitants à 39.967 ; le quartier de la « Barrière Saint-Paul » passe de 2.484 à 50.204.
Pourquoi tout cela ? Pourquoi la formation de Turin comme cité moderne dépasse en rapidité et surtout en rationalité « tous les autres centres urbains italiens ? Pourquoi à Turin convergent, venant de toute l’Italie, de grandes masses d’immigrants qui dans un faible nombre d’années se fondent dans le nouveau creuset social jusqu’à l’acquistion de caractéristiques propres et originales ?
Parce qu’il se produisit à Turin un phénomène que nous pouvons indiquer ici à son stade originel : au cours de l’année 1889 naquit à Turin, avec 50 ouvriers et de modestes équipements l’usine Fiat. Le fait, non enregistré par les chroniques de l’époque, aura pour le destin de la cité bien plus d’importance que la concession du Statut advenue près d’un demi-siècle auparavant.
Les 50 ouvriers de la Fiat seront 50.000 après la première guerre mondiale ; au centre de Turin, autour de Turin, la Fiat plantera ses tentes d’acier et de béton armé ; autour de ses bâtiments s’établiront d’autres grandes, petites et moyennes entreprises qui, en 1911 atteindront le nombre de 5.151 et en 1927 auront plus que doublé atteignant le chiffre de 11.993. Mais surtout autour de la Fiat et des autres entreprises se densifiera un prolétariat compact et homogène, aussi unifié en son sein que différencié des autres couches et groupes sociaux plus ou moins instables, plus ou moins hétérogènes.
Ce sont la consistance et la cohésion particulières de ce prolétariat qui permirent à Turin de se mettre à l’avant-garde de la révolution ouvrière, comme elle avait été à l’avant-garde de l’unification nationale conduite non tant par la bourgeoisie manufacturière que par des groupes nobiliaires s’étant insérés promptement dans le sillage de la révolution bourgeoise et installés dans la diplomatie, l’armée, la bureaucratie (la « culture piémontaise »), et dans la transformation industrielle (promue avec la contribution prépondérante de la jeune bourgeoisie manufacturière mais toujours avec le patronage du patriciat « progressiste »).
Turin cette fois devient protagoniste de l’histoire par la seule poussée du prolétariat ; les représentants mêmes de la culture bourgeoise « progressiste » rassemblés autour de la « Révolution libérale » de Gobetti sont attirés dans le sillage de la révolution ouvrière incarnée par le mouvement des Conseils.
Le centre même de la « culture nationale », jusqu’alors fixé à Florence, se déplace vers Turin et subit un substantiel changement de direction : c’est encore le prolétariat de Turin qui, à travers ses groupes d’avant-garde, emporte la primauté culturelle et s’en fait une arme contre la fausse culture, contre la vieille culture, monopole d’une « intelligence » bourgeoise dépassée et attardée. Sur le terrain politique, les Conseils sont la formule de cette nouvelle culture.
II PERIODE DE REVOLUTION
Turin a aussi été durant la première guerre mondiale la seule ville d’Italie qui se soit lancée dans une protestation massive contre la poursuite du conflit au cours de l’année 1917. Le mouvement d’août 1917, à fond internationaliste et antimilitariste, suivi d’une violente répression accomplie par tous les corps de l’armée et de la police (500 morts en août 1917, des centaines d’ouvriers envoyés au front, des milliers d’emprisonnés), porta Turin aux côtés de Kronstadt et de Wilhemshafen, et fit que les ouvriers de la Fiat furent cités dans le courant de l’année à l’ordre du jour de la résistance auprès des ouvriers des usines de Berlin et de Petrograd (2). C’est peut être la raison pour laquelle, quand de Petrograd et de Berlin se lève à la fin de la guerre la voix des Conseils, des Comités, des Soviets, cette voix a une résonnance immédiate chez les travailleurs de Turin.
Sur le plan international, les Conseils n’ont eu effectivement un contenu révolutionnaire qu’en Russie, Allemagne, Bavière, Hongrie et Autriche ; et encore, seulement dans un premier temps. Une fois clos le cycle révolutionnaire ils perdent leur vraie fonction : ils sont dissous comme en Russie, supprimés comme en Hongrie, transformés en organismes de collaboration de classes et de préservation du système capitaliste comme en Allemagne et en Autriche.
Les Conseils d’usine surgissent en effet partout avec une fonction de contrôle sur la vie productive de l’entreprise, ils se transforment bien vite en instruments d’expropriation pour la conquête de l’entreprise, ils assument enfin la gestion directe de celle-ci tant qu’existent les conditions favorables à l’offensive révolutionnaire. Lorsque ces conditions viennent à manquer, les Conseils retournent aux fonctions de contrôle qu’on leur avait accordé dans la première phase et admises maintenant sous une forme de co-participation « morale » à la vie de l’entreprise, puis on leur ôte même ce droit.
En d’autres termes, la naissance des Conseils, et leur mort, sont étroitement liées à l’extrême radicalisation de la lutte des classes durant le premier après-guerre ; les Conseils sont le produit d’une situation spéciale qui, dans une intense veille de conquêtes, mit les masses ouvrières face à la responsabilité de devoir prendre en mains tout l’appareil économique du pays et de le faire fonctionner.
Par ailleurs, la fin, glorieuse ou non, des Conseils en tant qu’organismes révolutionnaires, ensevelis sous les canonnades de la contre-révolution et sous les décrets lois de la restauration bourgeoise, marque aussi le tragique épilogue du premier après-guerre rouge.
L’expérience devient patrimoine théorique du prolétariat et dans de nombreux pays le drapeau des Conseils sert à rassembler les forces dispersées de la minorité révolutionnaire (surtout en Allemagne et en Hollande, où naissent derrière ce symbole des mouvements organisés). Le mouvement anarchiste, n’étant pas resté indifférent aux expériences concrètes, ne pouvait rester indifférent à la théorie qui se construisait sur ces expériences. Pour cela, il se devait de rechercher les liaisons qui s’étaient établies, ici en Italie, durant l’après-guerre entre l’organisation anarchiste alors présente, l’U.A.I., et le mouvement turinois des Conseils.
III LES ORIGINES DES CONSEILS D’USINE
A Turin, le 27 octobre 1906 fut signé un contrat collectif de travail entre la F.I.O.M. (Fédération des Ouvriers de la Métallurgie) et l’usine automobile « Itala » qui instituait, pour trancher les éventuelles controverses sur l’application du contrat un organisme d’entreprise appelé : « Commission Interne » : organisme étroitement lié à la vie de l’entreprise composé d’ouvriers de l’usine et élu par le personnel ; la C.I. se plaçait donc dans une position autonome vis à vis des organisations horizontales et verticales du syndicat, même si quelquefois elle assumait un rôle encore plus collaborationniste que le syndicat lui-même.
Toutefois, c’est précisément la C.I. qui devait représenter la base organique sur laquelle se développera ensuite le Conseil d’usine.
Dans l’immédiat après-guerre, en août 1919, à Turin, dans le plus grand établissement de la Fiat, Fiat-Centre, la Commission Interne en fonction démissionne et le problème de sa réintégration se pose.
Au cours des discussions prévaut la proposition d’un élargissement de la dite Commission, réalisable à travers l’élection d’un commissaire pour chaque atelier. A la Fiat-Centre sont ainsi élus 42 commissaires correspondant aux 42 ateliers en activité. Ces 42 commissaires constituent le premier Conseil d’usine.
L’exemple est vite suivi à la Fiat-Brevets et dans toutes les autres usines de Turin. L’expérience des Conseils s’étend presque aussitôt à d’autres centres industriels, hors du Piémont.
A la mi-octobre 1919, à la première assemblée des Comités exécutifs des Conseils d’usine, sont représentés 30.000 ouvriers.
La rapide affirmation des Conseils ne s’explique cependant pas si l’on ne montre pas les principes fondamentaux sur lesquels ils reposent, c’est-à-dire la théorie qui s’échafaude autour d’eux : théorie non inventée par quelque fervent génie, mais germée sur le terrain même des faits comme nous le montrerons pas à pas.
Si, en fait, les Conseils étaient restés des « Commissions internes élargies » avec les mêmes fonctions de coopération et de concordat ils n’auraient pas pu constituer le plus efficient des instruments de classe dans cette période d’extrême tension révolutionnaire qui fut le premier après-guerre.
IV LA THEORIE DES CONSEILS
Schématiquement, la théorie des Conseils, qui fut élaborée par les groupes d’avant-garde du prolétariat turinois durant l’après-guerre, se fonde sur une série de thèses que l’on peut regrouper ainsi :
a) Le Conseil d’usine se forme et s’articule autour de toutes les structures complexes et vivantes de l’entreprise ; il en fouille les secrets, il en saisit les leviers et les équipements, il en enveloppe le squelette de son propre tissu. Il adhère intimement à la vie de l’établissement moderne, dans les plans et les méthodes, dans les procès de production, dans les multiples spécialisations du travail, dans la technique avancée d’organisation interne.
Par ces caractères qui lui viennent de son expression immédiate dans les secteurs-base de l’entreprise, atelier par atelier, et en plus des fonctions qui lui sont attribuées, le Conseil d’usine, à la différence des organisations syndicales, produit deux faits nouveaux d’une grande force révolutionnaire :
En premier lieu : au lieu d’élever chez l’ouvrier la mentalité du salarié, il lui fait découvrir la conscience de producteur avec toutes les conséquences d’ordre pédagogique et psychologique que cette « découverte » comporte.
En second lieu : le Conseil d’usine éduque et entraine l’ouvrier à la gestion, il lui donne une compétence de gestion, il lui donne jour après jour les éléments utiles à la conduite de l’entreprise.
Conséquemment à ces deux faits nouveaux, même le plus modeste et le plus obscur travailleur comprend aussitôt que la conquête de l’usine n’est plus une chimère magique ou une hypothèse confuse mais le résultat de sa propre émancipation. Ainsi aux yeux des masses, l’expropriation perd ses contours mythiques, assume des linéaments précis et devient une évidence immédiate, une certitude précise en tant qu’application de leur capacité à s’autogouverner.
b) Les Conseils, à la différence des partis et des syndicats, ne sont pas des associations contractuelles ou au moins à tendances contractuelles mais plutôt des organisations naturelles, nécessaires et indivisibles.
Ce n’est pas un dirigeant ou une hiérarchie qui organise des individus grégaires dans un groupe politique déterminé ; dans les Conseils, l’organisation est ce même processus productif qui encadre fonctionnellement et organiquement tous les producteurs. Pour cela, les Conseils représentent le modèle d’une organisation unitaire des travailleurs, par delà leurs vues philosophiques ou religieuses particulières ; dans ce cas, l’unité est réelle parce qu’elle est le produit non d’une entente, d’un compromis, d’une combinaison mais d’une nécessité.
L’unité interne du Conseil d’usine est tellement forte qu’elle rompt et fond deux résistantes barrières de division entre les travailleurs : celle qui sépare les organisés des inorganisés et celle qui sépare les manuels des techniciens.
Dans le Conseil, chacun a sa place parce que le Conseil rassemble tout le monde, intéresse tout le monde jusqu’à ce qu’il s’identifie avec tout le personnel de l’usine.
C’est une organisation unitaire et générale des travailleurs de l’usine.
c) Les Conseils représentent la réelle préfiguration de la société socialiste ; le mouvement des Conseils constitue le processus de formation moléculaire de la société socialiste.
Ainsi l’avènement du socialisme n’est plus pensé comme une institution bureaucratique pyramidale mais comme une naissante et continuelle création de la base.
Les thèmes traditionnels de la rhétorique socialiste (et bolchévique en l’espèce) comme « conquête du pouvoir politique » ou « dictature du prolétariat » ou « État ouvrier » sont évidés de leur contenu mythique et remplacés par une vision moins formelle, moins mécanique et moins simpliste des problèmes révolutionnaires.
Dans la ligne des Conseils se trouve le réalisme révolutionnaire qui abat l’utopisme de propagande, qui ensevelit la « métaphysique du pouvoir ».
Et même quand dans certains groupes survit une nomenclature désormais inadéquate, c’est l’interprétation nouvelle, c’est la pratique nouvelle qui en rompt les schémas, les apriorismes, les fixations logiques et phraséologiques (et ce sont ces mêmes groupes d’éducation anarchiste qui en forcent la répudiation totale). C’est ainsi que les Conseils deviennent en même temps une expérience et un exemple, une enclave dans la société d’aujourd’hui et une semence de la société de demain.
d) Les Conseils, s’ils représentent sur le plan général de la stratégie révolutionnaire l’organisation générale, finale et permanente du socialisme (alors que le mouvement politique vaut seulement comme organisation particulière, instrumentale et contingente, « pour le socialisme »), constituent aussi sur le plan tactique une force complémentaire de masse, un instrument auxiliaire du mouvement politique.
Les Conseils possèdent en fait une grande potentialité offensive comme unités d’entreprises et développent en phase révolutionnaire la même fonction qu’accomplissent, durant une agitation, les commissions internes et les comités de grève.
D’autre part, en phase de repli et de résistance, les Conseils disposent d’une grande capacité de défense. La réaction, qui peut dissoudre sans trop de difficultés les partis et les syndicats, en fermant leurs sièges et en interdisant leurs réunions, se heurte, quand elle se trouve face aux Conseils, aux murs mêmes de l’usine, à l’organisation de l’établissement ; et ne peut les dissoudre sans abattre ces murs, sans dissoudre cette organisation. Les Conseils, sous des noms divers, ou même au stade semi-officiel, survivront toujours.
V LE MOUVEMENT DES CONSEILS
Deux groupes politiques distincts contribuèrent à l’élaboration de la théorie des Conseils : un groupe de socialistes et un groupe d’anarchistes.
Aucun autre groupe politique ne fut présent dans le mouvement, même si tous les groupes politiques italiens s’intéressèrent au phénomène. Par contre furent présents de larges groupes de travailleurs sans parti, témoins du caractère d’unité prolétarienne du mouvement.
Le groupe socialiste se constitua dans les dernières années de la guerre autour du Grido del Popolo,feuille de la section turinoise du parti socialiste. La figure de premier plan était Antonio Gramsci, qui sera plus tard le leaderd’une des deux fractions qui concourront à la fondation du parti communiste d’Italie. Personnages de second plan : Tasca, Togliatti, Terracini et Viglongo.
Mais si tout ce groupe contribua à la fondation de l’hebdomadaire L’Ordine Nuovo,dont le premier numéro sortit le ler mai 1919, il n’y eut en fait que deux forces animatrices des Conseils du côté socialiste : d’une part l’esprit de Gramsci, de l’autre les groupes d’avant-garde, d’authentiques bien qu’obscurs ouvriers turinois. Et ces deux forces passeront sans tâches dans l’histoire et sauveront le nom des Conseils.
Du côté anarchiste, notons la collaboration assidue et qualifiée de Carlo Petri (pseudonyme de Pietro Mosso (3)) à L’Ordine Nuovo.Carlo Petri, assistant à la chaire de philosophie théorétique de l’Université de Turin est l’auteur d’un essai sur Le système Taylor et les Conseils des producteurs et d’autres écrits défendant le Communisme anarchiste.
Mais la contribution anarchiste se rencontre surtout dans le travail d’organisation pratique des Conseils effectué par deux anarchistes, ouvriers métallurgistes : Pietro Ferrero (4), secrétaire de la F.I.O.M., section turinoise et Maurizio Garino (5) (qui a donné un apport de souvenirs personnels et d’observations critiques à ces notes sur les Conseils), et par tout un groupe : le Groupe Libertaire Turinois (6), dont ils faisaient partie.
Le Groupe Libertaire Turinois s’était déjà distingué non seulement par sa présence dans les luttes ouvrières avant et pendant la guerre mais surtout par les lignes directrices qu’il avait données au problème de l’action des libertaires dans les syndicats. Ce groupe avait en fait soutenu la nécessité d’opérer dans les syndicats fussent-ils réformistes (et peuvent-ils ne pas l’être ? se demandait-il) afin de pouvoir y établir les plus larges contacts avec les masses laborieuses.
Sous cet aspect, la critique que L’Ordine Nuovofaisait à l’U.S.I. (organisation syndicaliste révolutionnaire) ne pouvait qu’être approuvée par ces anarchistes même si la forme de cette critique n’était pas la plus apte à convaincre les nombreux groupes d’ouvriers sincèrement révolutionnaires qui étaient à l’U.S.I.
Le Groupe Libertaire Turinois fut ainsi au centre des luttes de classes à Turin durant les quatre années de l’après-guerre et donna en la personne de Pietro Ferrero, assassiné par les fascistes le 18 décembre 1922, un de ses meilleurs militants à la résistance anti-fasciste. Nous verrons aussi plus loin quelle part notable eurent les anarchistes dans l’élaboration de la théorie des Conseils et quelles adjonctions théoriques ils apportèrent aux points énoncés au chapitre IV du présent essai.
VI LA POLEMIQUE SUR LES CONSEILS
Le mouvement des Conseils se vit barrer la route en Italie par deux forces de l’ordre constitué : les groupes de la grande industrie et les hiérarchies syndicales confédérales. Ces deux forces tendaient à conserverune structure déterminée de la société italienne : les Olivetti, les Agnelli, et les Pirelli tendaient à conserver leurs monopoles, leur prestige, leur hégémonie dans et hors de l’usine ; les Colombino, les d’Aragona et les Baldesi tendaient à conserver, grâce à leur médiation, l’équilibre instauré dans les rapports de travail et le droit exclusif de représenter les travailleurs auprès de leurs ennemis de classe et de l’État.
Le mouvement des Conseils rompait cette situation, touchait la coeur plutôt qu’au porte-feuille l’organisation capitaliste, destituait les organisations syndicales en leur substituant une forme d’organisation ouvrière adéquate au moment révolutionnaire.
Nous verrons plus loin combien fut enragée la réaction des capitalistes piémontais et combien fut âpre le ressentiment des cercles confédéraux, inquiets de voir s’écrouler leurs positions au Piémont.
Dans Battaglie sindacali,organe de la C.G.L. (= C.G.T.), le mouvement des Conseils fut soumis à de violentes attaques et fut dénoncé comme un réveil, comme une soudaine éruption « d’anarchisme ». C’était alors une méthode assez répandue dans tout le camp social-réformiste européen que d’accuser « d’anarchisme » tout mouvement révolutionnaire, du Spartakisme en Allemagne jusqu’au Bolchevisme en Russie : signe évident du rôle prééminent que jouait alors l’anarchisme dans les luttes de classes.
Même le groupe de L’Ordine Nuovoet avec lui toute la section turinoise du Parti Socialiste fut l’objet d’âpres attaques polémiques dans ce sens, non tant par la présence dans le mouvement des Conseils d’anarchistes déclarés, que par le fait qu’il ait énergiquement défendu le droit pour tous les travailleurs, même les inorganisés, de faire partie des Conseils.
L’Ordine Nuovorépliquait à ces critiques en dénonçant dans ses colonnes les fonctionnaires syndicaux qui cherchaient partout des cotisants, des moutons dociles plutôt que des militants ouvriers décidés à défendre et à affirmer concrètement dans l’usine les droits de leur classe.
Ensuite, avec l’aggravation de la tension entre la droite, le centre et la gauche du Parti Socialiste, la polémique s’étendit et s’approfondit jusqu’au Congrès de Livourne, qui vit toutefois faussé le réel contraste entre gauche et droite par la question formelle de l’adhésion à l’Internationale de Moscou.
La polémique au sein même du mouvement des Conseils ou dans ses environs immédiats fut plus riche. En fait, le débat fut riche et fécond entre les groupes qui avec L’Ordine Nuovode Turin et avec le Sovietde Naples convergeaient vers la fondation du Parti Communiste dItalie et entre les groupes qui se rassemblaient autour de l’U.S.I. (Union Syndicale Italienne ; syndicaliste révolutionnaire) et de l’U.A.I. (Union Anarchiste Italienne ; Communiste Libertaire).
Nous commençons avec L’Ordine Nuovo.
Le journal, dans sa première série - commençée le ler mai 1919 et terminée à la fin de 1920 - [durant la seconde série, il devint quotidien (21-22) et il redevint hebdomadaire durant la troisième (24-25)] présente deux périodes distinctes : la « période Tasca » et la « période Gramsci », c’est-à-dire la période pendant laquelle le journal, dans sa ligne et ses objectifs se ressent de l’influence prédominante de Tasca et la période durant laquelle Tasca étant écarté, il suit une ligne plus résolue imprimée par Gramsci. Ces deux périodes sont historiquement bien différenciées par un incident entre Tasca et Gramsci sur le problème des Conseils qu’il convient de réévoquer ici. Tasca, incertain, confus et peut-être partisan peu convaincu des Conseils, avait lu un rapport sur « les valeurs politiques et syndicales des Conseils d’usine » au Congrès de la Bourse du Travail de Turin et ce rapport avait été publié dans L’Ordine Nuovo(a. II, n. 3).
Dans l’exposé, le verbalisme superficiel et les considérations abstraitement juridiques trahissaient une évidente sous-évaluation de la tâche des Conseils et la tentative d’insérer la nouvelle organisation dans les cadres syndicaux afin de la subordonner à ceux-ci.
Gramsci, dans le numéro suivant (a. II, n. 4), annota soigneusement l’exposé de Tasca et écrivit entre autre, à propos d’un rapport contenu dans celui-ci, un passage qu’il nous plait de rapporter :
« Ainsi Tasca polémique avec le camarade Garino à propos de l’affirmation selon laquelle« la fonction principale du syndicat n’est pas de former la conscience du producteur chez l’ouvrier mais de défendre les intérêts de l’ouvrier en tant que salarié », affirmation qui est la thèse développée dans l’éditorial « Syndicalisme et Conseils » publié dans L’Ordine Nuovodu 8 novembre 1919. Quand Garino, syndicaliste anarchiste, développa cette thèse au Congrès extraordinaire de la Bourse du Travail en décembre 1919, et qu’il la développa avec une grande efficacité dialectique et avec chaleur, nous fûmes très agréablement surpris, à la différence du camarade Tasca, et nous éprouvâmes une grande émotion. Puisque nous concevons le Conseil d’usine comme le commencement historique d’un processus qui nécessairement doit conduire à la fondation de l’État Ouvrier, l’attitude du camarade Garino, libertaire syndicaliste, était une preuve de la certitude que nous nourrissions profondément, à savoir que dans un processus révolutionnaire réel, toute la classe ouvrière trouve spontanément son unité pratique et théorique et que chaque ouvrier, s’il est sincèrement révolutionnaire, ne peut qu’être amené à collaborer avec toute la classe au développement d’une tâche qui est immanente dans la société capitaliste et qui n’est pas une fin librement proposée par la conscience et par la volonté individuelles ».
En faisant abstraction des réserves que l’on peut soulever sur certaines affirmations de ce passage, la différence d’attitude entre Tasca et Gramsci est notable par rapport au point de vue illustré par le camarade Garino.
Ceci est tellement vrai que Tasca, répliquant longuement à Gramsci, exprima sa foi fanatique dans la « dictature du prolétariat » et s’opposa à toute forme de démocratie ouvrière ; il demande « des années, de longues années de dictature » et réduit les Conseils d’usine à de simples « instruments » du Parti ; il définit l’idée de Fédération des Conseils comme « une thèse libertaire » et accuse Gramsci de « syndicalisme ».
« Le camarade Gramsci nous a donné, dans l’éditorial du dernier numéro, sa théorie des Conseils d’usine comme base de « l’État Ouvrier ». Il y a dans cet article une claire description de la thèse proudhonienne : « l’usine se substituera au gouvernement » et la conception de l’État (sic !) qui s’y trouve développée est anarchiste et syndicaliste mais pas marxiste ».
Après cette auto-défense Tasca s’éloigna de L’Ordine Nuovoqui entra ainsi dans sa seconde période, en août 1920. Cette période fut inaugurée par un bilan âpre et autocritique écrit par Gramsci lui-même, pour conclure la polémique.
Avant de passer à une illustration de la contribution anarchiste, nous ferons une allusion aux interventions de Bordiga dans le Sovietde Naples au cours desquelles fut soulevé, entre autre, le problème du pouvoir politique, qui intervient et écrase avec son appareil répressif, toute tentative d’édification socialiste à la base comme les Conseils quand ceux-ci ne sont pas simplement incorporés graduellement dans l’ordre bourgeois.
L’objection frappait juste, mais Bordiga, prisonnier de vieilles formules ne réussissait pas à résoudre le problème du pouvoir si ce n’est dans le sens de sa conquête plutôt que dans le sens de sa destruction. Sur ce plan, il ne pouvait comprendre la fonction immédiatement positive des Conseils au cours de la destruction de l’Etat, opérée par le mouvement politique de la classe.
VII LA CONTRIBUTION DES ANARCHISTES
La contribution des anarchistes à l’élaboration de la théorie des Conseils peut être résumée dans ces deux « adjonctions » théoriques essentielles :
a) Ce n’est que pendant une période révolutionnaire que les Conseils peuvent avoir une efficience révolutionnaire, qu’ils peuvent se constituer en outils valides pour la lutte des classes et non pour la collaboration de classes. En période contre-révolutionnaire les Conseils finissent par être « phagocités » par l’organisation capitaliste qui n’est pas toujours opposée à une cogestion morale de la part des travailleurs. C’est pourquoi avancer l’idée des Conseils dans une période contre-révolutionnaire signifie lancer des diversions inutiles et porter un préjudice grave à la formule même des Conseils d’usine en tant que mot d’ordre révolutionnaire.
b) Les Conseils résolvent à moitié le problème de l’État : ils exproprient l’État de ses fonctions sociales mais ils ne lèsent pas l’État dans ses fonctions antisociales ; ils réduisent l’État à un pléonasme mais ils n’éliminent pas ce pléonasme, ils vident l’appareil étatique de son contenu mais ils ne le détruisent pas. Mais puisqu’on ne peut vaincre l’État en l’ignorant, du fait qu’il peut faire sentir sa présence à tout moment en mettant en marche son mécanisme de contrainte et de sanction, il faut détruire aussi ce mécanisme. Les Conseils ne peuvent accomplir cette opération et pour cela ils demandent l’intervention d’une force politique organisée ; le mouvement spécifique de la classe, qui porte à terme une telle mission. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut éviter que le bourgeois, jeté à la porte dans ses vêtements d’industriel ne rentre par la fenêtre déguisé en policier.
La question soulevée dans la polémique entre L’Ordine Nuovoet le Sovietnous semble ainsi résolue. Les « ordinovistes » sous-évaluaient le problème de l’État dans le sens de son « isolement » (7) ; les « soviétistes » le sur-évaluaient dans le sens de son « occupation » ; les anarchistes le centraient correctement dans le sens de sa " liquidation " réalisée sur le terrain politique. Les occasions, les documents, les réunions dans lesquels les anarchistes répétèrent les thèses sur les Conseils, énoncées au chapitre IV, et complétèrent ces thèses avec les « additifs » résumés ci-dessus, furent multiples.
La première occasion fut offerte par le Congrès National de l’U.S.I. qui se tint à Parme en décembre 1919. Déjà avant le Congrès, dans Guerra di Classe(Guerre de Classe), l’organe de l’U.S.I., le problème des Conseils avait été examiné par Borghi, Garinei, et Giovannetti et L’Ordine Nuovosous la plume de Togliatti (p.t.) avait souligné la méthode critique subtile avec laquelle avait été traitée la question dans ce journal.
Au Congrès de l’U.S.I., auquel les Conseils d’usine avaient envoyé leur adhésion et même un délégué, l’ouvrier Matta de Turin, on discuta longuement des Conseils en n’ayant cependant pas toujours une connaissance suffisante du sujet (ainsi les Conseils furent comparés au syndicalisme industriel des I.W.W. ; ce qui ne correspond pas à la réalité, même si théoriquement Gramsci reconnaissait avoir emprunté des idées au syndicaliste nord-américain De Leon) et avec l’intention de faire passer le mouvement des Conseils comme une reconnaissance implicite du syndicalisme révolutionnaire, alors que les Conseils en étaient au contraire une critique et un dépassement.
A la fin du Congrès, cette importante résolution dans laquelle sont condensées les observations positives du débat, fut approuvée :
« Le Congrès salue chaque pas en avant du prolétariat et des forces politiques vers la conception pure du socialisme niant toute capacité de démolition ou de reconstruction à l’institution historique, typique de la démocratie bourgeoise, qui est le parlement, coeur de l’État ;
« Considère la conception soviétiste de la reconstitution sociale comme antithétique de l’État et déclare que toute superposition à l’autonome et libre fonctionnement des soviets de toute la classe productrice, unie dans l’action défensive contre les menaces de la réaction et par les nécessités administratives de la future gestion sociale, sera considérée par le prolétariat comme un attentat au développement de la révolution et à l’avènement de l’égalité dans la liberté ;
« Déclare pour ces raisons toute sa sympathie et son encouragement à ces initiatives prolétariennes que sont les Conseils d’usine, qui tendent à transférer dans la masse ouvrière toutes les facultés d’initiative révolutionnaire et de reconstruction de la vie sociale, en mettant cependant bien en garde les travailleurs contre toutes déviations possibles et escamotages réformistes de la nature révolutionnaire de telles initiatives, contrevenant ainsi aux intentions d’avant-garde de la meilleure partie du prolétariat.
« Invite spécialement cette partie du prolétariat à considérer les nécessités de préparer les forces d’attaque révolutionnaire à l’affrontement de classes, sans quoi la prise en charge de la gestion sociale de la part du proletariat ne sera pas possible » (8).
Le Congrès cerna ensuite dans ces termes les dangers de déviation contenus dans les Conseils d’usine : a) « Les Conseils d’usine peuvent dégénérer en de simples commissions internes pour le bon fonctionnement de l’usine, pour l’augmentation de la production au profit de la bourgeoisie, pour dénouer les controverses internes ;
b) « On pourrait invertir la logique du processus révolutionnaire, et croire que l’anticipation des formes de la future gestion sociale suffise à faire tomber le régime actuel ;
c) « On pourrait oublier que l’usine appartient au patron parce qu’il y a l’État - le gendarme - qui la défend ;
d) « Il ne faudrait pas tomber dans l’erreur consistant à croire que la question de forme résoudra la question de la substance de la valeur idéale d’un mouvement déterminé ».
La discussion fut plus ample au sein de l’Union Anarchiste Italienne qui se préparait à tenir son Congrès National à Bologne du 1er au 4 juillet 1920.
Déjà dans la première moitié de juin, les camarades Ferrero et Garino avaient présenté la motion défendue auparavant à la Bourse du Travail de Turin, au Congrès anarchiste piémontais. Celui-ci l’approuva et délégua le camarade Garino pour la soutenir au Congrès national (9). Le 1er juillet parut dans Umanità Novaun long et exhaustif rapport du camarade Garino, dans lequel sont exposés les principes inspirateurs du mouvement et de l’action des Conseils (10). Au Congrès, le camarade Garino, sur la base du rapport déjà publié illustra la motion approuvée par le Congrès anarchiste piémontais. Après des interventions remarquables de Borghi, Sassi, Vella, Marzocchi, Fabbri, une résolution fut adoptée, qui malgré l’ingénuité de certaines expressions, reprend les thèmes essentiels de la motion de Turin.
En voici le texte :
« Le Congrès - tenant compte que les Conseils d’usine et d’atelier tirent leur importance principale du fait de l’imminente révolution et qu’ils pourront être les organes techniques de l’expropriation et de la nécessaire et immédiate continuation de la production, et sachant que tant que la société actuelle existera ils subiront l’influence modératrice et conciliatrice de celle-ci ; « Considère les Conseils d’usine comme étant des organes aptes à encadrer, en vue de la révolution, tous les producteurs manuels et intellectuels, sur le lieu même de leur travail, et en vue de réaliser les principes anarchistes-communistes. Les Conseils sont des organes absolument anti-étatiques et sont les noyaux possibles de la future gestion de la production industrielle et agricole ;
« Le considère en outre comme étant aptes à développer chez l’ouvrier salarié la conscience du producteur, et comme étant utiles à l’acheminement de la révolution en favorisant la transformation du mécontentement de la classe ouvrière et du paysanat en une claire volonté expropriatrice ;
« Invite donc les camarades à appuyer la formation des Conseils d’usine et à participer activement à leur développement pour les maintenir, aussi bien dans leur structure organique que dans leur fonctionnement, sur ces directives, en combattant toute tendance de déviation collaborationniste et en veillant à ce que tous les travailleurs de chaque usine participent à leur formation (qu’ils soient organisés ou non) ».
En outre, au Congrès de Bologne fut votée une seconde motion sur les Soviets qui réaffirmait selon des principes identiques l’impossibilité historique et politique d’expériences libertaires en phase de ressac contre-révolutionnaire.
Un autre document important se ressentant largement de l’influence des anarchistes est le manifeste lancé dans L’Ordine Nuovodu 27 mars 1920 (11) qui est adressé aux ouvriers et paysans d’Italie pour un Congrès national des Conseils et qui est signé par la rédaction du journal, par le Comité exécutif de la section turinoise du Parti Socialiste, par le Comité d’étude des Conseils d’usine turinois et par le Groupe Libertaire Turinois.
Mais le Congrès n’eut pas lieu car d’autres événements pressaient.
VIII L’ACTION DES CONSEILS
Nous avons déjà parlé de l’origine des Conseils d’usine à Turin et de leur extension dans le Piémont où ces organismes avaient effectivement atteint un degré d’efficience élevé.
A Turin surtout, chaque usine avait son Conseil, composé de commissaires d’atelier et représenté par un commissariat exécutif d’usine, dont le secrétaire constituait avec les secrétaires délégués par les autres usines, le Comité Central des Usines, et donc le Comité de la Ville.
Mais nous n’avons pas encore parlé de la contre-offensive que le Capital préparait, à Turin précisément.
Déjà au Printemps 1919, sur l’initiative de l’industriel Gino Olivetti, était partie de Turin même, l’idée de la constitution de la Confédération générale de l’Industrie (Confindustria) : initiative qui reçut d’immédiats et larges soutiens dans le monde financier.
A Turin et dans le Piémont existaient dans l’immédiate après-guerre d’autres organisations patronales puissantes : la puissante association des Métallurgistes et Mécaniciens Similaires (A.M.M.A.), dirigée par l’ingénieur Boella et présidée par le « Gran Ufficiale » Agnelli ; la Ligue Industrielle fondée en 1906, dont le secrétaire général était l’avocat Codogni et le président le « Commendatore » De Benedetti ; l’Association Piémontaise des Industries du caoutchouc, fondée sur le holding Michelin ; la Fédération Industrielle de Verceil ; la Ligue Industrielle du Val d’Aoste ; etc.
Toutes ces forces tinrent en mars 1920 une conférence à Turin, au cours de laquelle fut élaboré un plan d’attaque contre le prolétariat turinois et contre ses Conseils qui, au mois de février, s’étaient étendus en Ligurie aux chantiers Ansaldo, Odero, Piaggio, Ilva, aux usines Fossati, San Giorgio et qui en mars apparaissaient pour la première fois à Naples, aux usines Miani et Silvestri. Cette dernière usine ne fut reprise aux ouvriers que par l’usage des mitrailleuses et des canons.
Dans la dernière décade de mars, les paysans du Novarais se mettent en grève tandis qu’à Turin, 5.000 ouvriers de la chaussure, les ouvriers du textile et les fonctionnaires font de même. Le 25 mars un incident a lieu à la Fiat, les locaux sont occupés : occupés matériellement parce que les Conseils avaient déjà « envahi » l’usine avant, lui avaient arraché ses secrets, en avaient chassé les espions et les valets des patrons, y avaient dicté une nouvelle discipline interne, s’étaient documentés sur les indices de prix, de productivité, s’étaient liés au personnel technique, avaient organisé des sections armées pour défendre l’usine.
Les industriels réagirent en décrétant le lock-out. 50.000 métallurgistes entrent en grève.
Les tractations traînèrent vingt jours durant lesquels firent grève pour des raisons catégorielles, les ouvriers du papier et les employés des postes et télécommunications. Le 14 avril, la grève générale est déclarée dans tout le Piémont ; Alexandrie, Asti, Novare, Casale, Biella, Vercelli y participent. Le 15, les cheminots de la province de Turin entrent en grève. La grève s’étend jusqu’aux receveurs d’impôts et aux gardes municipaux. Les industriels semblent vaincus.
Mais le gouvernement est de leur côté et il décide d’envoyer des troupes à Turin. Il envoie le 231ème régiment d’infanterie qui sera cependant bloqué par les cheminots. On essaie de transporter des troupes à Gênes à bord d’un navire de commerce mais les marins refusent. Finalement, on les embarqua sur le cuirassé « Caio Duilio », qui une fois arrivé à Gênes trouva la ville et le port en grève générale. La même chose se produisit pour les « Gardes royales » embarquées sur le contretorpilleur « Carini ». A terre, les cheminots de Florence, Pise, Lucques imitent leurs camarades de Livourne.
La grève générale s’étend par solidarité jusqu’à Bologne.
Nous sommes désormais à la veille d’une grève générale politique insurrectionnelle. Les Conseils d’usine de Turin, l’Union Syndicale Italienne et les anarchistes l’invoquent concordément. Des accords interviennent entre ces trois forces : socialistes des Conseils, syndicalistes révolutionnaires et anarchistes.
Malatesta, qui était depuis peu revenu en Italie et qui dans un rapide tour de la péninsule s’était voué à préparer dans la conscience des masses le concept de révolution, avait répondu à un groupe de socialistes turinois venu à la rédaction d’Umanità Novapour savoir quelle serait l’attitude des anarchistes : « Quelles que soient les circonstances, les anarchistes feront tout leur devoir ». De même, les responsables de l’U.S.I. leur avaient donné l’assurance de leur complète solidarité avec le mouvement.
La délégation des Conseils se rendit également aux réunions que tenait alors à Milan le Conseil National du Parti Socialiste (il aurait dû les tenir à Turin mais à Turin... c’était la grève) mais elle ne trouva là que l’hostilité ouverte des dirigeants du Parti, que des moqueries et des railleries et les membres de la délégation furent traités d’« anarchistes ». Ils apportaient la voix de Turin résistante, assiégée par 20.000 policiers et soldats, et l’Avantirefusait de publier l’appel de la section socialiste turinoise.
La trahison de la direction socialiste, incapable de concevoir, d’organiser, de vouloir le passage victorieux de la grève à l’insurrection, marque le sort du mouvement de Turin.
Le 24 avril, trente jours après le début de la grève des métallurgistes, dix jours après le début de la grève générale, c’est la reddition.
La reddition ne signifie pas seulement la capitulation des ouvriers devant les industriels mais le début de la contre-attaque que le patronat lance cette fois avec l’aide des fascistes.
Depuis longtemps à Turin, des rapports étroits s’étaient établis entre De Vecchi (directeur du journal fasciste l’Ardito)et les représentants de la Confindustria en l’espèce avec l’aile « libérale ». Comme en témoignent aujourd’hui des documents nombreux dont l’authenticité est indiscutable, ce furent les industriels turinois qui les premiers financèrent les entreprises fascistes et la presse fasciste. Agnelli, De Benedetti, Boella, Codogni, Mazzini, Lancia, Olivetti : voici les parrains du fascisme turinois.
Et le fascisme turinois servit les industriels.
Le 27 avril, deux jours après la fin de la grève, les fascistes turinois lancent un manifeste qui est un abject tissu d’hypocrisie, mais qui mérite d’être lu seulement pour comprendre comment la provocation et le mensonge peuvent se camoufler sous une phraséologie extrémiste et philo-prolétarienne. Le 1er mai, à Turin, durant la manifestation commémorative, le sang de deux travailleurs tués et de trente autres blessés par les balles des « gardes royales », consacre cette page de lutte du prolétariat turinois.
La bataille d’Avril est finie. On se rapproche de celle de Septembre.
En septembre, cependant, l’occupation des usines ne mettait pas en avant les problèmes d’expropriation et de gestion directe mais plutôt la question économique du « contrôle » de l’entreprise. L’action portée sur un tel terrain ne pouvait que déboucher sur des « pourparlers » entre la C.G.L. et la Confindustria, avec la médiation du gouvernement Giolitti. Entre les projets et les contre-projets, l’agitation, démarquée dans de nombreuses villes des plans de la bureaucratie confédérale par des expériences pratiques de gestion directe à la base, était reconduite sur le terrain de la légalité.
Toutefois, la présence des Conseils d’usine au cours de la lutte conduisit à deux résultats importants :
a) Elle accentua le caractère révolutionnaire de l’« occupation », si bien que l’accord survenu sur la base du « contrôle » apparut aux masses laborieuses comme une trahison ;
b) Elle prouva pratiquement que partout où existaient des Conseils d’usine, l’occupation ne fut pas seulement symbolique mais réelle en ce sens que, à travers mille difficultés techniques et financières, un rythme normal ou quasi-normal de production fut maintenu dans les usines. Citons comme exemple, les usines Galileo de Florence (dont le secrétaire de Commission interne était un anarchiste) qui réussirent à maintenir la production à 90% de la normale et à surmonter les énormes difficultés d’ordre organisationnel, technique, financier, militaire et d’assistance.
Ce n’est pas pour rien que la résistance fut la plus tenace et la reddition la plus difficile à arracher dans les usines tenues par les Conseils.
IX LA TRADITION DES CONSEILS
Il n’existe pas seulement une tradition italienne des Conseils, qui se rattache aux expériences de l’après-guerre rouge. Il existe une tradition européenne, mondiale. En Russie, le mouvement des Conseils eut un large développement durant la période de préparation révolutionnaire jusqu’à octobre puis sur la base des Conseils se développèrent deux courants : celui de l’« Opposition Ouvrière » de Schiapnikov, Lutocinov et Kollontaï et celui du mouvement de Kronstadt qui avançait, entre autres revendications, justement un retour aux Conseils. Et encore dix ans après la révolution de 1917 un courant d’extrême gauche résistait encore dans le parti bolchevik, courant dit de Smirnov, qui revendiquait le retour aux Conseils.
En Allemagne, la révolution brandit le drapeau des Conseils : les Conseils (Raete)constituent la forme de développement de la révolution en 1918, en 1919, en 1921 et en 1923. Le système des Conseils forme en outre le noyau essentiel du programme du « Spartakusbund » et plus tard devait surgir un parti partisan du Communisme de Conseils : le Parti Ouvrier Communiste d’Allemagne (K.A.P.D.) appuyé par une organisation de masse : l’Union Générale Ouvrière d’Allemagne (A.A.P.D.).
En Hollande se développa un important mouvement théorique autour de l’idée des Conseils : ce sont les « tribunistes » qui s’étaient déjà distingués avant la guerre par leur critique de la social-démocratie et au cours de la guerre par leur position internationaliste intransigeante, qui alors recueillirent cette idée, collaborant étroitement avec la gauche allemande. Herman Gorter et Anton Pannekoek devinrent les théoriciens de cette tendance.
En France, dans de nombreux groupes, on accorde une place de choix au problème des Conseils : le groupe « Spartacus » avec René Lefebvre et des noyaux d’exilés italiens et allemands s’en occupent plus particulièrement (en 1951, rappel du T.). Dans la myriade de publications des groupes révolutionnaires, la question des Conseils est soumise à un profond réexamen critique.
En Hongrie et en Bavière, l’expérience des Conseils ne se conclut qu’après le triomphe de la contre-révolution.
Partout, mais surtout en Bavière, en Hollande et en Allemagne, les anarchistes participèrent de façon positive à ce long travail pratique et théorique.
Notes
1) Unification de l’Italie autour du royaume de Piémont-Sardaigne dont Turin est la capitale. Turin reste capitale du royaume d’Italie de 1859 à 1864, puis ce fut Florence et en 1870, Rome (N.D.T.).
2) La révolte qui dura 4 jours et eut presque les caractères d’une insurrection armée vit les anarchistes au premier plan dans l’organisation du mouvement de contestation. « A Barriera di Milano [un quartier ouvrier de Turin où un des groupes anarchistes de la ville était bien implanté] existait un véritable centre d’organisation de la révolte, qu’un groupe d’anarchistes dirigeait. Ce témoignage est précieux outre que tout à fait digne de foi, vu le caractère des groupes libertaires turinois et l’action déployée au cours des mois précédents ». Paolo Spriano : Storia di Torino operaia e socialista, Torino 1972, page 421 (N.D.T.).
3) Pietro Mosso, né à Cerreto d’Asti le 10 janvier 1893, mort dans la zone d’Asti le 29 janvier 1945 au cours d’un bombardement aérien, avait collaboré au début de l’après-guerre à L’Ordine Nuovo(citons entre autres articles Le système Taylor et les conseils des producteurs, du n° du 25 octobre au n° du 22 novembre 1919 ; cette étude aurait dû être éditée comme cahier dans une collection, où l’on annonçait aussi un essai de A. Gramsci sur Le problème du pouvoir prolétarien, mais l’initiative est restée à l’état de projet ; l’article Bougeoisie et production en régime communistedans le n° du 7 juin 1919 ; une intervention dans la polémique entre For Everet le journal ayant comme titre Communisme anarchistedans le n° du 26 juillet 1919, une discussion avec p.t. (Palmiro Togliatti) dans le n° du 30 août 1919 ; une revue de presse à Émile Vandervelde, Le socialisme contre l’Etatdans le n° du 21 juin 1919) à Umanità Nova(Pièges dans le n° du 1er avril 1920), à Volontà(La liberté anarchiste,16 mars et 1er avril 1920 ; Dictature prolétarienne, soviets et anarchie,16 septembre 1919).
Bien que s’étant distingué par sa lucidité et la méthode scientifique avec laquelle il analysait les problèmes, il n’a jamais participé à la vie politique militante du mouvement anarchiste.
Il était connu aussi pour son activité académique à l’Université de Turin où il était assistant du Professeur Annibale Pastore à la chaire de Logique (Cfr. ses oeuvres Principes de logique de l’augmentation de la puissance,Turin, Bocca, 1923, 41 pages ; Hypothèses sur la logique de l’augmentation de puissancein A. Pastore, Logique expérimentale,Naples, Rondinella, 1939) et pour sa compétence technique professionnelle en tant qu’ingénieur mécanique (système Mosso pour la constructions de refuges blindés).
De Carlo Petri, Gramsci a écrit : « Dans la rédaction de l’Ordine Nuovo nous avons un communiste libertaire : Carlo Petri. Avec Petri la discussion est sur un plan supérieur : avec les communistes libertaires comme Petri le travail en commun est nécessaire et indispensable : ils sont une force de la révolution ».
4) Pietro Ferrero est né à Grugliasco, (Turin) le 12 mai 1892 ; en 1918 il est entré chez Fiat. Il a été un des premiers adhérents au Cercle d’études sociales né à Barriera di Milano en février 1905 qui avait pour but de lutter contre le réformisme. Lorsque le cercle s’est transformé en « école moderne » il en est devenu le secrétaire (1911). L’école - qui s’inspirait de l’idéal pédagogique de Francisco Ferrer - avait étendu son activité dans différents quartiers ouvriers de la ville, et avait une véritable fonction d’université prolétarienne. Pendant la guerre Ferrero a fait une propagande active dans les usines et dans l’organisation syndicale pour faire triompher la ligne intransigeante d’opposition à l’entrée des représentants ouvriers dans les comités de mobilisation industrielle. Autour de lui et de Garino s’est réuni un groupe de militants de la FIOM qui s’est engagé dans une forte bataille antiréformiste et anticorporative. Elu secrétaire de la section FIOM de Turin en 1919 au cours d’une assemblée de commissaires d’ateliers, il a laissé son poste de mécanicien chez Fiat et s’est consacré à plein temps à l’organisation des conseils d’usine. Lorsqu’il était secrétaire, la section s’est engagée dans des batailles décisives telles la « grève des aiguilles » (avril 1920) et l’occupation des usines (septembre). Avec Garino, il a rédigé l’appel Pour le congrès des Conseilsparu le 27 mars 1920 dans l’Ordine Nuovo,En juillet, dans la période la plus explosive qui a précédé l’occupation, il a présidé une assemblée de membres de commissions internes au terme de laquelle a été approuvé un ordre du jour qui invitait la FIOM à entreprendre la lutte aux côtés de l’USI et déclarait que « la masse turinoise est prête à tout ». Au cours de l’occupation il a déployé une activité très intense, se déplaçant le jour et la nuit d’une usine à l’autre pour maintenir le contact avec les ouvriers armés, soutenant l’action à fond contre tout compromis. Au congrès organisé par la FIOM nationale à Milan pour ratifier la décision d’évacuer les usines à la suite de l’accord D’Aragona-Giolitti, il s’est opposé vigoureusement en adoptant les paroles d’Errico Malatesta : « Si les ouvriers trahis abandonnent les usines, l’on ouvre la porte à la réaction et au fascisme ». Il est mort à Turin le 12 décembre 1922. Par « représailles » pour les blessures causées à deux fascistes pour un fait privé les squadristiincendièrent la Chambre du travail, dévastèrent le siège de l’Ordine Nuovo, fouillèrent, frappèrent et finalement massacrèrent 22 personnes, et en blessèrent autant. Parmi les victimes il y avait Ferrero, qui fut blessé par plusieurs coups de feu, puis suspendu par les pieds à un camion et traîné, vivant encore, sur les pavés de l’avenue Vittorio Emanuele. Son cadavre a été retrouvé après minuit, sous la statue de Vittorio Emanuele II, et identifié seulement grâce à une carte de la Croix verte qu’il avait sur lui. (d’après une biographie de A. Andreasi) N.d.T.
5) Maurizio Garino, né à Ploaghe (Sardaigne) le 31 octobre 1892 de mère sarde et de père piémontais, mort à Turin en 1976, a vécu en Sardaigne jusqu’à l’âge de trois ans, quand sa famille s’est installée à Turin. Il a travaillé tout d’abord comme menuisier, puis comme modeleur mécanicien (il a été plus tard dirigeant d’une coopérative de production entre ouvriers modeleurs, la SAMMA). Inscrit en 1908 au mouvement des jeunes socialistes il en est sorti en 1910 pour fonder le cercle d’études sociales « F. Ferrer » de Barriera di Milano. Il a participé à toutes les manifestations prolétariennes les plus importantes : à la protestation contre l’arrestation et l’assassinat de Ferrer, aux agitations contre la guerre de Lybie, à la semaine rouge, aux désordres d’août 1917 contre la guerre mondiale impérialiste, aux Conseils d’usine, à l’occupation des usines, à la lutte antifasciste, etc.
6) Sur le Groupe Libertaire Turinois nous reprenons volontiers ces informations du camarade Garino : « Le Groupe Barriera di Milano qui a tant donné au mouvement ouvrier turinois dans la période 1910-1922 était le plus nombreux et homogène et composé presque exclusivement d’ouvriers. A part moi-même, Ferrero y adhérait et en a été le secrétaire pendant quelques années puis laissa sa place pour devenir secrétaire de la Fiom de la province ; et aussi Vianello, Mairone Antonio, interné plus tard dans les camps de concentration nazis, Garino Antonio, Piolatto, Carabba Quirico, Berra, Cocchi, Carrara et beaucoup d’autres tout aussi dignes que l’on se souvienne d’eux mais dont malheureusement je ne sais plus le nom ».
7) Nous avons traduit accantonamento(littéralement : cantonnement) par « isolement » qui exprime mieux la thèse défendue par L’Ordine Nuovo : le pouvoir grandissant des Conseils entraîne de fait l’extinction de l’État qui se trouve réduit à une forme sans contenu ni pouvoir (N.D.T.).
8) Guerra di Classe,an VI, n. 1, 1 janvier 1920.
9) Voir Umanità Nova, 18 juin 1920.
10) Voir Annexes.
11) Voir reproduction intégrale en annexes.
ANNEXES
POUR LE CONGRES DES CONSEILS D’USINE AUX OUVRIERS ET PAYSANS D’ITALIE (1)
Ouvriers de Turin ! Quelques mois se sont écoulés depuis que grâce à vous le mouvement pour la constitution des Conseils d’usine a pris son essor dans l’industrie turinoise.
Après plus de six mois de discussions, d’épreuves et de dur travail, la nature et les buts de ce mouvement sont désormais clairs. On voit clairement quels sont ses éléments de valeur transitoire, quels sont au contraire ses principes essentiels nouveaux qui inspirent la formation des organismes dans lesquels la vie et la lutte de votre classe trouvent une nouvelle forme. On voit les principes pour lesquels vous vivez et travaillez et pour lesquels vous êtes prêts à lutter. Il faut tirer les conclusions du travail accompli, en extraire une norme sûre pour l’avenir, utiliser les fruits de la précieuse expérience que vous avez recueillie dans la tentativede résoudre les problèmes qui se présentent à l’heure actuelle à quiconque participe à la vie de la classe ouvrière. Vous avez démontré, en vous mettant directement, spontanément au travail, que vous jugez cette méthode supérieure à l’autre, qui conseille d’attendre les enseignements et les plans provenant de haut.
Vous avez démontré que vous voulez vous-mêmes devenir les maîtres de votre destin, que vous comprenez la rédemption de la classe des travailleurs comme une oeuvre que les travailleurs eux-mêmes doivent réaliser. Vous avez démontré qu’une nouvelle conscience est née en vous ; conscience qui cherchait une forme et un mode d’action dans lesquels se concrétiser et s’affirmer, et cette forme vous avez su la trouver. Les discussions que vous aurez aujourd’hui, les solutions que vous estimerez bonnes d’adopter, les plans que vous proposerez auront l’inestimable valeur d’être soutenus par une connaissance qui s’est formée dans les faits, par une volonté qui s’est consolidée dans l’action, par une résolution qui s’est renforcée, qui est devenue confiance tenace et inébranlable. Nous jugeons donc que le moment est venu de vous inviter à un congrès qui examine la quantité et la qualité du travail accompli jusqu’à présent et dans quelle direction il faut poursuivre. Nous invitons à y participer à vos côtés les ouvriers des usines et les paysans de toute l’Italie, par l’intermédiaire de leurs représentants directs.
Ouvriers de toute l’Italie.
L’appel à ce Congrès de Turin que nous vous adressons au nom des ouvriers turinois n’est ni un signe de vanité, ni d’orgueil particulier. Les ouvriers turinois sont persuadés que, s’ils se sont trouvés à l’avant-garde du mouvement de préparation prêt à la gestion communiste future de l’usine et de la société, cela ne constitue pas pour eux un titre spécial de fierté si ce n’est parce que c’est le signe qu’ils se sont retrouvés pour vivre et travailler dans des conditions spéciales qui ont favorisé le développement d’une conscience révolutionnaire et une capacité de reconstruction dans la masse des travailleurs.
Mais la concentration industrielle et la discipline unitaire instaurée dans les usines de Turin sont des conditions qui ont tendance à s’étendre à tout le monde de l’économie bourgeoise, ce sont les conditions dans lesquelles la classe des patrons cherche son salut.
Ouvriers, vos patrons, vos ennemis cherchent à résoudre aujourd’hui le problème de la conservation dans leurs mains du pouvoir social, par la création d’un système national et mondial qui garantisse le profit sans travail, qui défende leur activité absolue, qui leur permette de vous repousser, lorsqu’ils en auront la force, dans l’abîme d’obscurité et de misère dont vous voulez sortir à tout prix.
Votre volonté et votre conscience d’hommes se rebellent. Mais cette rébellion restera stérile, s’épuisera en vaines tentatives de révolte sporadique, facilement maîtrisables, difficilement dirigées vers un but durable, si vous ne parvenez pas à renouveler les formes de la lutte que vous voulez entreprendre, qui s’étend toujours plus et devient âpre et difficile. Vous devez passer de la défense à la conquête, tout le monde vous le répète, mais comment ? Les organismes de résistance, qui vous ont conduits jusqu’à présent, où vous vous réunissiez par catégorie et par métier, ont-ils en eux-mêmes la possibilité de se transformer valablement vers les nouveaux buts, vers les nouvelles méthodes de lutte ? Tout d’abord leur cristallisation dans une forme bureaucratique est très nuisible. Elle les empêche de répondre directement aux besoins, à la volonté, à la conscience des masses, qui aujourd’hui, en période révolutionnaire, se transforment rapidement.
Et de plus : la lutte de conquête doit être menée avec des armes conquérantes et non plus de défense seulement. Une nouvelle organisation doit se développer, comme opposition directe aux organismes de gouvernement des patrons. Elle doit donc naître spontanément sur les lieux de travail, et réunir tous les travailleurs car tous, en tant que producteurs sont soumis à une autorité qui leur est étrangère et dont ils doivent se libérer. Le pouvoir du patron prend sa forme concrète dans les organismes qui règlent la production capitaliste. La volonté de votre classe aussi doit se concrétiser dans une forme d’organisation qui adhère au procès de la production, et dans laquelle chacun de vous soit amené à acquérir la capacité d’auto-gouvernement.
Voilà pour vous l’origine de la liberté : l’origine d’une formation sociale qui s’étendra rapidement et universellement, et vous permettra d’éliminer l’exploiteur et l’intermédiaire du terrain économique, de devenir vous-mêmes les patrons, les maîtres de vos machines, de votre travail, de votre vie, du destin de votre classe, d’être finalement les plus forts, dans la lutte de classes.
Mais même les organismes syndicaux se renforceront au contact intime avec les organismes de représentation des usines. On brisera l’oppression de la structure bureaucratique, l’on cherchera à dépasser même dans le terrain syndical le principe de l’union par métier, pour appliquer le principe nouveau de l’union par unité de production. L’on préparera ainsi des organismes qui auront en eux-mêmes dans un prochain avenir la capacité non plus de régler les conditions du marché de la main d’oeuvre salariée, mais de coordonner l’oeuvre des producteurs associés pour faire valoir, sur le terrain économique, seulement leur volonté.
Ouvriers, l’action des Commissaires d’atelier et des Conseils d’usine est la préparation à la révolution communiste de la société. Le fait qu’elle parte de l’équipe de travail, de l’unité élémentaire de production, ne lui enlève pas ce caractère. Au contraire, ayant en elle tant de force, elle peut espérer triompher avec la conquête de tout le pouvoir social. Les patrons l’ont bien compris, ils dressent l’oreille, ils sont en train de se mettre d’accord pour coordonner leur action, afin de vous livrer bataille lorsqu’ils le jugeront bon. Vous devez aussi vous organiser dans le même but, afin d’être les plus forts à l’heure suprême, pour ne pas disperser prématurément vos forces, pour les accroître dans la concorde, dans l’union, dans un même programme d’action. L’unité des prolétaires, bien que recherchée en vain par des accords entre les différents organismes de direction, entre les chefs, séparés par des rivalités personnelles, est néanmoins nécessaire à votre victoire. Et bien, nous croyons qu’elle naîtra spontanément quand vous vous unirez tous, dans l’atelier où vous êtes tous égaux, pour créer des institutions qui représentent et expriment votre réelle volonté.
Paysans, c’est à vous aussi que nous adressons l’appel à participer aux travaux du Congrès des commissaires d’atelier, parce que vous aussi vous êtes opprimés par la structure capitaliste pesante que les ouvriers veulent briser. C’est ici, dans les villes, que se trouvent le centre des banques qui absorbent vos économies, qui vous les volent pour les consacrer à financer les activités de rapine du capitalisme. C’est ici que se trouvent les représentants du pouvoir d’Etat que vous considérez comme un ennemi, parce qu’il garantit le droit de vos patrons et de vos exploiteurs. Les ouvriers sont vos alliés naturels, mais il vous faut vous mettre sur la même voie qu’eux et préparer dès l’heure tous les organismes aptes à vous donner le pouvoir économique et social.
Travailleurs, camarades :
Le Congrès des Commissaires d’atelier qui aura lieu à Turin avec la participation des ouvriers et des paysans de toute l’Italie va pouvoir marquer une date importante dans l’histoire du développement de la révolution prolétarienne italienne. Nous aimerions qu’il en émerge, si ce n’est une façon de voir explicite nouvelle, tout au moins le premier signe que toute la classe a commencé à s’organiser pour une conquête effective, et que les travailleurs de l’Italie entière se mettent spontanément à étudier les problèmes que la révolution leur présente, et qu’ils cherchent à les résoudre de façon unitaire, concrète, cohérente. Nous voulons que ce Congrès soit une manifestation de force et de sérieux d’une classe qui est à la veille de sa libération. A vous de réaliser ce programme.
RAPPORT SUR LES CONSEILS D’USINE ET ENTREPRISE (2)
Le problème des conseils d’usine et d’entreprise revêt en ce moment une importance particulière même en ce qui concerne le mouvement anarchiste communiste. Issu de raisons sociales profondes, il s’est imposé en peu de temps à l’attention des organisations politiques et économiques de la classe ouvrière, apparaissant comme un postulat de premier ordre. Surgi au début d’un centre industriel où l’existence d’établissements énormes avait créé des conditions très favorables, il s’est diffusé dans plusieurs localités. Maintenant, les tentatives de création des conseils sont nombreuses, dans les conditions les plus différentes. Certes, ce nouvel organisme s’est frayé un chemin à travers des obstacles importants. L’ambiance même de la première expérience où il s’est déroulé, a offert de grandes facilités, et elle a également offert, pour des raisons diverses, de tenaces résistances. Les plus importantes, au début, apparurent sur le plan syndical, mais elles furent dépassées par l’élan des organisés eux-mêmes. D’âpres résistances furent opposées par les patrons de l’industrie, dès qu’ils eurent la certitude que les conseils tels que nous les entendions annonçaient la révolution et non la collaboration ; profitant d’une situation qui nous était défavorable, ils donnèrent l’assaut avec l’intention de nous étouffer. Malgré tout cela, les conseils se renforcent aujourd’hui, entraînant dans leur orbite de nombreux éléments qui leur étaient contraires, gagnant chaque jour plus de sympathie dans le milieu ouvrier.
Il est donc opportun de notre part d’examiner cette importante question non seulement pour éclairer et préciser notre attitude à son égard, mais éventuellement pour nous préparer à défendre les conseils contre de possibles déviations, que des organisations ou des hommes de droite pourraient leur imprimer. La conviction que nous sommes finalement à la veille d’une transformation sociale qui, si elle ne nous mènera pas à la réalisation des postulats les plus importants de l’idée anarchiste, déblayera certainement le terrain pour des conquêtes ultérieures, est une prémisse indispensable avant d’affronter l’étude des conseils. La nécessité de forger, dans la recherche de possibilités bien délimitées, des armes mieux adaptées à la poussée révolutionnaire, nous a conseillé de favoriser l’éclosion de ces nouveaux organismes. Ce sont des instruments excellents : d’abord pour l’action immédiate, ensuite pour garantir la continuité de la production dans la période insurrectionnelle et enfin parce qu’ils peuvent être les cellules de base de la gestion communiste.
Le conseil d’usine est un organisme en soi. Il regroupe tous les producteurs manuels et intellectuels sur le lieu même du travail. Etant édifié sur les différents moments de la production, il donne une garantie pour connaître tout le processus de la production. Par conséquent, il a en soi des qualités suffisantes pour assumer l’éventuelle gestion, en se débarrassant de l’enveloppe capitaliste, en rejetant hors du système de production tous les éléments parasites.
En outre, comme moyen de lutte révolutionnaire immédiate, le conseil est parfaitement adapté, tant qu’il n’est pas influencé par des éléments non communistes. Il substitue à la mentalité du salariat la conscience du producteur, en donnant au mouvement ouvrier une tendance claire à l’expropriation. Une des plus grandes qualités des conseils comme moyen de lutte révolutionnaire est précisément celle-ci : il porte la lutte de classe sur son terrain naturel et il la dote d’une grande force.
L’ascendant que la machine possède sur l’ouvrier est immense. Donnez-lui la sensation tangible que la machine, sur laquelle il passe une grande partie de son existence et à laquelle il est indissolublement lié, peut et doit lui appartenir, et vous verrez qu’il demandera son droit sur elle, même s’il n’est pas un ouvrier considére comme " subversif ".
On a confondu le conseil d’usine avec le soviet. Il est utile de répéter que tandis que le premier encadre tous les producteurs sur le lieu de travail, dans le but de gérer les moyens de production, le deuxième est l’organe politique, par lequel les communistes autoritaires entendent exercer leur pouvoir.
Le conseil tel que nous l’entendons, devrait être le travail librement associé et coordonné pour produire les denrées et les objets nécessaires à la communauté. Loin de nous l’intention de dicter a priori une quelconque norme fixe, qui devrait organiser demain les relations entre les personnes. Nous laissons cet objectif à la révolution sociale, qui fera son chemin sans s’occuper des schémas de tel ou tel parti.
Mais comme nous sommes convaincus que la production loin de diminuer doit augmenter le lendemain même de l’insurrection et comme nous jugeons absurde dans les conditions actuelles de détruire et de désorganiser les grands complexes industriels, où se trouvent les systèmes de production les plus avantageux et les plus rapides, nous sommes décidés à nous préserver de toute surprise en constituant dès maintenant une libre confédération de conseils. Au fur et à mesure des besoins, elle formera des bureaux techniques et de statistiques, en étendant un réseau de rapports utiles entre les différentes communautés qui auront indiscutablement intérêt à se mettre d’accord sur un travail d’entraide.
Nous avons parlé plus haut des soviets. Il est bon de préciser les rapports que, d’après les communistes autoritaires, les conseils d’usine devraient avoir avec ces organismes, sans approfondir les raisons qui nous portent à croire que nous ne pouvons pas adhérer au système des soviets et à leur fonction, comme les veulent les socialistes et tels que même la Troisième Internationale les a fixés. Nous jugeons que si nous devrons subir le soviet politique, il ne doit toutefois absolument pas s’introduire dans la vie des conseils d’usine. Voilà pourquoi nous sommes résolument contraires aux superstructures politiques qui enveloppent les organismes de production afin de les maintenir dans l’orbite de l’Etat, même socialiste.
Pour les communistes autoritaires les conseils d’usine de l’entreprise devraient être une partie des éléments constituant le soviet. C’est-à-dire que le conseil devrait nommer ses représentants au soviet de la ville, de la province, etc... lesquels, devraient assumer avec les représentants des conseils des autres fractions productives, la fonction des actuels conseils municipaux, départementaux, etc... jusqu’à remplacer le parlement (représentants des différentes classes sociales, représentants nationaux des seuls producteurs) par le commissariat central des soviets, et le gouvernement actuel par le Conseil des commissaires du peuple.
Il est évident qu’en prenant le premier élément de représentation au soviet dans le conseil d’usine ou d’atelier, les communistes le revêtent d’un mandat politique et jettent ainsi les bases de la dictature prolétarienne au beau milieu d’un organisme qui doit par sa nature rester étranger à toute fonction de gouvernement. Au contraire, cette nature rend d’après nous le conseil un organisme authentiquement anti-étatique.
Les finalités des conseils, tels que les veulent nos " cousins ", divergent donc fondamentalement des nôtres. Tandis que nous visons à abattre tout pouvoir et acceptons le conseil en tant qu’organisme anti-étatique, ils veulent y jeter les bases du nouvel Etat, inéluctablement centralisateur et autoritaire, lui faisant développer sa fonction à travers la hiérarchie représentative des différentes gradations des soviets.
Nous avons dit plus haut qu’à leur naissance les conseils ont trouvé des obstacles de la part d’organismes syndicaux préexistants. Comme ces résistances étaient motivées par de profondes raisons d’ordre public et syndical, il est bien d’en parler.
Les vieilles organisations économiques à système centralisé (conférérales) et leurs dirigeants, ont vu dans l’institution des conseils (tels que nous les entendons) un grave danger, un danger même mortel pour les syndicalistes.
La lutte que les personnes organisées de cette ville ont dû soutenir pour ouvrir une brèche dans la vieille mentalité syndicale a été très dure.
La victoire qu’ils ont remportée correspondait aux besoins de la masse ouvrière, lassée désormais d’une discipline pas toujours nécessaire, et qui aspirait à une plus grande liberté d’action. La transformation de ces organisations fut le premier but des partisans des conseils qui, à travers le syndicat, réussirent par la suite à faciliter le développement des conseils. L’innovation consistait à donner un droit de délibération dans le syndicat à l’assemblée des commissaires d’atelier, qui tout en étant organisés, étaient élus par tous les ouvriers syndiqués ou non, indistinctement - à raison d’un élu pour trente ouvriers -. Il est facile de comprendre pourquoi un tel système était inacceptable pour cette organisation puisque les inorganisés auraient influencé les directives du syndicat.
Les syndicalistes désiraient donc limiter la nomination des commissaires d’atelier par les ouvriers. Cependant le système que nous avons choisi et qui confondait - durant un certain temps - le conseil d’usine avec le syndicat, représentait le seul modus vivendi qui sauvait l’esprit des conseils d’usine et éliminait dans la période de l’action des oppositions trop graves entre les conseils et le syndicat, en fournissant de cette manière une base unique de délibération.
Par contre, en excluant les inorganisés du droit de vote, on ajoutait un nouvel appendice au syndicat. Le contraste entre les deux thèse est évident ; l’acceptation de la thèse syndicale aurait complètement dénaturé les conseils.
Une seconde thèse soutenue par les socialistes centristes est l’élection des conseils par tous les producteurs, qui ont droit à élire des commissaires. Cependant ces commissaires sont tenus à l’écart de la direction syndicale et admis uniquement en tant qu’organe consultatif et chargé de certaines tâches syndicales dans les ateliers en attendant que les syndicats prennent la direction des entreprises. Cette thèse est également opposée à l’esprit des conseils en tant qu’elle les soumet à des organismes auxquels - tout en ayant aujourd’hui quelques points de contact - ils ne peuvent en aucun cas être soumis, puisqu’ils tirent exclusivement de l’unanimité des producteurs leur raison d’être, ce qui est profondément différent de ce qui anime les syndicats.
L’accusation de vouloir tuer les syndicats nous a été injustement faite en plusieurs occasions. Nous admettons que l’action des syndicats est en partie absorbée par le conseil, mais nous avons la conviction que ce dernier exerce une influence féconde sur le syndicat, puisqu’il le rapproche des vibrations de la masse, en le mettant en mesure d’interpréter de près les besoins.
Nous reconnaissons donc implicitement que les syndicats ont encore aujourd’hui plusieurs raisons d’exister, d’exercer des fonctions encore nécessaires. Nous leur refusons cependant la possibilité d’aller plus loin - pas de façon absolue naturellement - que la défense des intérêts des ouvriers comme salariés et de créer - comme le conseil le fait avec une relative facilité - une prise de conscience claire de l’expropriation communiste.
Nous reconnaissons cependant que le conseil a aujourd’hui une base commune avec les syndicats. Ces derniers, en tant qu’organes de protection des intérêts ouvriers comme salariat, s’engagent à observer des pactes et des accords pris au nom de la collectivité, pour plusieurs usines. Le pouvoir des syndicats s’étend donc sur de vastes groupements d’usines et, surtout aujourd’hui où la tendance à créer de grands syndicats d’industries, va jusqu’aux catégories les plus récalcitrantes pénètre dans l’usine en tant que contrôle de l’application et du respect des pactes de travail des conseils, composés presque toujours des mêmes adhérents que l’organisation syndicale.
Sur ce terrain le conseil est obligé en fait d’aider le syndicat (dire qu’il ne le fera pas officiellement est un sophisme), sauf dans le cas où cette fonction deviendrait un objectif, ce qui comme nous l’avons vu, dénaturerait le conseil. Trop souvent cette fonction que les conseils acceptent à contrecoeur, leur a donné l’aspect de suite des vieilles commissions internes. Ainsi , on s’est basé sur le fait que dans certaines localités la commission interne exerçait de grandes fonctions dont certaines étaient fusionnée avec les syndicats d’industrie, pour dire que sa structure est identique au... conseil d’usine.
La comparaison n’est valable que superficiellement, mais si nous voulons au contraire approfondir nous trouverons une nette différence, pour les raisons déjà exposées, et non seulement à cause de notre façon de voir les conseils, mais aussi à cause de celle des communistes autoritaires.
Aujourd’hui les différentes thèses tendent à se diviser entre deux conceptions fondamentales : le conseil en tant qu’organisme anti-étatique et le conseil en tant qu’organisme de pouvoir.
Au niveau pratique les partisans de celles-ci appliquent généralement leurs idées fondamentales.
Dans les rapports entre les conseils et les syndicats les éléments socialistes, des centristes aux communistes, se sont mis d’accord en ligne générale sur une plateforme (congrès de la bourse de Turin, motion Tasca), qui tout en voulant laisser aux conseils la possibilité d’un développement, garantit le syndicat contre l’influence des éléments non adhérents, par la création de conseils généraux formés par les comités exécutifs des conseils d’usine des ateliers où les organisés regroupent 75% des ouvriers, et de commissions spéciales nommées par les seuls organisés s’ils sont moins de 75%. L’intention du professeur Tasca est nous le croyons, ainsi que ceux qui ont accepté sa motion (car je suppose qu’elle servira de base pour les discussions ultérieures au congrès socialiste) de suivre les conceptions élaborées à ce sujet par la Troisième Internationale (thèse Zinoviev), qui serait d’après Tasca la voie intermédiaire entre la thèse anarchiste et celle réformiste.
Pour notre part, ayant eu la chance de nous trouver présents à ce congrès et de participer aux discussions, nous avons présenté une motion à ce sujet, conformément à nos conceptions et qui a déjà été approuvée par le congrès anarchiste du Piémont. Et nous vous la soumettons.
Nous n’avons pas la présomption de croire que le problème est résolu. Nous vous avons seulement soumis le matériel à notre disposition à ce sujet et qui est le fruit de la dure expérience des premiers conseils en Italie, de leur naissance à aujourd’hui. Nous vous avons aussi exposé synthétiquement et objectivement quelques-unes des thèses principales.
Pour conclure, nous jugeons souhaitable de la part des anarchistes communistes de favoriser la création et le développement de ces instruments de lutte et de conquête sans en faire toutefois l’unique terrain d’action et de propagande, et comme par le passé sans nous enfermer dans le seul plan syndical, tout en continuant à développer notre plus grande activité sur le terrain politique.
Ainsi, sans nous faire des illusions excessives sur les vertus des conseils d’usine qui ne sont nullement miraculeuses, nous vous invitons à empreigner d’esprit anarchiste ces nouveaux organismes très utiles à la révolution et, si nous savons nous les rendre proches, au communisme anti-autoritaire 3.
AUX OUVRIERS METALLURGISTES ! (4)
Vous vous êtes emparés des usines, vous avez fait ainsi un pas important vers l’expropriation de la bourgeoisie et la mise à la disposition des travailleurs des moyens de production. Votre acte peut être, doit être le début de la transformation sociale. Le moment est plus propice que jamais. Le gouvernement est impuissant et n’ose vous attaquer. Tout le prolétariat, des villes et des campagnes, vous regarde avec une fébrile anxiété et est prêt à suivre votre exemple.
Si vous demeurez unis et fermes vous pourrez avoir fait la révolution sans qu’une goutte de sang ne soit versée 5. Mais pour que cela soit réalité, il faut que le gouvernement sente que vous êtes fermement décidés à résister en utilisant s’il le faut les moyens les plus extrêmes. Si au contraire il vous croit faibles et hésitants, il se tiendra sur ses gardes et tentera d’étouffer le mouvement en massacrant et en persécutant. Mais même si le gouvernement tente de réprimer, en particulier s’il essaie, tout le prolétariat s’insurgera pour vous défendre. Cependant un danger vous menace : celui des transactions et des concessions.
Sachant qu’ils ne peuvent vous attaquer de front, les industriels vont essayer de vous leurrer. Ne tombez pas dans le piège.
Le temps n’est plus aux pourparlers et aux pétitions. Vous jouez le tout pour le tout, tout comme les patrons. Pour faire échouer votre mouvement, les patrons sont capables de concéder tout ce que vous demandez. Et lorsque vous aurez renoncé à l’occupation des usines et qu’elles seront gardées par la police et l’armée, alors gare à vous !
Ne cédez donc pas. Vous avez les usines, défendez-les par tous les moyens.
Entrez en rapport d’usine à usine et avec les cheminots pour la fourniture des matières premières ; mettez-vous d’accord avec les coopératives et les gens. Vendez et échangez vos produits sans vous occuper des ex-patrons.
Il ne doit plus y avoir de patrons, et il n’y en aura plus, si vous le voulez.
SANS REPANDRE UNE SEULE GOUTTE DE SANG (6)
Nous avons dit que la nouvelle méthode d’action révolutionnaire entreprise par les ouvriers métallurgistes de prendre possession des usines, si elle était suivie par toutes les autres catégories de travailleurs, de la terre, des mines, du bâtiment, du chemin de fer, des dépôts de marchandises de tout genre, des moulins, des fabriques de pâtes alimentaires, des magasins, des maisons, etc., amènerait la révolution, qui se ferait même sans répandre une seule goutte de sang. Et ce qui semblait être jusqu’à hier un rêve, commence aujourd’hui à être une chose possible, étant donné l’état d’âme du prolétariat et la rapidité par laquelle les initiatives révolutionnaires se propagent et s’intensifient.
Mais cet espoir que nous avons ne signifie pas que nous croyons au repentir des classes privilégiées et à la passivité du gouvernement. Nous ne croyons pas aux déclins paisibles. Nous connaissons toute la rancoeur et toute la férocité de la bourgeoisie et de son gouvernement. Nous savons qu’aujourd’hui, comme toujours, les privilégiés ne renoncent que s’ils sont obligés par la force ou par la peur de la force. Et si pour un instant nous pouvions l’oublier, la conduite quotidienne et les propos exprimés tous les jours par les industriels et par le gouvernement avec leurs gardes royales, leurs carabiniers, leurs sbires soudoyés en uniforme ou non, sont là pour nous le rappeler. Il y aurait là pour nous le rappeler, le sang des prolétaires, le sang de nos camarades assassinés.
Mais nous savons aussi que le plus violent des tyrans devient bon s’il a la sensation que les coups seront tous pour lui.
Voilà pourquoi nous recommandons aux travailleurs de se préparer à la lutte matérielle, de s’armer, de se montrer résolus à se défendre et à attaquer.
Le problème est, et reste, un problème de force.
La phrase sans une seule goutte de sang, prise au pied de la lettre, restera, malheureusement !, une façon de dire. Mais il est certain que plus les travailleurs seront armés, plus ils seront résolus à ne s’arrêter devant aucune extrémité, et moins la révolution répandra de sang.
Cette noble aspiration de ne pas répandre de sang ou d’en répandre le moins possible, doit servir comme encouragement à se préparer, à s’armer toujours plus. Parce que plus nous serons forts et moins de sang coulera.
LA PROPAGANDE DU CAMARADE ERRICO MALATESTA (7)
Dans l’après-midi d’hier notre camarade Errico Malatesta a visité les établissements métallurgiques Levi e Bologna, et l’usine de chaussures Bernina, invité par les ouvriers de ces usines. Dans les trois établissements le travail continue dans l’ordre, malgré l’absence des techniciens et des employés. L’enthousiasme est très vif et tous les ouvriers n’entendent plus céder les usines à l’exploiteur oisif : l’ancien patron.
Errico Malatesta a parlé, et a été applaudi par les ouvriers et les ouvrières de Messieurs Bologna e Levi, à peine la journée de travail terminée. Il a illustré l’importance du mouvement d’expropriation actuel, l’inéiuctabilité de la révolution sociale. " Vous avez commencé - a dit l’orateur - la révolution en Italie. Les révolutions du passé avaient changé de gouvernement, sans détruire le système social bourgeois. Aujourd’hui au contraire les ouvriers ont pris possession des moyens de production, et par cet acte nouveau ils ont commencé la vraie révolution. Les patrons devront travailler comme vous et avec vous, s’ils veulent manger. Le gouvernement est impuissant à arrêter votre marche par la seule force brute. Bourgeoisie et gouvernement tenteront alors de vous leurrer : ils vous promettront beaucoup, tout ce que vous demanderez, les augmentations de salaires et le contrôle d’entreprise qui n’est qu’un piège, tout pour redevenir patrons. Si vous cédez, vous rentrerez à l’usine en esclaves, vos ateliers seront présidés par les gardes royales et les mitraillettes. Tout le prolétariat doit évidemment intervenir, malgré les tâtonnements et les indécisions de vos dirigeants. Vous ne devez céder les usines à aucun prix ; vous devez tenir dur. Malgré les décisions des "pompiers" la cause de la révolution n’est pas encore perdue ; il faut que les douches froides de vos chefs n’aient pas prise sur vous, si vous voulez que cette fois soit la bonne pour vous émanciper. Rappelez-vous de la noble mission que l’histoire vous a confié : une mission de libération et de progrès ".
A la fin de son discours notre camarade a été vivement applaudi.
TOUT N’EST PAS FINI ! (8)
Tout n’est pas fini ! Dans l’après-midi du 20, Errico Malatesta, réclamé avec nsistance, se rendait à l’atelier de Fibre Vulcanisée rue Monza à Milan, malgré la " fête nationale " on y travaillait ferme, comme du reste dans les autres ateliers occupés. Aux ouvriers et aux ouvrières réunis dans la cour à l’heure de la sortie, notre camarade tint un bref discours en appliquant notre pensée à la situation créée à la suite de l’accord entre les dirigeants ouvriers et les patrons, conclu à Rome avec l’absence inqualifiable du parti socialiste.
Retraçant à grands traits l’histoire du mouvement parti d’une lutte placée sur un plan purement économique pour aboutir, du fait de l’occupation spontanée des usines, à un véritable mouvement révolutionnaire, notre camarade y voit une des situations les plus favorables aux principes de l’émancipation intégrale, et il met en garde ses auditeurs sur les hésitations, les soucis bureaucratiques des dirigeants des organismes centraux, qui placent leurs calculs mesquins au-dessus du seul objectif que dans cette crise il faut défendre, au dessus des efforts du prolétariat conscient : la révolution sociale.
" Si les circonstances vous imposent - termine-t-il - d’abandonner malgré tout les ateliers, faites-le en sachant que pour le moment par la faute de vos dirigeants ineptes, vous êtes vaincus. Mais bientôt vous reprendrez la lutte et alors ce ne sera pas pour obtenir des concessions qui finissent en mystification, mais pour exproprier définitivement vos exploiteurs, sans aucune collaboration de classes d’aucune sorte ".
Le discours persuasif de notre camarade a été écouté avec la plus profonde attention et sa conclusion a été soulignée par de très vifs signes d’approbations.
Puis Errico Malatesta s’est rendu aussi à l’Atelier mécanique Franco Tosi et y a exposé nos conceptions, tout aussi écoutées. Ensuite il a a eu une discussion brève et aimable sur les possibilités techniques de la révolution. Notre camarade a été l’objet de la plus grande sympathie et aurait dû se rendre aussi chez Pirelli, et dans d’autres établissements, mais l’heure avancée ne le lui a pas permis.
LA PROPAGANDE DE ERRICO MALATESTA (9)
Accueilli par la sympathie habituelle des ouvriers, le camarade Malatesta a visité hier après-midi les Ateliers Mécaniques Italiens et l’établissement Moneta à Musocco. Désorientés, trompés et déçus par les tergiversations, les promesses illusoires et les expédients de basse politique de leurs propres dirigeants, les ouvriers attendaient avec anxiété une parole claire et sincère, une parole qui les rassurât et leur redonnât du courage. " Ceux qui célèbrent l’accord signé à Rome [entre les syndicats et les patrons] comme une grande victoire, vous trompent. La victoire revient effectivement à Giolitti, au gouvernement, à la bourgeoisie qui se sont sauvés de l’abime où ils allaient.
Jamais la révolution n’a été aussi proche en Italie, et n’avait eu autant de chances de réussite. La bourgeoisie tremblait, le gouvernement était impuissant face à la situation. Le pouvoir et la violence ne furent pas utilisés parce que vous avez su opposer au pouvoir du gouvernement un pouvoir supérieur, parce que par la conquête des usines vous aviez préparé votre défense avec les habitudes apprises pendant la guerre, vous aviez démontré que vous opposeriez la violence à la violence et que cette fois ce n’était pas vous, mais vos ennemis qui étaient en situation d’infériorité.
Parler de victoire alors que l’accord de Rome vous soumet de nouveau à l’exploitation de la bourgeoisie que vous auriez pu balayer, est un mensonge. Si vous livrez les usines, faites-le en étant convaincus que vous avez perdu une grande bataille et en ayant la ferme intention de reprendre et de réaliser fondamentalement la lutte, à la première occasion. Vous expulserez les patrons des usines et vous ne leur permettrez de rentrer que comme ouvriers, comme vos égaux, prêts à travailler pour eux et les autres. Rien n’est perdu si vous ne vous faites pas d’illusion sur le caractère trompeur de la victoire.
Le fameux décret sur le contrôle des usines est une plaisanterie, car il fait naître une nouvelle bande de bureaucrates qui, bien qu’ils viennent de vos rangs, ne défendront pas vos intérêts, mais leur place, parce qu’ils veulent combiner vos intérêts avec ceux de la bourgeoisie, ce qui est vouloir ménager la chèvre et le loup. Ne faites pas confiance aux chefs qui vous prennent pour des idiots et qui reculent la révolution de jour en jour. C’est à vous de faire la révolution, si l’occasion s’en présente, sans attendre d’ordres qui ne viennent jamais, ou qui n’arrivent que pour vous demander d’abandonner votre action. Ayez confiance en vous, en votre avenir et vous vaincrez ".
Il est inutile de dire que le discours direct et sincère de notre camarade, suivi attentivement par les ouvriers et les ouvrières, a fait une profonde impression.
DEUX JUGEMENTS HISTORIQUES SUR LES CONSEILS EN ITALIE
ERRICO MALATESTA (10)
L’occupations des usines. - Les ouvriers métallurgistes commencèrent le mouvement pour des questions de salaires. Il s’agissait d’une grève d’un genre nouveau. Au lieu d’abandonner les usines, ils restaient dedans sans travailler, en les gardant nuit et jour pour que les patrons ne puissent lock-outer. Mais on était en 1920. Toute l’Italie prolétarienne tremblait de fièvre révolutionnaire, et le mouvement changea rapidement de caractère. Les ouvriers pensèrent que c’était le moment de s’emparer définitivement des moyens de production. Ils s’armèrent pour la défense, transformant de nombreuses usines en véritables forteresses, et ils commencèrent à organiser la production pour eux-mêmes. Les patrons avaient été chassés ou déclarés en étant d’arrestation. ... C’était le droit de propriété aboli en fait, la loi violée dans tout ce qu’elle a de défense de l’exploitation capitaliste. C’était un nouveau régime, une nouvelle forme de vie sociale qui étaient inaugurés. Le gouvernement laissait faire, parce qu’il se sentait incapable de s’y opposer, comme il l’avoua plus tard en s’excusant de l’absence de répression.
Le mouvement s’étendait et tendait à embrasser d’autres catégories. Des paysans occupaient les terres. C’était la révolution qui commençait et se développait à sa manière, je dirai presque idéale.
Les réformistes, naturellement, voyaient les choses d’un mauvais oeil et cherchaient à les faire avorter. Meme " Avanti ! " ne sachant à quel saint se vouer, tenta de nous faire passer pour des pacifistes, parce que dans " Umanità Nova " nous avions dit que si le mouvement s’étendait à toutes les catégories, si les ouvriers et les paysans avaient suivi l’exemple des métallurgistes, en chassant les patrons et en s’emparant des moyens de production, la révolution se serait faite sans verser une goutte de sang. Peine perdue.
La masse était avec nous. On nous demandait de nous rendre dans les usines pour parler, encourager, conseiller, et nous aurions dû nous diviser en mille pour satisfaire toutes les demandes. Là où nous allions c’étaient nos discours que les ouvriers applaudissaient, et les réformistes devaient se retirer ou se camoufler.
La masse était avec nous, parce que nous interprétions mieux ses instincts, ses besoins et ses intérêts .
Et cependant, le travail trompeur des gens de la Confédération Générale du Travail et ses accords avec Giolitti suffirent à faire croire à une espèce de victoire avec l’escroquerie du contrôle ouvrier et à convaincre les ouvriers à laisser les usines, juste au moment où les possibilités de réussite étaient les plus grandes.
LUIGI FABBRI (11)
Si elle s’était étendue à toutes les autres catégories professionnelles, et si elle avait été soutenue par les partis et les organisations du prolétariat, l’occupation des usines, en août-septembre 1920, aurait pu entraîner une des révolutions les plus radicales et les moins sanglantes que l’on puisse imaginer. De plus, en la circonstance la classe ouvrière était pleine d’enthousiasme et efficacement armée. Le gouvernement même a avoué plus tard qu’il n’avait pas à l’époque de forces suffisantes pour vaincre autant de forteresses qu’il y avait d’établissements, où les ouvriers s’étaient barricadés.
Il n’en a rien été, à aucun moment !
Et la responsabilité en retombe un peu sur tous, principalement sur les socialistes qui représentaient le parti révolutionnaire italien le plus fort. En juin 1919 on n’a rien voulu faire, pour ne pas porter préjudice à une manifestation pour la Russie fixée par les socialistes pour les 20 et 21 juillet et qui n’eut finalement aucune efficacité. Au cours du soulèvement d’Ancone en 1920 les communistes qui dirigeaient le parti socialiste ont repoussé toute idée de soulèvement républicain, parce qu’il aurait amené à une république social-démocrate modérée, et ils voulaient la dictature communiste : ou tout ou rien ! On sait comment s’est conclue l’occupation des usines : la tromperie de Giolitti sur la promesse du contrôle des usines ! Et cette fois-ci ce sont les réformistes de la Confédération du Travail qui se sont opposés à la continuation et à l’extension de la révolte, car ils ont eu peur que le gouvernement n’ait recours à une répression féroce pour vaincre, répression qui aurait brisé, selon eux, définitivement tout mouvement ouvrier et socialiste. Malheureusement l’on a eu tout de même une rupture bien pire et plus violente - comme nous le verrons - justement pour ne pas avoir eu à l’époque le courage d’oser !
La responsabilité la plus grande, je l’ai dit, de ce " dolce far niente " retombe sur les socialistes. Mais une part de responsabilité - moins grande, naturellement, en rapport à leurs forces moins grandes - retombe aussi sur les anarchistes, qui avaient acquis à la fin de la période en question un ascendant remarquable sur les masses et qui n’ont pas su l’utiliser. Ils savaient ce qu’il fallait faire, pour l’avoir dit mille fois auparavant et pour l’avoir répété dans leur congrès de Bologne en juillet 1920. Le gouvernement et la magistrature ont même cru que les anarchistes avaient fait le travail de préparation qu’ils avaient tant propagé. Plus tard, quand la réaction reprit le dessus, une fois Malatesta, Borghi et d’autres arrêtés, on a tenté de bâtir des procès sur cette préparation que l’on supposait avoir été faite. L’on a cherché des preuves dans toute l’Italie, l’on a fait des centaines de perquisitions et d’interrogatoires. Et on n’a rien trouvé. Le juge d’instruction lui-même a dû conclure que les anarchistes n’avaient fait que... des discours et des journaux.
Je parle, naturellement, en ligne générale et pour l’ensemble du mouvement. Cela n’exclut pas que, dans telle localité ou telle autre, spontanément, de différentes manières, des révolutionnaires de différentes écoles aient fait, préparé et agi. Mais tout travail d’ensemble a manqué, tout accord concret, toute préparation un peu vaste qui aurait pu assumer une attitude révolutionnaire, même contre la mauvaise foi et la résistance passive des socialistes les plus modérés. L’abandon des usines, dès la signature de l’accord entre le syndicat et le gouvernement, fut comme le début de la retraite d’une armée. Qui, jusqu’à alors, ne faisait qu’avancer. Aussitôt un sentiment de découragement s’empara des rangs ouvriers. A l’inverse, le gouvernement commença à faire sentir sa force. Ici et là les perquisitions, puis les arrestations ont commencé. Un mois seulement après l’abandon des usines un premier exemple de réaction a été fait au détriment du parti révolutionnaire le moins nombreux, les anarchistes.
Borghi, plusieurs rédacteurs et administrateurs de Umanità Nova (le quotidien anarchiste de Milan), Malatesta et d’autres anarchistes dans plusieurs villes, ont été arrêtés entre le 10 et le 20 octobre avec des prétextes dérisoires (12) ce qui aurait été impossible trois mois auparavant.
L’on a eu quelques démonstrations sporadiques, quelques grèves locales à Carrare, dans le Valdarno, dans la Romagne Toscane, mais les chefs avaient lancé le mot d’ordre de ne pas bouger et en général la masse n’a pas bougé. Les socialistes réunis à Florence ont répondu qu’il n’y avait rien à faire à ceux qui sont allés leur demander un conseil ou un appui. Les anarchistes ont été laissés seuls.
La réaction conservatrice avait désormais la voie libre, et elle a continué son chemin, à petit pas tout d’abord, puis de manière progressivement accélérée.
Je dois dire que beaucoup de camarades anarchistes ne sont pas d’accord pour reconnaitre leur part de responsabilité. A un nouveau congrès anarchiste (Ancona, novembre 1921) j’ai répété ma pensée, et certains de mes amis m’ont reproché de fournir des verges pour nous faire fouetter. Alors que je crois qu’il y a eu des moments où les anarchistes auraient pu prendre l’initiative d’un mouvement révolutionnaire. D’autres, plus nombreux peut-être, soutiennent que cela n’était pas possible : que sans le concours direct et volontaire du parti socialiste et de ses organisations économiques il n’y avait rien à faire ; et donc que toute la responsabilité de la révolution manquée retombe sur les socialistes.
Notes
1- Appel lancé par L’Ordine Nuovo(a. I, n. 42, 27 mars 1920) de Turin et signé, avec le Groupe Libertaire Turinois, par la Commission Exécutive de la Section socialiste de Turin, par le Comité d’études des Conseils d’usine turinois, par L’Ordine Nuovo.
2- Présenté par Maurizio Garino au congrès de l’Union Anarchiste Italienne (Bologne, ler-4 juillet 1920), publié dans le journal Umanità Nova du 1er juillet 192O.
3- Nous avons en partie utilisé la traduction publiée dans Noir et Rouge Autogestion, Etat et Révolution,Paris, Cercle, 1972.
4- Un groupe d’ouvriers anarchistes (Sûrement rédigé avec Malatesta ; Umanità Nova, 10 septembre 1920).
5- Quelques jours plus tard, sur Umanità Nova paraissait comme commentaire et précision à cette phrase un article que l’on peut vraisemblablement attribuer à Malatesta lui-même, bien qu’il ne soit pas signé (voir texte suivant).
6- Umanità Nova du 13 septembre 1920.
7- Umanità Nova du 16 septembre 1920.
8- Umanità Nova du 22 septembre 1920.
9- Umanità Nova du 23 septembre 1920.
10- Umanità Nova du 28 juin 1922.
11- Luigi Fabbri. La controrivoluzione preventiva, 1922, Cappelli Editore.
12- Ces prétextes étaient tellement dérisoires que tous les camarades arrêtés ont été finalement acquittés ou libérés, certains au cours de l’instruction, d’autres au procès.
Lénine écrit :
« Peu de temps avant la révolution d’Octobre et peu de temps après, une série d’excellents communistes ont commis une faute dont on ne se souvient pas volontiers en ce moment. Pourquoi ? Parce que s’il n’y a pas de nécessité particulière, il n’est pas correct de rappeler de telles fautes, qui ont été entièrement corrigées. Mais pour les ouvriers italiens il peut être utile de les rappeler, Des bolcheviks et des communistes aussi en vue que Zinoviev, Kamenev, Rykov, Noguine, Milioutine, manifestèrent quelque hésitation à l’époque indiquée ci-dessus, en faisant valoir le danger couru par les bolcheviks de s’isoler, d’entreprendre la révolution avec trop de risques et de se montrer trop intransigeants à l’égard des partis menchévjk et « socialiste-révolutionnaire ». Le conflit arriva au point que les camarades en question quittèrent tous les postes responsables du Parti et des organisations soviétiques, à la plus grande joie des ennemis de la révolution soviétique. On en vint aux plus cruelles polémiques dans la presse de la part du Comité Central de notre Parti contre les démissionnaires. Mais quelques semaines plus tard, quelques mois au plus, tous ces camarades se rendirent compte de leur erreur et revinrent dans les postes les plus responsables du Parti et des institutions soviétiques.
Il n’est point difficile de comprendre pourquoi ceci est arrivé. La veille de la révolution et au moment le plus cruel de la lutte pour la victoire, la plus petite hésitation au sein du parti pouvait perdre, détruire la révolution, faire échapper le pouvoir des mains du prolétariat, car ce pouvoir n’était pas encore ferme et les coups dirigés contre ses détenteurs étaient très puissants. Si les dirigeants hésitants avaient quitté le parti à un tel moment, cela n’aurait pas affaibli, mais renforcé le parti, et le mouvement ouvrier et la révolution en même temps que lui.
Et voici que précisément, en Italie, on se trouve à un moment où tout le monde voit et reconnaît que la crise révolutionnaire a pris une extension nationale, générale. Le prolétariat a montré en fait sa capacité de se soulever, de soulever les masses en un mouvement révolutionnaire puissant. Les plus pauvres paysans et le demi-prolétariat (en vain le camarade Serrati s’est-il approprié l’habitude stupide de poser un point d’interrogation après ce mot, car c’est là un terme correctement marxiste, il exprime une pensée juste, confirmant le fait existant en Russie et en Italie, à savoir que les paysans les plus pauvres apparaissent comme des mi-propriétaires, mi-prolétaires), les paysans les plus pauvres en Italie ont montré en fait qu’ils sont capables de se soulever et de s’élever à la hauteur du combat révolutionnaire à la suite du prolétariat. Maintenant, la nécessité la plus absolue pour la victoire de la révolution en Italie consiste en ce que le Parti devienne réellement l’avant-garde du prolétariat révolutionnaire en Italie, un parti complètement communiste, incapable d’hésitation et de faiblesse au moment décisif, un parti qui réunirait en soi le plus grand fanatisme, le plus absolu dévouement à la révolution, l’énergie, l’audace et la décision. Il faut vaincre dans un combat extrêmement difficile, exigeant un grand nombre de victimes, il faut défendre le pouvoir conquis dans des conditions invraisemblablement dures et semées d’attentats, d’intrigues, de racontars, de calomnies, de violences de la part de la bourgeoisie du monde entier, dans les conditions les plus dangereuses, sous la séduction de toute la petite-bourgeoisie démocratique, de tous les turatistes, de tous les « centristes », de tous les social-démocrates, socialistes, anarchistes. Dans de telles conditions, le parti doit être cent fois plus solide, plus décidé, plus audacieux, plus dévoué et plus impitoyable que dans des circonstances ordinaires et dans des moments moins difficiles. En de tels moments et dans de telles conditions, le Parti sera renforcé cent fois et non pas affaibli si de ses rangs s’en vont les mencheviks de l’espèce de ceux qui se sont réunis à Reggio d’Emilia le 11 octobre 1920, et si de sa direction s’en vont même d’excellents communistes, qui actuellement sont membres du Comité Central du Parti, tels que Baratono, Zannerini, Bacci, Giacomini et Serrati. La plupart des gens de cette dernière catégorie, s’ils démissionnent en un moment comme celui-ci, reviendront sans doute très rapidement à leurs postes, ayant reconnu leurs erreurs après la victoire du prolétariat, après l’affermissement de ses conquêtes. Et même parmi les mencheviks italiens, les turatistes, probablement une partie reviendra et sera acceptée dans les rangs du Parti après la période des plus grandes difficultés, de même que sont revenus maintenant (après 3 ans de vie difficile), une partie des mencheviks et des S. R. se trouvant en 1917-1918 de l’autre côté de la barricade, en Russie.
Une période de lutte non pas seulement extrêmement difficile, ainsi que je l’ai dit, mais des plus difficiles, s’ouvre à présent pour le prolétariat révolutionnaire italien. Le plus dur est encore a faire pour lui. Il me semblerait superficiel et criminel de fermer les yeux devant ces difficultés et je suis étonné que le camarade Serrati puisse insérer sans objection dans son périodique Le Communisme (N° 24, 15-30 septembre 1920) un article aussi superficiel que celui signé G. C. intitulé : « Serons-nous l’objet d’un blocus ? ». Personnellement je pense, contrairement à l’avis de l’auteur de cet article, que le blocus de l’Italie, si le prolétariat y emporte la victoire, est non seulement possible mais même vraisemblable de la part de l’Angleterre, de la France et de l’Amérique. A mon avis, le camarade Graziadei a posé bien plus justement la question du blocus dans son discours à la séance du comité central du Parti italien (voir Avanti, 1er octobre 1920, édition milanaise). Il a reconnu que la question du blocus possible est très grave (« problema gravissimo »). Il indiqua que « la Russie a pu subsister malgré le blocus en partie à cause de la rareté de la population et de l’étendue du territoire, — que la révolution en Italie ne pourrait pas résister longtemps si elle ne se coordonnait point avec la révolution de quelque autre pays de l’Europe Centrale », qu’« une telle coordination sera difficile, mais non point impossible » car toute l’Europe continentale est en train de vivre une période de révolution.
Ceci a été dit très prudemment, mais très justement. J’ajouterai seulement qu’une certaine coordination, quoique encore insuffisante, quoique incomplète, serait assurée à l’Italie et que pour obtenir une coordination complète il faudra combattre. Les réformistes rappellent la possibilité du blocus afin de saboter la révolution, afin d’écarter de la révolution par l’effroi de ses conséquences, afin de communiquer aux masses leur état d’esprit de panique, leur terreur, leur indécision, leur hésitation, leurs tergiversations. Les révolutionnaires communistes ne doivent point nier le danger et les difficultés de la lutte pour inspirer à la masse plus de fermeté et de courage, et afin de nettoyer le Parti des faibles, des hésitants et des froussards, afin d’insuffler à tout le mouvement plus d’enthousiasme, plus d’internationalisme et plus de promptitude au sacrifice pour un grand but : hâtez la révolution en Angleterre, en France, en Amérique au cas où ces pays se décideraient à bloquer le prolétariat de la république soviétique italienne.
La question du remplacement des réformistes ou des « centristes » expérimentés par des novices n’est point une question particulière concernant un seul des pays quelconques. C’est une question générale, relative à toute la révolution prolétarienne et c’est comme telle qu’elle a été posée et décidée complètement et précisément par les résolutions du 2e Congrès de l’Internationale Communiste : « Les tâches principales de l’Internationale Communiste ». Nous lisons au paragraphe 8 : « La préparation de la dictature du prolétariat exige pour ces raisons, non seulement la divulgation du caractère bourgeois du réformisme et de toute défense de la démocratie impliquant le maintien de la propriété privée sur les moyens de production ; non seulement la divulgation des manifestations de tendances, qui signifient en fait la défense de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier ; mais elle exige aussi le remplacement des anciens leaders par des Communistes dans toutes les formes d’organisation prolétarienne, politiques, syndicales, coopératives, d’éducation, etc. (...) Il est indispensable, et il faut le faire avec cent fois plus de hardiesse qu’on ne l’a fait jusqu’ici, de remplacer ces représentants de l’aristocratie ouvrière par des travailleurs même inexpérimentés, proches de la masse exploitée et jouissant de sa confiance dans la lutte contre les exploiteurs. La dictature du prolétariat exigera la désignation de tels travailleurs inexpérimentés aux postes les plus importants du gouvernement, sans quoi le pouvoir de la classe ouvrière restera impuissant et ne sera pas soutenu par la masse. »
C’est en vain que Serrati vient nous dire que dans le parti italien « tout le monde » est d’accord pour accepter les décisions de l’Internationale Communiste. En fait nous voyons le contraire.
Dans sa lettre citée plus haut à l’Humanité, Serrati écrit entre autres :
Quant aux derniers événements, il est nécessaire de savoir que les dirigeants de la CGdL2 ont proposé de laisser la direction du mouvement à ceux qui voulait l’élargir jusqu’à la révolution, nos camarades de la CGdL ont déclaré qu’ils voulaient bien rester des soldats disciplinés si les extrémistes voulaient être les chefs d’un mouvement insurrectionnel. Mais les extrémistes n’ont pas accepté la direction du mouvement.
Ce serait de la naïveté de la part de Serrati de prendre une telle déclaration des réformistes de la Confédération Générale du Travail pour de la monnaie de bon aloi. En fait c’est là une des plus insignes formes du sabotage de la révolution, à savoir la menace de la démission au moment décisif du combat Ce n’est point là de la loyauté. Il s’agit bien d’autre chose, à savoir qu’il n’est point possible de vaincre pendant la révolution si les chefs rencontrent de l’hésitation, de la tergiversation, de la désertion parmi les leurs, parmi ceux qui se trouvent au sommet, parmi les chefs, à chaque moment difficile de la révolution. Peut-être le camarade Serrati apprendra-t-il avec profit que vers la fin d’octobre 1917, alors que la coalition des menchéviks russes et des S. R. avec la bourgeoisie s’écroula politiquement ,les S. R. du Parti de Tchernov eux-mêmes écrivaient dans leurs journaux : « Les bolcheviks seront obligés de former le cabinet. (...) qu’ils ne fassent donc point d’efforts inutiles pour dissimuler par des théories vite édifiées l’impossibilité pour eux de prendre le pouvoir. La démocratie ne reconnaît point de telles théories. En même temps, les partisans de la coalition doivent leur garantir le plus complet appui » (journal de leur Parti, Dielo Naroda, du 21 septembre 1917, cité dans ma brochure, Les bolcheviks garderont-ils le pouvoir, Petrograd 1917, p. 4).
Se fier à de pareilles déclarations de loyauté serait de la part des ouvriers révolutionnaires une faute aussi fatale que celle qui fut commise lorsqu’on se fia aux turatistes hongrois qui avaient promis d’aider Béla Kun, qui étaient entrés au Parti Communiste et qui, cependant, s’étaient montrés les saboteurs de la révolution, qu’ils avaient fini par perdre par leurs hésitations.
Je me résume.
1. Le Parti du prolétariat révolutionnaire d’Italie doit faire montre de la plus grande fermeté, de prudence, de sang-froid, afin de juger avec justesse les conditions générales et du moment particulier actuel avant les combats imminents décisifs de la classe ouvrière italienne contre sa bourgeoisie pour la conquête du pouvoir ;
2. Toute la propagande, toute l’agitation de ce parti doivent être inspirées de l’esprit le plus ferme de conduire ce combat jusqu’à sa fin victorieuse à tout prix, elle doit être conduite par une direction centrale avec l’héroïsme le plus dévoué et en détruisant impitoyablement toute hésitation, toute indécision dont est pénétré le groupe des turatistes ;
3. La propagande telle qu’elle est menée actuellement par l’édition de Milan de l’Avanti sous la direction de Serrati n’éduque pas le prolétariat en vue du combat, mais porte au contraire la dislocation dans ses rangs. Le Comité Central du parti doit guider en un pareil moment les ouvriers et les préparer à la révolution, combattre les opinions fausses. On peut et on doit faire cela tout en laissant aux tendances différentes la possibilité de s’exprimer. C’est Serrati qui conduit, mais il conduit dans une direction mauvaise ;
4. L’exclusion du parti de tous las participants au Congrès de Reggio d’Emilia du 11 octobre 1920 n’affaiblira pas, mais au contraire renforcera le Parti, car de tels « chefs » sont capables de détruire la révolution « à la hongroise », tout en restant loyaux. Les gardes blancs et la bourgeoisie peuvent profiter des hésitations, des doutes et du manque de foi même des socialistes, social-démocrates, etc. parfaitement « loyaux » ;
5. Si des gens comme Baratono, Zannerini, Bacci, Giacomini et Serrati hésitent et démissionnent, il ne faut pas les supplier de rester, mais accepter leur démission. Après la période décisive des combats ils reviendront et seront alors utiles au prolétariat ;
6. Camarades ouvriers italiens ! n’oubliez pas les leçons de l’histoire de toutes les révolutions, les leçons de la Russie, de la Hongrie dans les années 1917-1920. Les plus grands combats sont en vue pour le prolétariat italien, les plus grandes difficultés, les plus grands sacrifices. De l’issue de ces combats, de l’ensemble de la discipline, du dévouement des masses ouvrières dépendent la victoire sur la bourgeoisie, la transmission des pouvoirs au prolétariat et le renforcement de la république soviétique en Italie. La bourgeoisie de l’Italie et de tous les pays du monde fera tout le possible, commettant tous les crimes et toutes les férocités, pour empêcher le prolétariat de prendre le pouvoir et de renverser celui de la bourgeoisie.
L’hésitation, les tergiversations, l’indécision des réformistes et de tous ceux qui ont participé à la conférence de Reggio d’Emilia sont inévitables, car de telles gens, même avec la plus grande honnêteté, ont toujours perdu la cause de la révolution par leurs hésitations dans tous les pays et à toutes les époques. De telles gens ont perdu la révolution (la première, une autre suivra...) en Hongrie, ils l’auraient perdue en Russie s’ils n’avaient pas été écartés de tous les postes responsables, s’ils n’avaient pas été entourés du mur de la méfiance, de la vigilance et de la surveillance du prolétariat.
Les masses travailleuses et exploitées de l’Italie iront avec le prolétariat révolutionnaire. La victoire leur appartiendra en définitive, car leur cause est celle des ouvriers du monde entier, car il n’y a point plusieurs saluts comme issue de la guerre impérialiste, des nouvelles guerres déjà préparées par les impérialistes, des horreurs de l’esclavage et de l’oppression capitalistes, non, il n’y a point d’autre salut que la république ouvrière soviétique. »
N. LENINE.
4 novembre 1920.
Notes
1 Voici la partie essentielle de cette lettre : « Nous sommes tous pour tous les points de Moscou. Il s’agit de leur application. Je soutiens qu’on doit épurer le Parti des éléments nuisibles – et j’ai proposé l’expulsion de Turati – mais qu’il nous faut ne pas perdre les masses des syndicats et des coopératives. Les autres veulent une scission radicale. Voilà le différend. » — (L’Humanité, 14 octobre. Italiques de Serrati).
2 Confederazione Generale del Lavoro, la confédération syndicale italienne.
Amadeo Bordiga
Pour la constitution des conseils ouvriers en Italie
22 février 1920
I (« Il Soviet », IIIème année, n° 1 du 4-1-1920)
A propos des propositions et des initiatives prises pour la constitution des Soviets en Italie, nous avons recueilli du matériel que nous voulons exposer dans l’ordre. Pour l’instant nous ferons quelques considérations d’ordre général, considérations que nous avons déjà exposé dans les numéros précédents.
Le système de représentation prolétarien, qui a été introduit pour la première fois en Russie, exerce des fonctions de deux ordres politique et économique.
Les fonctions politiques consistent dans la lutte contre la bourgeoisie jusqu’à son élimination totale. Les fonctions économiques consistent dans la création de tout le nouveau mécanisme de la production communiste.
Avec le développement de la révolution, avec l’élimination graduelle des classes parasitaires, les fonctions politiques deviennent toujours moins importantes par rapport aux fonctions économiques mais dans un premier temps, et surtout lorsqu’il s’agit encore de lutter contre le pouvoir bourgeois, l’activité politique est au premier plan.
Le véritable instrument de la lutte de libération du prolétariat, et avant tout de la conquête du pouvoir politique, c’est le parti de classe communiste.
Sous le pouvoir bourgeois, les conseils ouvriers ne peuvent être que des organismes dans lesquels travaille le parti communiste, moteur de la révolution. Dire qu’ils sont les organes de libération du prolétariat sans parler de la fonction du parti, comme dans le programme approuvé par le Congrès de Bologne, nous semble une erreur. Soutenir, comme le font les camarades de « l’Ordine Nuovo » de Turin, qu’avant même la chute de la bourgeoisie les conseils ouvriers sont déjà des organes non seulement de lutte politique mais aussi de préparation économico-technique du système communiste, est un pur et simple retour au gradualisme socialiste celui-ci, qu’il s’appelle réformisme ou syndicalisme, est défini par l’idée fausse que le prolétariat peut s’émanciper en gagnant du terrain dans les rapports économiques alors que le capitalisme détient encore, avec l’Etat, le pouvoir politique.
Nous développerons la critique des deux conceptions que nous avons indiquées.
Le système prolétarien de représentation doit adhérer à tout le processus technique de production.
Ce critère est exact, mais correspond au stade où le prolétariat, déjà au pouvoir, organise la nouvelle économie. Transposez-le tout bonnement en régime bourgeois, et vous n’aurez rien fait de révolutionnaire.
Même dans la période dans laquelle se trouve la Russie, la représentation politique soviétique — c’est-à-dire l’échafaudage qui culmine dans le gouvernement des commissaires du peuple — ne prend pas son départ dans les équipes de travail ou les ateliers des usines, mais dans le Soviet administratif local, élu directement par les travailleurs (regroupés, si possible, par communautés de travail).
Pour fixer les idées, le Soviet de Moscou est élu par les prolétaires de Moscou, à raison de un délégué pour 1.000 ouvriers. Entre ceux-ci et le délégué il n’y a aucun organe intermédiaire. De cette première désignation partent les suivantes, jusqu’au Congrès des Soviets, au Comité Exécutif, au Gouvernement des Commissaires.
Le conseil d’usine prend place dans un engrenage bien différent : celui du contrôle ouvrier de la production.
Par conséquent, le conseil d’usine, formé d’un représentant par atelier, ne désigne pas de représentant de l’usine au Soviet communal, politico-administratif ce représentant est élu directement et indépendamment.
En Russie, les conseils d’usine sont le point de départ d’un autre système de représentation, toujours subordonné au réseau politique des Soviets : celui du contrôle ouvrier de l’économie populaire. La fonction de contrôle dans l’usine n’a une valeur révolutionnaire et expropriatrice qu’une fois le pouvoir central passé dans les mains du prolétariat. Quand la protection étatique bourgeoise est encore debout, le conseil d’usine ne contrôle rien ; les rares fonctions qu’il accomplit sont le résultat de la pratique traditionnelle
a) du réformisme parlementaire,
b) de l’action syndicale de résistance, qui reste un gradualisme réformiste.
En conclusion nous ne nous opposons pas à la constitution des conseils internes d’usine si leur personnel ou ses organisations le demandent. Mais nous affirmons que l’activité du Parti Communiste doit s’orienter suivant un axe différent la lutte pour la conquête du pouvoir politique.
Cette lutte peut trouver un terrain favorable dans la création d’une représentation ouvrière : mais celle-ci doit consister dans les conseils ouvriers de ville ou de district rural, directement élus par les masses pour être prêts à remplacer les conseils municipaux et les organes locaux du pouvoir étatique au moment de la chute des forces bourgeoises. […]
II (« Il Soviet », IIIème année, n° 2 du 11-1-1920)
Avant de commencer çà discuter du problème pratique de la constitution des Conseils d’ouvriers, de paysans et de soldats, et après les considérations générales de l’article du numéro précédent, nous voulons examiner les lignes programmatiques du système des Soviets telles qu’elles ressortent des documents de la révolution russe, et des déclarations de principe de quelques courants maximalistes italiens, comme le programme approuvé au Congrès de Bologne, la motion présentée à ce Congrès par Leone et d’autres camarades, les publications de « l’Ordine Nuovo » au sujet du mouvement turinois des Conseils d’usine.
Les conseils et le programme bolchevique
Dans les documents de la IIIème Internationale et du Parti Communiste Russe, dans les exposés magistraux de ces formidables théoriciens que sont les chefs du mouvement révolutionnaire russe, Lénine, Zinoviev, Radek, Boukharine, on retrouve l’idée que la révolution n’a pas inventé des formes nouvelles et imprévues, mais a confirmé les prévisions du processus révolutionnaire par la théorie marxiste.
Ce qui est essentiel dans le grandiose développement de la révolution russe, c’est la conquête du pouvoir politique par les masses ouvrières à travers une véritable guerre de classe, et l’instauration de leur dictature.
Les Soviets — faut-il rappeler que le mot soviet signifie simplement conseil, et peut être utilisé pour désigner n’importe quel corps représentatif — sont, c’est là leur signification historique, le système de représentation de classe du prolétariat parvenu à la possession du pouvoir.
Ce sont les organes qui remplacent le parlement et les assemblées administratives bourgeoises, et se substituent progressivement à tous les autres engrenages de l’Etat.
Pour employer les termes du dernier congrès communiste russe, cités par le camarade Zinoviev, les Soviets sont les organisations d’Etat de la classe ouvrière et des paysans pauvres, qui réalisent la dictature du prolétariat durant la phase dans laquelle s’éteignent toutes les vieilles formes d’Etat.
Le système de ces organisations d’Etat tend à donner la représentation à tous les producteurs en tant que membres de la classe ouvrière, mais non en tant que participants à une branche d’industrie ou une catégorie professionnelle : selon le récent manifeste de la IIIème Internationale, les Soviets sont un nouveau type d’organisation vaste, qui embrasse toutes les masses ouvrières indépendamment de leur métier et du degré de leur culture politique. Le réseau administratif des Soviets a comme organismes de base les conseils de ville ou de district rural, et culmine dans le gouvernement des commissaires.
Il est certes vrai que d’autres organes surgissent à côté de ce système dans la phase de la transformation économique, tel le système du contrôle ouvrier de l’économie populaire ; il est vrai aussi, nous l’avons souvent répété, que ce système tendra à absorber le système politique quand l’expropriation de la bourgeoisie sera complète et que cessera la nécessité d’un pouvoir étatique.
Mais dans la période révolutionnaire, comme il résulte de tous les documents des Russes, le problème essentiel est de subordonner dans l’espace et dans le temps, les exigences et les intérêts locaux et de catégorie à l’intérêt général du mouvement révolutionnaire.
Quand la fusion des deux organismes sera advenue, alors le réseau de la production sera complètement communiste et alors le critère — dont on exagère, nous semble-t-il, l’importance — d’une parfaite articulation de la représentation avec tous les mécanismes du système productif se réalisera.
Mais auparavant, quand la bourgeoisie résiste encore, et surtout quand elle est encore au pouvoir, le problème est d’avoir une représentation dans laquelle prévale le critère de l’intérêt général ; et quand l’économie est encore celle de l’individualisme et de la concurrence la seule forme dans laquelle l’intérêt collectif supérieur peut se manifester est une forme de représentation politique dans laquelle agit le parti politique communiste.
En reparlant de cette question nous montrerons que trop vouloir concrétiser et techniciser la représentation soviétique, surtout là où la bourgeoisie est encore au pouvoir, revient à mettre la charrue avant les bœufs et à retomber dans les vieilles erreurs du syndicalisme et du réformisme.
Pour l’instant, citons les paroles sans équivoque de Zinoviev : Le parti communiste regroupe cette avant-garde du prolétariat qui lutte en connaissance de cause pour la réalisation pratique du programme communiste. Il s’efforce en particulier d’introduire son programme dans les organisations d’Etat, les Soviets, et d’y obtenir une complète domination.
En conclusion, la république soviétique russe est dirigée par les Soviets qui regroupent en leur sein dix millions de travailleurs, sur quelque quatre-vingt millions d’habitants. Mais, substantiellement, les désignations pour les comités exécutifs des Soviets locaux et centraux se font dans les sections et dans les congrès du grand parti communiste qui domine dans les Soviets. Ceci correspond à la vibrante défense des fonctions révolutionnaires des minorités, faite par Radek. Il sera bon de ne pas créer un fétichisme ouvriériste-majoritaire, qui serait tout à l’avantage du réformisme et de la bourgeoisie.
Le parti est, dans la révolution, en première ligne, puisqu’il est potentiellement constitué d’hommes qui pensent et agissent comme membres de la future humanité travailleuse dans laquelle tous seront des producteurs harmonieusement insérés dans un engrenage de fonctions et de représentations.
Le Programme de Bologne et les Conseils
Il est regrettable que dans le programme actuel du parti [voir chap. III point 6] on ne reprenne pas l’affirmation marxiste selon laquelle le parti de classe est l’instrument de l’émancipation prolétarienne. Et qu’il n’y ait que l’anodin codicille : « décide (qui ? Même la grammaire n’a pas été sauvée dans la hâte de délibérer en faveur… des élections) d’informer l’organisation du Parti Socialiste italien à ses principes ».
Mais nous sommes encore plus en désaccord avec le programme quand il dit que les nouveaux organes prolétariens fonctionneront d’abord, sous la domination bourgeoise, comme instruments de la lutte violente de libération, et deviendront ensuite des organismes de transformation sociale et économique, puisqu’on inclut parmi ces organes non seulement les conseils de paysans travailleurs et de soldats, mais jusqu’aux conseils de l’économie publique, organes inconcevables en régime bourgeois.
Les conseils politiques ouvriers eux-mêmes doivent être considérés plutôt comme des institutions au sein desquelles se développe l’action des communistes pour la libération du prolétariat.
Mais récemment encore, le camarade Serrati a déprécié, à la barbe de Marx et de Lénine, le rôle du parti de classe dans la révolution.
« Avec les masses ouvrières – dit Lénine – le parti politique, marxiste, centralisé, avant-garde du prolétariat, guidera le peuple sur la juste voie, pour la victoire de la dictature du prolétariat, pour la démocratie prolétarienne à la place de la démocratie bourgeoise, pour le pouvoir des conseils, pour l’ordre socialiste. »
L’actuel programme du parti se ressent de scrupules libertaires et d’impréparation doctrinale.
Les Conseils et la motion Leone
Cette motion se résume en quatre points, exposés dans le style suggestif de son auteur.
Le premier de ces points est admirablement inspiré par la constatation que la lutte de classe est le moteur réel de l’histoire, et qu’elle a brisé les unions social-nationales.
Mais ensuite, la motion exalte dans les Soviets les organes de la synthèse révolutionnaire, qu’ils auraient la vertu de faire naître presque par le mécanisme même de leur constitution, et affirme que seuls les Soviets peuvent faire triompher les grandes initiatives historiques, par-delà les écoles, les partis, les corporations.
Cette conception de Leone, et des nombreux camarades qui ont signé sa motion, est très différente de la nôtre, déduite du marxisme et des directives de la révolution russe. On surestime ici une forme au lieu d’une force, tout comme les syndicalistes le font pour le syndicat, en attribuant à sa pratique minimaliste la vertu miraculeuse de se fondre dans la révolution sociale.
De même que le syndicalisme a été démoli d’abord par la critique des marxistes véritables, puis par l’expérience des mouvements syndicaux qui, partout, ont collaboré avec le monde bourgeois et lui ont fourni des instruments de conservation, la conception de Leone s’écroule face à l’expérience des conseils ouvriers sociaux-démocrates contre-révolutionnaires, qui sont précisément ceux dans lesquels il n’y a pas eu une pénétration victorieuse du programme politique communiste.
Seul le parti peut condenser en son sein les énergies dynamiques révolutionnaires de la classe. Inutile d’objecter que les partis socialistes ont, eux aussi, transigé, car nous n’exaltons pas la vertu de la forme parti, mais celle du contenu dynamique qui réside dans le seul parti communiste.
Chaque parti est défini par son programme, et ses fonctions n’ont pas de dénominateur commun avec celles des autres partis ; tandis que leurs fonctions rapprochent nécessairement tous les syndicats et, dans le sens technique, tous les conseils ouvriers aussi.
Le malheur des partis social-réformistes ne fut pas d’être des partis, mais de ne pas être communistes et révolutionnaires.
Ces partis ont dirigé la contre-révolution, tandis que les partis communistes, en les combattant, dirigent et nourrissent l’action révolutionnaire.
Il n’existe donc pas d’organismes qui seraient révolutionnaires grâce à leur forme ; seules existent des forces sociales qui sont révolutionnaires de par la direction dans laquelle elles agissent, et ces forces s’ordonnent dans un parti qui lutte avec un programme.
Les Conseils et l’initiative de l’« Ordine Nuovo » de Turin
D’après nous, les camarades de « l’Ordine Nuovo » vont encore plus loin. Même la formulation du programme du parti ne les satisfait pas, parce qu’ils prétendent que les Soviets, y compris ceux de nature technico-économique (les conseils d’usine) non seulement existent et sont dans le régime bourgeois les organes de la lutte de libération prolétarienne, mais qu’ils sont déjà les organes de la reconstruction de l’économie communiste.
Ils citent en effet un passage du programme du parti en omettant certains mots, de façon à tirer le sens vers leur point de vue :
« Il faut leur opposer de nouveaux organes prolétariens (conseils d’ouvriers, paysans et soldats, conseils de l’économie publique, etc.)… organismes de transformation sociale et économique et de reconstruction du nouvel ordre communiste ».
Mais l’article est déjà long et nous renvoyons au prochain numéro l’exposé de notre profond désaccord avec ce critère, qui à notre avis présente le danger de se résoudre en une simple expérience réformiste par la modification de certaines fonctions des syndicats et peut-être la promulgation d’une loi bourgeoise instituant les conseils ouvriers.
III (« Il Soviet », IIIème année, n° 4 du 1-2-1920)
En conclusion du second article sur la Constitution des Soviets en Italie, nous avons évoqué le mouvement turinois pour la constitution des conseils d’usine.
Nous ne partageons pas le point de vue qui inspire les camarades de « l’Ordine Nuovo » et, tout en appréciant leur travail tenace pour une meilleure conscience des points fondamentaux du communisme, nous pensons qu’ils sont tombés dans des erreurs de principe et de tactique qui n’ont rien de bénin.
Selon eux, le fait essentiel de la révolution réside précisément dans la constitution des nouveaux organes prolétariens de représentation, destinés à la gestion directe de la production, et dont le caractère fondamental réside dans l’adhésion étroite au processus productif.
Nous avons déjà dit qu’à notre avis on insiste trop sur cette idée de la coïncidence formelle entre les représentations de la classe ouvrière et les divers agrégats du système technico-économique de production. Cette coïncidence tendra à se réaliser à un stade très avancé de la révolution communiste, lorsque la production sera socialisée et que toutes les activités particulières qu’elle comprend seront harmonieusement subordonnées aux intérêts généraux et collectifs, et inspirées par eux.
Auparavant, et pendant la période de transition de l’économie capitaliste à l’économie communiste, les regroupements de producteurs traversent une période de transformation permanente, et leurs intérêts peuvent heurter les intérêts généraux collectifs du mouvement révolutionnaire du prolétariat.
Celui-ci trouvera son véritable instrument dans une représentation de la classe ouvrière dans laquelle chacun entre en tant que membre de cette classe, intéressé à un changement radical des rapports sociaux, et non en tant que composante d’une catégorie professionnelle, d’une usine ou d’un quelconque groupe local.
Tant que le pouvoir politique se trouve encore dans les mains de la classe capitaliste, on ne peut obtenir une représentation des intérêts généraux révolutionnaires du prolétariat que sur le terrain politique, dans un parti de classe auquel adhèrent individuellement ceux qui, pour se vouer à la cause de la révolution, ont dépassé la vision étroite de leur intérêt égoïste, de leur intérêt de catégorie, et parfois même de leur intérêt de classe, ce qui signifie que le parti admet aussi dans ses rangs les déserteurs de la classe bourgeoise qui revendiquent le programme communiste.
C’est une grave erreur de croire qu’en transplantant dans l’ambiance prolétarienne actuelle, parmi les salariés du capital, les structures formelles dont on pense qu’elles pourront se former pour la gestion de la production communiste, on crée des forces révolutionnaires par elles-mêmes et par vertu intrinsèque.
Ce fut l’erreur des syndicalistes, et c’est aussi l’erreur des zélateurs trop ardents des conseils d’usine.
Le camarade C. Niccolini a fort opportunément rappelé dans un article de « Comunismo » qu’en Russie, même après le passage du pouvoir au prolétariat, les conseils d’usine ont souvent fait obstacle aux mesures révolutionnaires, opposant encore davantage que les syndicats la pression d’intérêts limités au développement du processus communiste.
Les conseils d’usine ne sont même pas les gérants principaux de la production dans le système de l’économie communiste.
Parmi les organes qui participent à cette tâche (Conseils de l’économie populaire) la représentation des conseils d’usine a moins de poids que celle des syndicats professionnels et que celle, prédominante, du pouvoir étatique prolétarien qui, avec son organisation politique centralisée, est l’instrument et l’agent principal de la révolution, non seulement en ce qui concerne la lutte contre la résistance politique de la classe bourgeoise, mais aussi en ce qui concerne le processus de socialisation de la richesse.
Au stade où nous en sommes, c’est-à-dire quand l’Etat du prolétariat est encore une aspiration programmatique, le problème fondamental est celui de la conquête du pouvoir par le prolétariat ou mieux encore, par le prolétariat communiste, c’est-à-dire par les travailleurs organisés en parti politique de classe et décidés à réaliser la forme historique du pouvoir révolutionnaire, la dictature du prolétariat.
Le camarade A. Tasca lui-même expose clairement son désaccord avec le programme de la majorité maximaliste du Congrès de Bologne, et plus encore avec nous, abstentionnistes, dans le numéro 22 de « l’Ordine Nuovo », dont le passage suivant vaut la peine d’être reproduit :
« Un autre point du nouveau programme du parti mérite d’être examiné : les nouveaux organes prolétariens (conseils d’ouvriers, paysans et soldats, conseils de l’économie publique, etc.) fonctionnant d’abord (sous la domination bourgeoise) comme instruments de la lutte violente de libération, deviennent ensuite des organes de transformation sociale et économique, de reconstruction du nouvel ordre communiste. Nous avions insisté en commission sur l’erreur d’une telle formulation, qui confie aux nouveaux organes des fonctions différentes suivant un d’abord et un ensuite, séparés par la conquête du pouvoir politique par le prolétariat. Gennari avait promis de corriger en « d’abord essentiellement comme instruments… », mais on voit qu’ensuite il y a renoncé ; et comme, pour des raisons de force majeure, j’ai été absent à la séance finale, je n’ai pas pu le lui faire remettre.
Il y a pourtant dans cette formulation un véritable point de divergence qui, s’il rapproche Gennari, Bombacci, etc., des abstentionnistes, les éloigne de ceux qui croient que les nouveaux organes prolétariens ne peuvent être « instruments de la lutte violente de libération » que dans la mesure où ils sont tout de suite (en non ensuite) des « organes de transformation sociale et économique ». La libération du prolétariat se réalise précisément à travers le développement de sa capacité à gérer de façon autonome et originale les fonctions de la société créée par lui et pour lui : la libération réside dans la création d’organes tels que, s’ils vivent et fonctionnent, ils provoquent par là même la transformation sociale et économique qui constitue leur but. Il ne s’agit pas là d’une question de forme, mais d’une question essentielle de contenu. Dans la formulation actuelle, redisons-le, les rédacteurs en arrivent à adhérer à la conception de Bordiga, qui donne plus d’importance à la conquête du pouvoir qu’à la formation des Soviets, auxquels il reconnaît pour l’instant une fonction davantage « politique » stricto sensu, plutôt qu’une fonction organique de « transformation économique et sociale ». De même que Bordiga considère que le Soviet intégral ne sera créé que durant la période de la dictature du prolétariat, Gennari, Bombacci, etc., considèrent que seule la conquête du pouvoir (qui prend donc un caractère politique, ce qui nous ramène aux « pouvoirs publics », déjà dépassés) peut donner aux Soviets leur fonction véritable et entière. Selon nous c’est précisément là le point central qui devra conduire, tôt ou tard, à une nouvelle révision du programme voté récemment ».
Selon Tasca, la classe ouvrière peut donc construire les étapes de sa libération avant même d’arracher le pouvoir politique à la bourgeoisie.
Plus loin, Tasca laisse entendre que cette conquête pourra même avoir lieu sans violence, quand le prolétariat aura développé cette œuvre de préparation technique et d’éducation sociale qu’est censée représenter précisément la méthode révolutionnaire concrète préconisée par les camarades de « l’Ordine Nuovo ».
Nous ne nous étendrons pas sur la démonstration du fait que cette conception tend vers celle du réformisme, et s’éloigne des points fondamentaux du marxisme révolutionnaire pour qui la révolution n’est pas déterminée par l’éducation, la culture, la capacité technique du prolétariat, mais par les crises inhérentes au système capitaliste de production.
Tout comme Enrico Leone, Tasca et ses amis surestiment l’apparition dans la révolution russe d’une nouvelle représentation sociale, le Soviet, censé constituer, par la vertu même de sa formation, une solution historique originale de la lutte de classe prolétarienne contre le capital.
Mais les Soviets — fort bien définis par le camarade Zinoviev comme les organisations d’Etat de la classe ouvrière — ne sont rien d’autre que les organes du pouvoir prolétarien qui exercent la dictature révolutionnaire de la classe ouvrière, pivot du système marxiste, dont la première expérience positive fut la Commune de Paris de 1871.
Les Soviets sont la forme, non la cause de la révolution.
En dehors de cette divergence, un autre point nous sépare des camarades turinois.
Les Soviets, organes d’Etat du prolétariat victorieux, sont bien autre chose que les conseils d’usine, et ces derniers ne constituent pas le premier échelon du système politique soviétique. En réalité, cette équivoque se retrouve dans la déclaration de principe votée à la première assemblée des Commissaires d’atelier des usines turinoises, qui commence ainsi :
« Les commissaires d’usine sont les seuls et véritables représentants sociaux (économiques et politiques) de toute la classe prolétarienne, parce que élus au suffrage universel par tous les travailleurs sur le lieu même du travail.
Aux divers échelons de leurs constitution, les commissaires représentent l’union de tous les travailleurs telle qu’elle se réalise dans les organismes de production (équipe – atelier – usine – union des usines d’une industrie donnée – union des entreprises de production de l’industrie mécanique et agricole d’un district, d’une province, d’une nation, du monde) dont les conseils et le système des conseils représentent le pouvoir et la direction sociale ».
Cette déclaration est inacceptable, puisque le pouvoir prolétarien se forme directement dans les Soviets municipaux des villes et des campagnes, sans passer par l’intermédiaire des conseils et comités d’usine, ainsi que nous l’avons dit à plusieurs reprises, et comme cela ressort de la claire présentation du système soviétique russe publiée par « l’Ordine Nuovo » lui-même.
Les Conseils d’usine sont des organismes destinés à représenter les intérêts de groupes d’ouvriers pendant la période de la transformation révolutionnaire de la production, et ils représentent non seulement l’aspiration de tel ou tel groupe à se libérer du capitaliste privé par la socialisation de la production, mais également la préoccupation sur la manière dont les intérêts de ce groupe se feront valoir lors du processus de socialisation, discipliné par la volonté organisée de toute la collectivité des travailleurs.
Les intérêts des travailleurs, pendant la période où le système capitaliste est stable et ou il ne s’agit que de pousser à des améliorations salariales, ont été représentés par les syndicats de métiers. Ils continuent à exister pendant la période révolutionnaire, et il est naturel qu’ils se confrontent aux conseils d’usine qui surgissent lorsque se rapproche l’abolition du capitalisme privé, comme c’est advenu à Turin.
Ce n’est donc pas une question de principes révolutionnaires que de savoir si les ouvriers non organisés doivent ou non participer aux élections.
Si il est logique que ceux ci y participent, étant donné la nature même des conseils d’usine, il ne sous parait pas logique de mélanger, comme on l’a fait à Turin, les organisations et fonctions des syndicats et des conseils, en imposant aux sections de Turin de la Fédération de la métallurgie d’élire leur propre conseil de direction des assemblées des commissaires d’ateliers.
De toute manière, les rapports entre conseils et syndicats, qui sont les représentants d’intérêts particuliers de groupes d’ouvriers, continueront à être complexes. Nous ne pourrons les harmoniser qu’à une étape très avancée de l’économie communiste, lorsque la possibilité d’opposition entre les intérêts d’un groupe de producteurs et l’intérêt général de la marche de la production sera fortement réduite.
Ce qu’il nous importe d’établir, c’est que la révolution communiste est conduite et dirigée par une représentation politique de la classe ouvrière, qui, avant le renversement du pouvoir bourgeois, est un parti politique ; ensuite, c’est le réseau du système des Soviets politiques, élus directement par les masses auxquelles on propose de désigner des représentants ayant un programme politique général bien défini, au lieu d’exprimer les intérêts limités d’une catégorie ou d’une usine.
Le système russe est arrangé de façon à former le Soviet municipal d’une ville avec un délégué pour chaque regroupement de prolétaires qui votent pour un seul nom. Mais ces délégués sont proposés aux électeurs par le parti politique, et il en va de même pour les représentants du deuxième et troisième échelon dans les organismes supérieurs du système étatique.
C’est donc toujours un parti politique — le parti communiste — qui sollicite et obtient des électeurs le mandat d’administrer le pouvoir.
Nous ne disons certes pas que les schémas russes doivent être adoptés tels quels partout, mais nous pensons qu il faut tendre à se rapprocher, plus même qu’en Russie, du principe directeur de la représentation révolutionnaire : le dépassement des intérêts égoïstes et particuliers dans l’intérêt collectif.
Peut-il être opportun pour la lutte révolutionnaire de constituer dès à présent les rouages d’une représentation politique de la classe ouvrière ? C’est le problème que nous aborderons dans le prochain article, en discutant du projet élaboré par la direction du parti à ce propos, restant bien clair qu’ainsi qu’on le reconnaît partiellement dans ce projet, cette représentation serait bien autre chose que le système des conseils et comités d’entreprises qui ont commencé à se former à Turin.
IV (« Il Soviet », IIIème année, n° 5 du 8-2-1920)
Nous croyons avoir suffisamment insisté sur la différence entre Conseils d’usine et Conseils politico-administratifs des ouvriers et paysans. Le Conseil d’usine est la représentation des intérêts des ouvriers limités au cercle restreint d’une entreprise. En régime communiste, c’est le point de départ du système du « contrôle ouvrier » qui représente une partie du système des « Conseils de l’économie » destinés à la direction technique et économique de la production.
Mais les Conseils d’usine n’ont aucune influence sur le système des Soviets politiques, dépositaires du pouvoir prolétarien.
En régime bourgeois, on ne peut donc voir dans le conseil d’usine — pas plus qu’on ne peut le voir dans le syndicat professionnel — un organe pour la conquête du pouvoir politique.
Si on veut y voir un organe tendant à émanciper le prolétariat par une autre voie que celle de la conquête révolutionnaire du pouvoir, on retombe dans l’erreur syndicaliste — et les camarades de « l’Ordine Nuovo » n’ont guère de raisons pour soutenir, dans leur polémique avec « Guerra di Classe », que le mouvement des Conseils d’usine tel qu’ils le théorisent n’est pas en un certain sens du syndicalisme.
Le marxisme se caractérise par la répartition anticipée de la lutte d’émancipation du prolétariat en grandes phases historiques, dans lesquelles les activités politique et économique ont respectivement des poids extrêmement différents lutte pour le pouvoir – exercice du pouvoir (dictature du prolétariat) dans la transformation de l’économie – société sans classes et sans Etat politique.
Vouloir faire coïncider dans la fonction des organes de libération du prolétariat les moments du processus politique avec ceux du processus économique, c’est ajouter foi à cette caricature petite-bourgeoise du marxisme qu’on peut appeler économisme, et qui relève du réformisme et du syndicalisme — et la surestimation du Conseil d’usine n’est qu’une autre incarnation de cette vieille erreur qui rattache le petit-bourgeois Proudhon aux nombreux révisionnistes qui ont cru dépasser Marx.
En régime bourgeois, le Conseil d’usine est donc un représentant des intérêts des ouvriers d’une entreprise, tout comme il le sera en régime communiste. Il surgit lorsque les circonstances l’exigent, à travers les modifications de l’organisation économique prolétarienne. Mais, peut-être encore plus que le syndicat, il prête le flanc aux diversions du réformisme.
La vieille tendance minimaliste à l’arbitrage obligatoire, à l’intéressement des ouvriers aux profits du capital, et donc à leur intervention dans la direction et l’administration de l’usine, pourrait trouver dans les Conseils d’usine une base pour l’élaboration d’une législation sociale anti-révolutionnaire.
C’est ce qui se produit actuellement en Allemagne malgré l’opposition des Indépendants, qui ne contestent cependant pas le principe mais seulement des modalités de cette loi — à l’inverse des communistes, pour qui le régime démocratique ne peut donner vie à un quelconque contrôle du prolétariat sur les fonctions capitalistes.
Il reste donc clair qu’il est insensé de parler de contrôle ouvrier tant que le pouvoir politique n’est pas dans les mains de l’Etat prolétarien, au nom et par la force duquel un tel contrôle pourra être exercé, comme prélude à la socialisation des entreprises et à leur administration par les organes adéquats de la collectivité.
Les Conseils de travailleurs – ouvriers, paysans et, lorsque c’est le cas, soldats – sont, c’est bien clair, les organes politiques du prolétariat, les bases de l’Etat prolétarien.
Les Conseils locaux de ville et de campagne prennent la place des conseils municipaux du régime bourgeois. Les Soviets provinciaux et régionaux prennent la place des conseils régionaux actuels, à la différence que les premiers sont désignés par des élections de second degré des Soviets locaux. Le Congrès des Soviets d’un Etat et le Comité Exécutif Central se substituent au parlement bourgeois mais sont élus par des élections de troisième et quatrième degré, et non directement.
Il n’est pas question d’insister ici sur les autres différences, dont une des principales est le droit de révocation des délégués par les électeurs à tout moment.
La nécessité d’avoir un mécanisme facile pour ces révocations fait que les élections ne sont pas des élections de liste mais l’élection d’un délégué par un groupe d’électeurs vivant, si possible, réunis par leurs conditions de travail.
Mais la caractéristique fondamentale de tout le système ne réside pas dans cette modalité, qui n’a pas de vertu miraculeuse, mais dans le critère établissant le droit électoral, actif et passif, aux seuls travailleurs, et le niant aux bourgeois.
En ce qui concerne la formation des Soviets municipaux, on tombe souvent dans deux erreurs.
L’une, c’est de penser que les délégués à ces Soviets doivent être élus par les conseils d’usine ou les comités d’usine (commissions exécutives des commissaires d’ateliers) alors qu’au contraire (c’est volontairement que nous répétons certains points) ces délégués sont élus directement par la masse des électeurs. Cette erreur se retrouve dans le projet de Bombacci pour la constitution des Soviets en Italie au paragraphe 6.
L’autre erreur, c’est de penser que le Soviet est un organisme constitué avec des représentants désignés tout simplement par le Parti socialiste, par les syndicats et les conseils d’entreprise. Les propositions du camarade Ambrosini, par exemple, tombent dans cette erreur.
Une telle méthode peut à la rigueur servir à former rapidement et provisoirement les Soviets, si c’est nécessaire, mais ne correspond pas à leur structure définitive.
En Russie, un petit pourcentage de délégués aux Soviets vient ainsi s’ajouter à ceux élus directement par les prolétaires électeurs.
Mais en réalité, le Parti Communiste et d’autres partis obtiennent leurs représentants en proposant aux électeurs des membres éprouvés de leurs organisations et en agitant face aux électeurs leur programme.
Un Soviet, selon nous, n’est révolutionnaire que lorsque la majorité de ses membres est inscrite au Parti Communiste.
Tout ceci, bien entendu, se réfère à la période de la dictature prolétarienne. Et surgit donc la question : quelle utilité, quelles fonctions, quels caractéristiques doivent avoir les conseils ouvriers, alors qu’existe encore la dictature de la bourgeoisie ?
En Europe centrale, les Conseils ouvriers coexistent actuellement avec l’Etat démocratique bourgeois, d’autant plus contre-révolutionnaire qu’il est républicain et social-démocrate. Quelle valeur a cette représentation du prolétariat, quand elle n’est pas le dépositaire du pouvoir et la base de l’Etat ? Agit-elle au moins comme un organe de lutte efficace pour la réalisation de la dictature prolétarienne ?
Un article du camarade autrichien Otto Maschl dans « Nouvelle Internationale » de Genève répond à cette question.
Il affirme qu’en Autriche les Conseils se sont paralysés eux-mêmes, qu’ils ont abdiqué et remis le pouvoir dans les mains de l’assemblée nationale bourgeoise.
En Allemagne, au contraire, après que, selon Maschl, les majoritaires et les indépendants en soient sortis, ceux-ci devinrent de véritables centres de bataille pour l’émancipation prolétarienne, et Noske dut les écraser pour que la social-démocratie puisse gouverner.
En Autriche, toujours selon Maschl, l’existence des Conseils au milieu de la démocratie, ou plutôt l’existence de la démocratie malgré les conseils, prouve que ces Conseils ouvriers sont loin d’être ce qui, en Russie, s’appelle Soviet. Et il émet des doutes sur la possibilité de surgissement, au moment de la révolution, de Soviets véritablement révolutionnaires, qui deviennent les dépositaires du pouvoir prolétarien, à la place des conseils actuels domestiqués.
Le programme du Parti approuvé à Bologne déclare que les Soviets doivent être constitués en Italie comme organes de la lutte révo1utionnaire. Le projet Bombacci tend à développer cette proposition de formation des Soviets de façon concrète.
Avant de nous occuper des aspects particuliers, nous discuterons les concepts généraux dont le camarade Bombacci s’est inspiré.
Tout d’abord, nous demandons — et qu’on ne nous traite pas de pédants — un éclaircissement. Dans la phrase : « c’est seulement une institution nationale plus large des Soviets qui pourra canaliser la période actuelle vers la lutte révolutionnaire finale contre le régime bourgeois et sa fausse illusion démocratique : le parlementarisme », faut-il comprendre que le parlementarisme est cette institution plus large, ou cette illusion démocratique ?
Nous craignons que la première interprétation soit à retenir, car elle correspond au chapitre traitant du programme d’action des Soviets, qui est un étrange mélange des fonctions de ceux-ci avec l’activité parlementaire du Parti.
Si c’est sur ce terrain équivoque que les Conseils à constituer doivent agir, il vaut certainement mieux ne rien constituer du tout.
Que les Soviets servent à élaborer des projets de législation socialiste et révolutionnaire que les députés socialistes proposeront à l’Etat bourgeois, voilà en effet une proposition qui fait la paire avec celle relative au soviétisme communalo-électoraliste de notre D.L.
Pour l’instant, nous nous bornons à rappeler à nos camarades, auteurs de tels projets, une des conclusions de Lénine qui figure dans la déclaration approuvée au Congrès de Moscou : « Il faut rompre avec ceux qui trompent le prolétariat en proclamant qu’il peut réaliser ses conquêtes dans le cadre bourgeois, ou en proposant une combinaison ou une collaboration entre les instruments de domination de la bourgeoisie et les nouveaux organes prolétariens ».
Si les premiers visés sont les sociaux-démocrates — qui ont encore droit de cité dans notre parti — ne faut-il pas reconnaître dans les seconds les maximalistes électoralistes, préoccupés de justifier l’activité parlementaire et municipale par de monstrueux projets pseudo-soviétistes ?
Nos camarades de la fraction qui l’a emporté à Bologne ne voient-ils pas qu’ils sont bien en dehors même de cet électoralisme communiste qu’on pourrait opposer — avec les arguments de Lénine et de certains communistes allemands — à notre irréductible abstentionnisme de principe ?
V (Il Soviet, IIIème année, n° 7 du 22-2-1920)
Avec cet article nous voulons conclure notre exposé, quitte à reprendre la discussion lors de polémiques avec les camarades qui, sur d’autres journaux, ont effectué des observations sur notre point de vue.
La discussion s’est désormais généralisée à toute la presse socialiste. Ce que nous avons lu de meilleur sont les articles de C. Niccolini sur l’ » Avanti ! », écrits avec une grande clarté et pourvus d’une véritable conception communiste, et avec lesquels nous sommes parfaitement d’accord.
Les Soviets, les conseils d’ouvriers, paysans (et soldats), sont la forme que prend la représentation du prolétariat dans l’exercice du pouvoir après le renversement de l’Etat capitaliste.
Avant la conquête du pouvoir, quand la bourgeoisie domine encore politiquement, il peut arriver que certaines conditions historiques, qui correspondent probablement à de sérieuses convulsions de l’organisation institutionnelle de l’Etat bourgeois et de la société, provoquent l’apparition des Soviets, et il peut être tout à fait opportun que les communistes poussent et aident à la naissance de ces nouveaux organes du prolétariat.
Il doit cependant rester bien clair que leur formation ne peut pas résulter d’un procédé artificiel ou de l’application d’une recette — et que de toute façon, le fait que les conseils ouvriers, qui seront la forme de la révolution prolétarienne, se soient constitués ne signifie pas que le problème de la révolution ait été résolu, ni même que les conditions infaillibles de la révolution aient été réalisées. Elle peut faillir — nous en donnerons des exemples — même là où les conseils existent, s’ils ne sont pas imprégnés de la conscience politique et historique communiste, condensés, dirais-je, dans le parti politique communiste.
Le problème fondamental de la révolution est donc celui de la tendance du prolétariat à abattre l’Etat bourgeois et à prendre en main le pouvoir. Cette tendance existe dans les vastes masses de la classe ouvrière en tant que résultat direct des rapports économiques d’exploitation par le capital qui détermine, pour le prolétariat, une situation intolérable, et le poussent à dépasser les formes sociales existantes.
Mais le but des communistes est de diriger cette violente réaction des foules et de lui donner une meilleure efficacité. Les communistes – comme le disait déjà le « Manifeste » – connaissent mieux que le reste du prolétariat les conditions de la lutte des classes et de l’émancipation du prolétariat ; la critique qu’ils font de l’histoire et de la constitution de la société leur donnent la possibilité de prévoir avec une assez grande exactitude le développement du processus révolutionnaire. C’est pourquoi les communistes construisent le parti politique de classe qui se propose l’unification des forces prolétariennes, l’organisation du prolétariat en classe dominante à travers la conquête révolutionnaire du pouvoir.
Quand la révolution est proche et que dans la réalité de la vie sociale ses conditions sont mûres, il faut qu’existe un fort parti communiste, qui doit avoir une conscience extrêmement précise des événements qui se préparent.
Les organes révolutionnaires qui, après la chute de la bourgeoisie, exercent le pouvoir prolétarien et représentent les bases de l’Etat révolutionnaire, sont ce qu’ils doivent être dans la mesure où ils sont dirigés par les travailleurs conscients de la nécessité de la dictature de leur classe — c’est-à-dire par les travailleurs communistes. Là où cela ne serait pas le cas, ces organes cèderaient le pouvoir conquis et la contre-révolution triompherait.
Voilà pourquoi, si ces organes doivent surgir et si les communistes doivent à un moment donné s’occuper de leur formation, il ne faut pas croire qu’ils constituent un moyen de contourner les positions de la bourgeoisie et de venir à bout facilement, presque automatiquement, de sa résistance et de sa défense du pouvoir.
Les soviets, organes d’Etat du prolétariat victorieux, peuvent-ils être des organes de la lutte révolutionnaire du prolétariat lorsque le capitalisme domine encore dans l’Etat ? Oui, mais au sens qu’ils peuvent constituer, à un certain stade, un terrain adéquat pour la lutte révolutionnaire que mène le parti. Et à ce stade, le parti tend à se constituer ce terrain, ce regroupement de forces.
En sommes-nous, aujourd’hui en Italie, à ce stade de la lutte ?
Nous pensons que nous en sommes très proches, mais qu’il y a un stade préalable qu’il faut dépasser d’abord.
Le parti communiste, qui devrait agir dans les Soviets, n’existe pas encore, Nous ne disons pas que les Soviets l’attendront pour surgir : il pourra se faire que les événements se présentent autrement. Mais alors, un grave danger se dessinera : l’immaturité du parti fera tomber ces organismes dans les mains des réformistes, des complices de la bourgeoisie, des saboteurs ou des falsificateurs de la révolution.
Et alors nous pensons que le problème de constituer en Italie un véritable parti communiste est beaucoup plus urgent que celui de créer les Soviets.
On peut également accepter d’étudier ensemble ces deux problèmes, et poser les conditions pour les affronter ensemble sans retard, mais sans fixer une date schématique pour une inauguration quasi officielle des Soviets en Italie.
Déterminer la formation d’un parti véritablement communiste signifie sélectionner les communistes, les séparer des réformistes et sociaux-démocrates. Certains camarades pensent que la proposition même de former les Soviets peut offrir le terrain de cette sélection. Nous ne le croyons pas — précisément parce que le Soviet n’est pas, d’après nous, un organe révolutionnaire par essence.
De toute façon, si la naissance des soviets doit être une source de clarification politique, nous ne voyons pas comment on pourrait y arriver sur la base d’une entente — comme dans le projet Bombacci — entre réformistes, maximalistes, syndicalistes et anarchistes.
Par contre, le fait de mettre au premier plan de nouveaux organismes anticipant sur les formes futures, tels les conseils d’usine, ou les Soviets, ne pourra jamais créer un mouvement révolutionnaire sain et efficace en Italie ; c’est une tentative aussi illusoire que celle de soustraire l’esprit révolutionnaire au réformisme en le transportant dans les syndicats, considérés comme noyaux de la société future.
Cette sélection, nous ne la réaliserons pas grâce à une nouvelle recette, qui ne fait peur à personne, mais bien par l’abandon des vieilles « recettes », des méthodes pernicieuses et fatales. Pour les raisons bien connues, nous pensons que cette méthode à abandonner, en faisant en sorte qu’avec elle les non-communistes soient éliminés de nos rangs, c’est la méthode électorale — nous ne voyons pas d’autre voie pour la naissance d’un parti communiste digne d’adhérer à Moscou.
Travaillons dans ce sens — en commençant, comme dit très justement Niccolini, par élaborer une conscience, une culture politique parmi les chefs, à travers une étude sérieuse des problèmes de la révolution, non entravée par la bâtarde activité électorale, parlementaire, minimaliste.
Travaillons dans ce sens-là — faisons davantage de propagande pour la conquête du pouvoir, pour la conscience de ce que sera la révolution, de ce que seront ses organes, de l’action véritable des Soviets — et nous aurons véritablement travaillé pour constituer les conseils du prolétariat et conquérir en eux la direction révolutionnaire qui ouvrira les voies lumineuses du communisme.
1920 : ENCORE L’ALLEMAGNE
Sur la situation en Allemagne
Clara Zetkin
Le coup d’Etat militaire-monarchiste de Kapp-Lüttwitz était une étape inévitable du développement de la dictature de la bourgeoisie, qui se cache sous le pavillon de la démocratie. Il avait pour but de rétablir le régime capitaliste et de prévenir l’établissement de la dictature du prolétariat et du système des soviets. L’Assemblée nationale, le gouvernement de coalition, ainsi que tes lois trompeuses de la socialisation et des conseils d’usines, avaient préparé le terrain pour le coup d’Etat tandis que le gouvernement de Noske s’était chargé de masser et d’armer les bataillons indispensables qui devaient réaliser le plan. Le gouvernement de coalition n’était rien de plus que l’incarnation de la sanglante terreur bourgeoise travestie sous te manteau de la démocratie. Le coup d’Etat militaire a fait tomber tous ces haillons et le militarisme est apparu dans toute sa nudité. Les partisans de Kapp veulent coûte que coûte établir la dictature bourgeoise, qui conférera l’autorité aux junkers prussiens et aux représentants de la haute finance, sous la forme d’un pouvoir militaire monarchique. Les partisans d’Ebert veulent la dictature de la bourgeoisie, qui assurerait aux industriels et aux commerçants le rôle dominant et qui se réaliserait sous la forme d’une démocratie bourgeoise. La seule garantie véritable d’une victoire sur le militarisme monarchiste serait la destruction du sol qui le nourrit et où il prend racine. — Et pour cela il est indispensable d’élargir et de développer la révolution prolétarienne, d’armer les ouvriers, de désarmer la bourgeoisie et les classes riches, et par conséquent, de détruire le militarisme repaissant, si tendrement bercé par Noske. Le gouvernement de la bourgeoisie et des socialistes a eu peur de s’engager dans cette voie. Il n’ignorait pas que ce faisant, il briserait l’épée qui défend et soutient le pouvoir des capitalistes, et que par contre il armerait en même temps l’ennemi mortel de ce pouvoir de classe, qui ne tarderait pas à porter à celui-ci un coup terrible...
Adoptant le point de vue de la collaboration politique des exploiteurs et des exploités, et considérant de son devoir de défendre le régime et la propriété bourgeoises, il est condamné à un ridicule et lâche piétinement. Il comprit tout de même que le prolétariat seul était en état de jeter bas la clique séditieuse monarchique et militaire et de défendre avec succès les soi-disant « conquêtes révolutionnaires » et la Révolution elle-même. Mais pour ce gouvernement « les conquêtes révolutionnaires » consistent en fauteuils ministériels et grasses sinécures pour leurs clients politiques et pour leurs partisans fidèles. Car, au moyen de l’état de siège, des arrestations, de la censure, des cours martiales, de la garde gouvernementale, des corps de volontaires, etc., il a ravalé ces conquêtes au niveau d’une liberté ordinaire démocratico-bourgeoise, tandis que par une série de mesures comme la fermeture de nombreux ateliers de chemins de fer, la mise en vigueur du travail aux pièces obligatoire ou volontaire, la loi sur les soviets industriels, les fusillades de grévistes, il a de nouveau renforcé le front capitaliste parmi les ouvriers.
Ce n’est pas pour la révolution, mais exclusivement pour la prolongation de leur propre béatitude, qu’Ebert et Noske ont appelé le prolétariat à proclamer la grève générale, que hier encore ils flétrissaient comme le crime le plus inqualifiable qu’on puisse commettre envers le peuple allemand. L’idée de l’armement du prolétariat les remplissait d’une peur mortelle. Ils se rendaient parfaitement compte que le prolétariat prenant les armes pour défendre la révolution et la République ne se bornerait pas à mettre les Kapp et les Lüttwitz dans l’impossibilité de nuire, mais que ce serait le signal de la lutte contre le capitalisme et contre le gouvernement de coalition, existant par la grâce de la bourgeoisie et défendant jalousement ses intérêts. Dès l’origine de la crise, il fut clair que le gouvernement consentait bien à être sauvé par les ouvriers grévistes, mais se refusait à se laisser entraîner par les ouvriers sur la voie de la lutte pour le socialisme et de la dictature du prolétariat. La fuite de Berlin, sous le fallacieux prétexte : « Dans la guerre civile, pas une goutte de sang ne doit être versée », était symptomatique. Ce prétexte constitue une contradiction flagrante avec la cruauté des disciples d’Ebert, qui ne s’arrêtent nullement devant les horreurs de la guerre civile, écrasant sans pitié à coup de mitrailleuses et de canons toute tentative révolutionnaire du prolétariat. Cette fuite ne fit que justifier ce dicton : « C’est pour mieux se réconcilier que les amis se disputent ». Le gouvernement était prêt a conclure un accord avec les impérialistes insurgés. Tous les bourgeois démocrates (à l’exception d’un petit groupe n’ayant aucune influence) désiraient de toute leur âme s’unir au pouvoir militaire rétabli, pour opprimer le prolétariat à l’unisson, il fut bien vite évident que pour ces messieurs, les soucis de la propriété et des autres biens bourgeois étaient autrement importants que toute la démocratie bourgeoise, à la défense de laquelle appelait le parti de coalition.
C’est ainsi que le prolétariat s’est vu contraint d’entrer en lutte contre la contre-révolution militariste, sans se faire cependant la moindre illusion ni sur la situation générale, ni sur les intentions de ses ennemis, mais inspiré uniquement par la conscience de sa tâche historique et de ses intérêts de classe, qui exigeaient le développement ultérieur de la révolution. Pour la masse du prolétariat il était clair qu’il fallait détruire le militarisme pour enlever cette arme de domination des mains des exploiteurs capitalistes, qu’il devait, par le désarmement de la garde gouvernementale, de l’armée volontaire de la milice civile et bourgeoise, en un mot par le complet désarmement des classes riches et l’armement des ouvriers, conquérir une forte position qui sera le point d’appui et la clé pour la conquête du pouvoir politique. La conviction générale de tous les représentants de l’avant-garde révolutionnaire du prolétariat était que sans l’armement des ouvriers, il est impossible d’organiser la défense des soviets, et qu’aucune dictature du prolétariat n’est possible. Cette conviction n’a fait que s’ancrer plus profondément dans le peuple. Et maintenant, c’est pour tous l’évidence même que ni le gouvernement, ni la démocratie bourgeoise, ne peuvent accepter ces revendications : le désarmement de la bourgeoisie et l’armement des ouvriers. Cela ne pourra être que l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. Des soviets ouvriers et des comités de guerre créés à la hâte, se mirent énergiquement à organiser et à diriger la lutte révolutionnaire. Dans un élan unanime, avec un superbe courage, les ouvriers affluèrent de toutes parts et se jetèrent dans la lutte. La grève générale comme une large vague s’est répandue sur le pays. Même le personnel technique, les employés de commerce et de diverses institutions furent submergés par cette vague. Les ouvriers et les employés de chemins de fer, de tramways, des postes et télégraphes, déclarèrent la grève. Des grèves importantes eurent lieu dans les campagnes. Il ne peut y avoir aucun doute que pour quelques catégories de prolétaires, et surtout pour les fonctionnaires ce sont les mots d’ordre des social-démocrates qui les ont ralliés à la grève pour la République, pour la démocratie, pour la constitution, contre la monarchie.
Mais il est aussi bien certain que la masse des travailleurs ne s’est pas mise en grève pour les beaux yeux de la bourgeoisie. Leur mot d’ordre était : « À bas Kapp et Hindenburg, Bauer, et Ebert ! », « A bas Lüttwitz et Noske ! ». La masse comprenait très bien que le but de sa lutte ne pouvait pas être la démocratie bourgeoise et la « collaboration » harmonieuse des exploiteurs et des exploités, que ce but devait être aujourd’hui comme demain la dictature du prolétariat. Les prolétaires n’avaient pas la naïveté de croire que ce but pouvait être l’objet concret de la lutte actuelle. Pour le moment on ne pouvait faire effort que pour consolider les positions prolétariennes afin de pouvoir pousser plus loin la lutte cour la conquête du pouvoir. La grève se déroulait partout sous le mot d’ordre : désarmement de la bourgeoisie et armement de la classe ouvrière. A ce mot d’ordre s’était ajoutée une autre revendication : la libération immédiate des révolutionnaires condamnés ou en prison préventive, la cessation immédiate de toutes poursuites intentées contre les militants révolutionnaires, la levée de l’état de siège, l’abolition de la censure, etc. Malgré la diversité des mots d’ordre proclamés par les différents partis socialistes et divers syndicats, les prolétaires se sont massés sur un seul front. Ce ne sont pas les appels et les résolutions formulés sur le papier et imaginés par les leaders et les hautes sphères qui les ont unis. Non, ce qui les soudait étroitement pour la lutte révolutionnaire, c’était ce qui était dicté par l’expérience, la conscience de leur position de classe. Ce fait caractéristique fut caché quelque peu par suite de la participation à la lutte des social-démocrates majoritaires avec les mots d’ordres de la bureaucratie syndicale. Les leaders social-patriotes tâchaient de masquer l’importance du front unique qui venait de se former. Pourtant, en dépit de tous leurs efforts, ce fait a fortement réagi sur le sentiment social des masses, qui d’instinct, en ont compris tout le sens.
Au cours de cette crise, l’importance de la ligne du Main comme frontière social-politique, s’est fortement accusée. Ce n’est pas par un pur effet du hasard que le gouvernement d’Ebert s’est enfui à Stuttgart. Le gouvernement a trouvé là une défense à droite contre la contre-révolution, à gauche contre le péril constant de la prise du pouvoir, non pas au moyen des quelques milliers de gardes gouvernementaux, d’esprit militaire, mais grâce à sa milice, formée d’étudiants, de fils à papa, de petits bourgeois, de paysans qui luttaient à leurs risques et périls, défendant la démocratie contre le « bolchevisme ».
Il était clair, comme l’ont toujours soutenu les marxistes, que dans la phase actuelle du développement social, la démocratie politique de l’Allemagne du Sud est le résultat de son état économique arriéré et non pas de son progrès politique. En dépit du sentiment social et du courage suscités par le Parti Communiste du Wurtemberg, qui avait levé vaillamment l’étendard de la lutte prolétarienne, l’existence de couches profondes de petite bourgeoisie et de paysans, l’influence du faible développement de l’industrie et des antagonismes de classe, l’absence de grandes masses prolétariennes cimentées par la conscience de leur nombre et de leur force, se sont fortement fait sentir au cours de la révolution de l’Allemagne du Sud. Il se peut même que dans l’avenir, le pays situé au sud de la ligne du Main, joue le rôle d’une « Vendée démocratique », — mutatis mutandis, dans laquelle naîtra l’idée de « l’Alliance du Rhin », et dès lors toute la force de ce mouvement sera dirigée contre le prolétariat révolutionnaire du Nord Industriel.
Il a suffi que le prolétariat géant déclarât la grève, pour que le fantôme du gouvernement insurrectionnel de Kapp-Lûllwilz se dissipât comme une bouffée de fumée. Dans cette affaire, il n’y eut pas que le caractère général de la grève qui y joua un rôle très important, mais aussi la fermeté et l’ampleur sans pareilles du mouvement à Berlin. Bien que Kapp et Lüttwitz eussent été rapidement chassés, les Kapp et les Lütttwitz sont encore nombreux en Allemagne. On n’a pas réussi à détruire complètement la soldatesque, parce que la bourgeoisie, qui veut se maintenir au pouvoir, ne peut renoncer à ses services. On n’a pas été plus heureux en ce qui concerne le désarmement de la contre-révolution bourgeoise, et l’armement des ouvriers sauf dans les localités où les prolétaires eux-mêmes se sont emparés des armes, ont chassé les troupes nationales et désarmé la garde civique, la milice municipale et les détachements de volontaires. C’est ainsi, que se sont passées les choses en Allemagne Centrale, notamment en Thuringe, en certaines localités de la Saxe et dans les provinces rhénanes de Westphalie, où les ouvriers industriels très nombreux représentent une masse compacte, pénétrée, grâce à sa supériorité numérique, de la conscience de sa force, et où le prolétariat des fabriques et des usines, riche en espérances, s’est débarrassé de toutes les illusions qu’il se faisait autrefois sur la bourgeoisie démocratique et le gouvernement de coalition. Le coup d’Etat s’est accompli sans encombre, sans effusion de sang et même sans « violences » là même où le prolétariat se trouvait sous les ordres du parti communiste, compact, bien organisé et connaissant parfaitement son but et les voies qui y mènent. En Thuringe, à Leipzig et dans la région de l’Allemagne Centrale où se trouvent les principaux gisements de houille grise, le coup d’Etat s’est terminé, après une lutte acharnée du prolétariat, par l’avènement de la terreur blanche. Ce fait a été le résultat de la trahison, à peine voilée, de la majorité social-démocrate et de la bureaucratie syndicale. Les leaders du Parti socialiste indépendant, qui ont gardé une fidélité fanatique à la vieille tactique erronée du Parti, ne sont pas eux aussi sans avoir leur part de responsabilité. Les Indépendants qui n’ont aucune ligne de conduite claire et précise, hésitaient constamment entre le désir d’abandonner le champ de bataille et les faibles velléités de lutte ; ils entamaient, chaque fois, des pourparlers aux moments où il eut fallu agir, affaiblissant ainsi la fougue des combattants et paralysant leur énergie.
Néanmoins, la crise se termina par un succès des ouvriers révolutionnaires. Le gouvernement Bauer-Noske a eu le même sort que celui de Kapp-Lüttwitz. Il va de soi que c’est là un succès très modeste, plutôt maigre. En réalité, il ne se produisit dans le gouvernement qu’un changement de personnages, qui n’étaient que des marionnettes entre les mains de la bourgeoisie au pouvoir ; quant au programme gouvernemental et à tout te système de gestion, foncièrement bourgeois, ils sont restés l’un et l’autre, sans aucune modification. Le chancelier d’empire Müller poursuit toujours l’œuvre de Bauer ; pour maintenir l’inviolabilité et la gloire du régime exploiteur bourgeois, basé sur la propriété capitaliste, Müller continue à tromper, à opprimer et à fusiller les ouvriers. Noske n’existe plus, mais le « système Noske » est toujours en vigueur et la terreur blanche militaire en pleine prospérité. Cet état de choses est dû, avant tout, à l’attitude criminelle de la bureaucratie syndicale, avec le social-traître Legien en tête ; ils réussirent à duper les ouvriers et le firent avec tant d’adresse que ceux-ci se déclarèrent satisfaits, lorsque le gouvernement consentit à donner suite, tout au moins verbale, aux neuf revendications présentées par les syndicats. Ceci obtenu, les legienistes firent sonner la retraite, exigeant la cessation immédiate de la grève qui n’eut ainsi pas le temps d’atteindre son point culminant.
Les leaders de l’aile droite des indépendants sont également responsables du résultat de la grève. Partout et toujours, ils cherchaient à lier toutes les actions politiques du parti avec celle de la bureaucratie syndicale et de la majorité social-démocratique ; en outre, la faute en est encore la faiblesse de la conscience révolutionnaire et au manque d’énergie des leaders de la gauche des indépendants qui n’ont pu résister aux Hilferding et Crispien. Néanmoins, le changement de gouvernement atteste la croissance incessante de la puissance du prolétariat que l’on est obligé de reconnaître et à laquelle on cède. Il se produisit, dans les couches les plus profondes de la société capitaliste, un mouvement assez violent qui modifia la corrélation des forces des classes en lutte pour le pouvoir et qui fit craquer l’enveloppe extérieure : le régime social est encore debout, mais il est sapé de toutes parts.
La consolidation du pouvoir de la démocratie bourgeoise et la constitution d’un gouvernement de coalition ne sont que des succès provisoires, réalisés au prix d’une complète soumission au militarisme. L’action du prolétariat révolutionnaire allia fraternellement la démocratie bourgeoise aux conspirateurs militaires monarchistes ; effrayés par le danger d’une dictature prolétarienne, ils se sont tendu les mains. Le fusionnement de tous les éléments contre-révolutionnaires en un seul bloc hostile à la classe ouvrière, est un fait accompli ; seule, une minorité insignifiante de la démocratie bourgeoise qui mène la lutte contre le danger de la droite et qui insiste sur la nécessité de faire des concessions à la gauche, n’entre pas dans la composition de ce bloc. La Frankfurter Zeitung est devenue l’organe de ce groupe, il faut en dire autant de certains milieux de petits paysans et fonctionnaires qui ont une tendance à faire des coquetteries tout au moins, au « bolchevisme nationaliste ». A l’heure actuelle, le mot d’ordre de la démocratie tout entière n’est plus la lutte contre le militarisme, mais plutôt la lutte de concert avec celui-ci contre le « bolchevisme ». La marche de ces événements, qui eut pour conséquence un dénouement contre-révolutionnaire, conduira, tôt ou tard, à la ruine de toute la démocratie bourgeoise. Elle sape ses fondements, détruit ses dernières illusions, anéantit sa confiance en elle-même et envenime la lutte de classe, la faisant tendre vers son but historique inévitable.
Une consolidation de forces, non moins considérable, s’est effectuée de l’autre pôle de la société. Depuis les combats révolutionnaires de 1919, Le processus du renforcement de la conscience révolutionnaire et du groupement du prolétariat a progressé énormément. Au fur et à mesure de la croissance de la conscience révolutionnaire, les masses ouvrières manifestent de plus en plus énergiquement leur volonté révolutionnaire, leur combativité et leur empressement à consentir à tous les sacrifices nécessaires. La tactique et la stratégie des masses se sont développées, elles sont devenues plus fermes et leur appréciation de la corrélation des forces en lutte plus juste ; leurs yeux saisissent maintenant avec plus de précision la différence entre l’objectif permanent de la lutte et ses buts provisoires ; les masses ouvrières reconnaissent maintenant plus clairement la nécessité d’être solidaires les unes des autres et d’agir en parfait accord. L’expérience de la période révolutionnaire a fait connaître au prolétariat tout entier bien des choses ; la force des traditions révolutionnaires, créées pendant les combats de l’année passée, se manifeste présentement dans la pratique. L’avant-garde révolutionnaire de la classe ouvrière a beaucoup gagné en nombre, en conscience et en force d’influence décisive sur les grandes masses ouvrières. Ce fait s’explique non seulement par la leçon édifiante et pratique des événements, mais, en même temps, par l’activité et la propagande du Parti Communiste non seulement parmi ses membres, mais aussi parmi les masses prolétariennes qui s’étaient tenues à l’écart de la lutte de classe prolétarienne, comme, par exemple, la masse des indépendants et tout particulièrement son aile gauche. Les derniers combats ont raffermi au sein du prolétariat la conscience de sa propre force ; il est sorti de ces luttes avec une compréhension plus nette de la vérité pure et simple qu’il n’y a que l’armement des masses ouvrières qui pourra les rendre forts et qu’il a besoin de ses propres organes de combat révolutionnaires, les soviets ouvriers, pour réaliser cet armement. Donc, la tâche principale de l’avant-garde révolutionnaire est de conserver les soviets surgis pendant et pour la lutte, leur insuffler la vie et les rendre aptes au combat à force d’actions révolutionnaires et non pas au moyen de formules mortes.
En s’acquittant de cette tâche, l’avant-garde révolutionnaire doit diriger le rapide mouvement révolutionnaire du moment historique actuel et en augmenter de plus en plus la vitesse. La lutte actuelle revêtira probablement d’autres forces aux prochaines élections, et dans ce cas celles-ci se présenteront sous l’aspect non pas d’élections parlementaires habituelles, mais d’élections révolutionnaires, il est même possible que le Reichstag ne soit élu que pour être dissous.
Nous ne pouvons pas encore prévoir dans quelle mesure la marche des événements changera la situation politique dans les provinces rhénanes de Westphalie, car les nouvelles qui nous viennent de là-bas manquent de précision et de clarté. Il paraît cependant que jusqu’ici la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat y a revêtu un caractère non seulement plus acharné et plus vaste qu’ailleurs, mais qu’elle s’est caractérisée aussi par un renforcement toujours plus grand de son contenu intérieur.
Dans cette lutte, le nouveau gouvernement de coalition, qui est au pouvoir grâce à Legien et avec la permission des syndicats, manifeste toute sa malhonnêteté et tout son cynisme. Ce gouvernement n’a passé les accords de Bielefeld et de Münster que pour les violer presque aussitôt. Le but de ces accords est de faire traîner la lutte en longueur, et de gagner du temps jusqu’à la fin des vacances de Pâques, date à laquelle il sera bien difficile de rassembler de nouveau les ouvriers, partis pour passer les fêtes dans leurs foyers, et de leur faire reprendre la lutte. En même temps, le gouvernement de coalition manifeste son empressement aveugle et obstiné à servir le régime capitaliste. C’est lui qui a provoqué l’entrée des troupes françaises à Francfort-sur-le-Main et à Darmstadt, en envoyant la garde blanche dans la zone neutre pour y réprimer l’insurrection ouvrière.
Quelle sera la fin de la lutte ? Ce n’est pas le degré de sagesse du gouvernement formé de social-patriotes, de représentants du centre et de démocrates, qui en décidera, mais l’intensité de la discorde intérieure qui le ronge. L’issue de la lutte dépend aussi de la violence des représailles militaires dont usera ce gouvernement pour défendre les magnats du capital et le régime bourgeois. Elle dépendra également de la conscience de classe, de la résolution aux sacrifices et de la volonté révolutionnaire que les prolétaires manifesteront, dans toute l’Allemagne, en défendant la cause pour laquelle leurs frères des provinces rhénanes de Westphalie se battent avec tant d’héroïsme et de sublime courage. Ils peuvent vaincre, ils peuvent conquérir une position très puissante dans la lutte pour le pouvoir politique, mais à condition qu’ils le veuillent, à condition qu’ils agissent avec toute l’énergie possible. Mais le sentiment social et la volonté révolutionnaire du prolétariat allemand, sont-ils assez forts pour qu’on puisse tenter, aussitôt après les grands combats de ces jours derniers, une nouvelle lutte, violente et grandiose ? Le prolétariat est le seul qui puisse répondre à cette question.
LE POINT DE VUE IMPERIALISTE SUR LA VAGUE REVOLUTIONNAIRE
La vague révolutionnaire en Europe 1918-1920, vue par les dirigeants politiques de l’impérialisme
« 24 mars 1919
Président Wilson (USA) : C’est en ce moment une véritable course contre la montre entre la paix et l’anarchie et le public commence à manifester son impatience. (...)
Lloyd George (GB) : (...) Je propose donc, avec la Président Wilson, que nous nous réunissions entre chefs de gouvernements, deux fois par jour s’il le faut, pour aller plus vire, et que nous commencions dès demain. »
« 25 mars 1919
Général Alby : La question du ravitaillement d’Odessa est posé par une série de télégrammes des généraux Berthelot et Franchet d’Espérey (...) nous oblige à trouver le moyen de nourrir, à Odessa et autour de cette ville, un million de personnes. Si nous ne pouvons pas le faire, il est inutile de songer à garder Odessa.
En réponse à une question posée par M. Lloyd George sur les effectifs alliés à Odessa, le général Alby répond qu’ils s’élèvent à environ 25.000 hommes.
Clemenceau (France) : Ce matin même, le général d’Espérey a demandé qu’on lui envoie pour Odessa des troupes polonaises d’Italie. (...)
Général Alby : L’Italie est disposée à envoyer 7.000 Polonais (...) Les autorités russes d’Odessa demandent qu’on leur fournisse du pain à raison de 1.000 tonnes par semaine, (...) 15.000 tonnes de charbon par mois sont absolument nécessaires, sans quoi le danger d’une révolte de la population serait très grand. (...)
Président Wilson : Je suis frappé, dans des dépêches qu’on nous a lues, de ces mots : « La population d’Odessa nous est hostile ». S’il en est ainsi, on peut se demander à quoi sert de garder cet îlot entouré, presque submergé par le bolchevisme. (...) Cela me confirme dans ma politique, qui est de laisser la Russie aux Bolcheviks – ils cuiront dans leur jus jusqu’à ce que les circonstances aient rendu les Russes plus sages - et de nous borner à empêcher le bolchevisme d’envahir d’autres parties de l’Europe.
Lloyd George : J’ai entendu tout récemment M.Bratiano qui considère que ce qu’il y a de plus important à faire en Roumanie : 1° de nourrir la population 2° d’équiper l’armée 3° de donner la terre aux paysans. Ce sont des moyens intelligents et efficaces de préserver la Roumanie du bolchevisme. Mais devons-nous nous obstiner à garder Odessa, dont la population se soulèvera dès que les Bolcheviks feront leur apparition ? Il vaut mieux concentrer tous nos moyens de défense en Roumanie et établir là notre barrière contre le bolchevisme. (...) La population sibérienne est-elle favorable à Koltchak ou non ?
Général Thwaites : Koltchak paraît soutenu par la population ; mais un mouvement de mécontentement et une tendance au bolchevisme se produisent dans la région occupée par les Japonais.
Lloyd George : Si Odessa tombe, qu’arrivera-t-il ?
Général Thwaites : Les Bolcheviks attaqueront immédiatement la Roumanie.
Colonel Kish : (...) L’occupation d’Odessa par les Bolcheviks donnera en Russie l’impression d’une grande victoire remportée par eux sur les Alliés. L’événement serait donc important du point de vue moral. Mais c’est la seule raison sérieuse que nous ayons de garder Odessa. (...)
Clemenceau : Le péril bolcheviste s’étend en ce moment vers le sud et vers la Hongrie ; il continuera à s’étendre tant qu’il ne sera pas arrêté ; il faut l’arrêter à Odessa et à Lemberg. (...)
Maréchal Foch : Abandonner Odessa, c’est abandonner la Russie du sud, mais à vrai dire elle est déjà perdue et nous ne la perdrons pas une seconde fois…
Clemenceau : je demanderai au Maréchal Foch s’il a un nom à nous fournir pour le général qui prendrait le commandement de l’armée roumaine. »
« 26 mars 1919
Loucheur : 30 milliards minimum est (...) ce que je crois sincèrement l’Allemagne capable de payer (...)
Lloyd George : Si les dirigeants allemands arrivent à la conclusion que ce qu’ils ont de mieux à faire est d’imiter la Hongrie et de faire alliance avec les Bolcheviks, s’ils préfèrent le risque d’une anarchie de quelques années à une servitude de trente-cinq ans que ferons-nous ? (...) Si nous avions à occuper un pays très peuplé, comme la Westphalie, tandis que l’Allemagne autour de nous se relèverait ou serait agitée par un bolchevisme contagieux, quels ne seraient pas nos dépenses et nos risques ? (...) Ma conviction est que les Allemands ne signeront pas les propositions qu’on envisage (...) L’Allemagne passera au Bolchevisme. (...)
Président Wilson : Je ne puis qu’exprimer mon admiration pour l’esprit qui se manifeste dans les paroles de M.Lloyd George. Il n’y a rien de plus honorable que d’être chassé du pouvoir parce qu’on a eu raison. (...) le gouvernement de Weimar est sans crédit. S’il ne peut rester au pouvoir, il sera remplacé par un gouvernement tel qu’il sera impossible de traiter avec lui. (...) Nous devons à la paix du monde de ne pas donner à l’Allemagne la tentation de se jeter dans le Bolchevisme, nous ne savons que trop les relations des chefs bolcheviks avec l’Allemagne.
Clemenceau : J’approuve fondamentalement M.Lloyd George et M. Wilson, mais je ne crois pas qu’il y ait désaccord entre eux et M.Loucheur qui, en homme d’affaires expérimenté, se garderait bien de rien faire qui pût tuer la poule aux œufs d’or. (...) Nous avons raison de craindre le bolchevisme chez l’ennemi (les pays vaincus) et d’éviter d’en provoquer le développement, mais il ne faudrait pas le répandre chez nous-mêmes. (...) soit en France soit en Angleterre. Il est bien de vouloir ménager les vaincus, mais il ne faudrait pas perdre de vue les vainqueurs. Si un mouvement révolutionnaire devait se produire quelque part, parce que nos solutions paraîtraient injustes, que ce ne soit pas chez nous.
Lloyd George : (...) Je sais quelque chose du danger bolcheviste dans nos pays ; je le combats moi-même depuis plusieurs semaines (...) Le résultat, c’est que des syndicalistes comme Smilie, le secrétaire général des mineurs, qui auraient pu devenir un danger formidable, finissent par nous aider à éviter un conflit. Les capitalistes anglais –dieu merci ! – ont peur, et cela les rend raisonnables. Mais en ce qui concerne les conditions de paix, ce qui pourrait provoquer une explosion du bolchevisme en Angleterre, ce ne serait pas le reproche d’avoir demandé trop peu à l’ennemi, mais celui de lui avoir demandé trop. L’ouvrier anglais ne veut pas accabler le peuple allemand par des exigences excessives. (...) De toutes manières, nous allons imposer à l’Allemagne une paix très dure : elle n’aura plus de colonies, plus de flotte, elle perdra 6 ou 7 millions d’habitants, une grande partie de ses richesses naturelles : presque tout son fer, une grande partie de son charbon. Militairement, nous la réduisons à l’état de la Grèce, et au point de vue naval, à celui de la République Argentine. Et sur tous ces points nous sommes entièrement d’accord. (...) Si vous ajoutez à cela des conditions secondaires qui puissent être considérées comme injustes, ce sera peut-être la goutte d’eau qui fera déborder le vase. »
« 27 mars 1919
Président Wilson : Je ne crains pas dans l’avenir les guerres préparées par les complots secrets des gouvernements mais plutôt les conflits créés par le mécontentement des populations. (...)
Maréchal Foch : Pour arrêter l’infiltration bolcheviste il faut créer une barrière en Pologne et en Roumanie, fermant la brèche de Lemberg, et assainir les points de l’arrière qui peuvent être infectés, comme la Hongrie, en assurant le maintien des communications par Vienne. En ce qui concerne particulièrement la Roumanie, les mesures nécessaires sont prévues en détail pour envoyer à son armée les effets et équipements qui lui manquent. Cette armée sera placée sous le commandement d’un général français. Vienne sera occupée par des troupes alliées sous un commandement américain. (...) Nous sommes d’accord sur l’aide à donner à l’armée roumaine et sur l’évacuation d’Odessa, qui est liée à notre action en Roumanie. (...) Quant à l’idée d’opérer la jonction entre les forces polonaises et roumaines pour faire face à l’est, c’est le prélude d’une marche vers et cela nous conduit à la question d’une intervention militaire en Russie. Nous avons examiné cette question plus d’une fois et nous sommes chaque fois arrivés à la conclusion qu’il ne fallait pas penser à une intervention militaire. (...) L’évacuation d’Odessa est considérée comme le moyen de reporter des ressources, dont l’emploi à Odessa ne pouvait conduire à aucun résultat satisfaisant, sur la Roumanie pour compléter ses moyens de défense. (...)
Maréchal Foch (chef des armées alliées) : Pour arrêter l’infiltration bolcheviste il faut créer une barrière en Pologne et en Roumanie, fermant la brèche de Lemberg, et assainir les points de l’arrière qui peuvent être infectés, comme la Hongrie, en assurant le maintien des communications par Vienne. (...) Contre une maladie épidémique, on fait un cordon sanitaire : on place un douanier tous les deux cent mètres et on empêche les gens de passer.
Orlando (Italie) : Je demande la permission de lire deux télégrammes que nous recevons de notre commissaire italien à Vienne sur la situation. Le premier nous informe qu’on a reçu à Vienne une dépêche du gouvernement révolutionnaire de Budapest, invitant le prolétariat viennois à suivre l’exemple des Hongrois. Il a été décidé par les révolutionnaires viennois de former un conseil de travailleurs, de manière à les mettre en état de prendre le pouvoir (...) Le second télégramme (...) considère l’infiltration bolcheviste comme probable si la garde populaire n’est pas désarmée. Le gouvernement est faible, mais il suffirait, pour rétablir la situation, d’envoyer à Vienne deux régiments américains qui seraient reçus avec soulagement par la majorité de la population. Une déclaration des Alliés au sujet des approvisionnements produirait un effet utile mais ne servirait à rien si elle venait après le triomphe des bolchevistes.
Général Diaz : Le bolchevisme est un mouvement populaire qui se manifeste partout où les vivres manquent et où l’autorité centrale est faible. (...) Son succès paraît lié aux succès du mouvement bolcheviste russe.. (...) la fermentation qui se produit actuellement n’a pas lieu seulement à Vienne, mais jusque dans les pays slovènes, partout en un mot où la population souffre de l’insuffisance du ravitaillement. En occupant Vienne fortement, on tient les voies de communication et on arrête ce progrès menaçant. Ce qu’il faut c’est donner aux populations l’impression que nous apportons des vivres, l’ordre et la sécurité. Sans cela elles se jetteront instinctivement du côté du désordre.
Général Bliss : Le mot « bolcheviste » revient si souvent dans nos débats qu’évidemment il donne le ton à tout ce qui vient d’être dit. Si nous remplacions par le mot « révolutionnaire », ce serait peut-être plus clair. Le bolchevisme est la forme prise par le mouvement révolutionnaire dans les pays arriérés qui ont particulièrement souffert. D’ailleurs nous entendons dire, tantôt que le bolchevisme russe est un produit allemand, tantôt que c’est un mouvement essentiellement russe et qui, de l’est, vient envahir l’Europe. S’il était certain qu’il vient de Russie, c’est là évidemment qu’il faudrait le tuer. Mais le problème est plus difficile. Un cordon sanitaire pourrait arrêter les bolchevistes, mais non le bolchevisme, et pour en faire une barrière véritable, il faudrait déployer des forces très considérables depuis la Baltique jusqu’à la mer Noire. (...)
Président Wilson : La question n’est-elle pas de savoir s’il est possible d’organiser une résistance armée contre le bolchevisme, ce qui veut dire : avons-nous, non seulement les troupes qu’il faut, mais les moyens matériels, et le sentiment public qui nous soutiendrait ? A mon avis, essayer d’arrêter un mouvement révolutionnaire par des armées en ligne, c’est employer un balai pour arrêter une grande marée. Les armées, d’ailleurs, peuvent s’imprégner du bolchevisme qu’elles seraient chargées de combattre. Un germe de sympathie existe entre les forces qu’on voudrait opposer. Le seul moyen d’agir contre le bolchevisme, c’est d’en faire disparaître les causes. (...) Une de ces causes est l’incertitude des populations au sujet de leurs frontières de demain, des gouvernements auxquels elles devront obéir, et, en même temps, leur détresse parce qu’elles manquent de vivres, de moyens de transport et de moyens de travail. (...) »
« 28 mars 1919
Président Wilson : Je crains beaucoup la transformation de l’enthousiasme en désespoir aussi violent que le bolchevisme qui dit : « il n’y a pas de justice dans le monde, tout ce qu’on peut faire c’est se venger par la force des injustices commises auparavant par la force. » (...)
« 29 mars 1919
Président Wilson : L’armistice nous autorise à envoyer des troupes en Pologne pour le maintien de l’ordre. Il faut bien faire comprendre aux Allemands que c’est dans ce but et pour protéger la Pologne des bolcheviks russes que les troupes du général Haller sont envoyées à Varsovie.
Lloyd George : Il n’est pas de l’intérêt du gouvernement allemand de nous empêcher de former une barrière contre le bolchevisme. (...) Sachons prendre une décision ; ne faisons pas avec la Hongrie comme avec la Russie ; une Russie nous suffit. »
« 31 mars 1919
Pichon : Que s’est-il passé (en Hongrie) ? (...) Le départ du comte Karoliyi et (. .) la chute du gouvernement (...). Une république des soviets a été proclamée. Nos missions ont été chassées et le premier acte du nouveau gouvernement a été de s’adresser à Lénine et de lui dire qu’on était prêts à marcher avec lui. (...)
Président Wilson : Il faut avant tout éclaircir la situation. Le gouvernement de Budapest (...) est un gouvernement de soviets parce que c’est la forme de gouvernement à la mode et il peut y avoir bien des espèces de soviets.
Pichon : La Hongrie nous répond par la révolution, par l’expulsion de nos missions. Nous sommes liés à la Roumanie, à qui nous avons promis de libérer les populations transylvaines.
Président Wilson : Il faut éviter, par une attitude trop dure, de pousser un pays après l’autre dans le bolchevisme. Le même danger existe à Vienne. Si nous avions à jeter là une ligne de démarcation, Vienne pourrait se jeter le lendemain dans le bolchevisme. Si de pareils événements se répètent, nous n’aurons pas de paix, parce que nous ne trouverons plus personne pour le conclure. En ce qui concerne la Hongrie (...) il ne servirait à rien de lui dire « Nous ne voulons rien avoir à faire avec vous (...) nous n’avons jamais rien eu à faire, ni les uns ni les autres, avec des gouvernements révolutionnaires. » Quant à moi, je suis prêt à entrer en conversation avec n’importe quel coquin (...)
Lloyd George : Le comte Karolyi est un homme fatigué, qui a jeté le manche après la cognée, et le bolchevisme n’a eu qu’à prendre une place vide. »
« 8 avril 1919
Orlando : Nous avons reçu un télégramme de notre légation en Suisse nous annonçant que la proclamation de la république des soviets à Vienne est probable pour le 14 de ce mois, à moins que Vienne ne soit occupée par les Alliés.
Lloyd George : Qui propose-t-on d’envoyer occuper Vienne ? pourquoi, si nous suivions ces suggestions, n’occuperions-nous pas l’Europe entière ? Nos représentants à Berlin nous tiennent le même langage ; il n’y aurait plus de raison de s’arrêter. (...) J’ai reçu un télégramme du War Office me faisant connaître que la situation en Allemagne s’aggrave et que l’on craint une catastrophe. (...) Aujourd’hui, nous apprenons la proclamation de la république des soviets en Bavière. Le danger est que, quand nous demanderons aux délégués allemands : « qui représentez-vous ? », ils ne sachent que répondre. (...) Nous sommes d’accord pour examiner ce que nous aurons à faire non seulement si l’Allemagne tombe en décomposition, mais aussi si la situation s’aggrave en Autriche et dans les pays voisins. (...) »
« 16 avril 1919
Balfour : Il y a, sur la côte de la Baltique, des troupes allemandes qui luttent contre les Bolcheviks et qui nous demandent de les aider en leur fournissant du charbon et des vivres et même en leur permettant de recevoir des renforts d’Allemagne. Nous avons consenti (...) »
« 18 avril 1919
Le Président Wilson donne lecture du texte sur la Pologne.
Lloyd George : Un article que je n’aime pas est celui qui demande la dissolution des conseils d’ouvriers et de soldats. L’exécution n’en est pas facile.
Clemenceau : C’est ce que nous avons fait sur les territoires que nous occupons.
Lloyd George : Sans doute, mais nous nous désirons précisément éviter d’avoir à occuper cette région éloignée.
« 21 avril 1919
Orlando : Quant à moi, j’ai toujours eu le souci de calmer l’opinion. (...) Si je revenais en Italie en apportant une paix qui provoquerait un soulèvement de la population, je rendrai un mauvais service au monde entier. Si l’opinion du président Wilson prévaut, il y aura une révolution en Italie, n’en doutez pas. Récemment des échauffourées se sont produites à Rome et à Milan entre le bolchevistes et les patriotes. Ce sont les bolchevistes qui ont été battus. A Milan, deux d’entre eux ont été tués. Or cet élément nationaliste qui est si excité en ce moment ferait la révolution si la paix lui paraissait mauvaise (...) Une Italie déçue et mécontente, ce sera la révolution et un danger pour le monde entier.
Balfour : Mais supposez que l’Italie se brouille avec les Etats-Unis, je ne vois pas comment la vie économique pourra continuer, et, dans ce cas, comment éviterez vous la révolution sociale ?
Orlando : J’ai encore espoir d éviter la révolution sociale si je reste avec mon pays. »
« 22 avril 1919
Lloyd George : J’ai peur d’une crise que nous ne puissions plus maîtriser (...) Notre pauvre Europe est comme un terrain semé de grenades ; si on y met le pied, tout saute. »
« 23 avril 1919
Président Wilson : Il n’est pas possible de faire quoi que ce soit dans ce pays (l’Allemagne) avant que la population ait les vivres et les moyens de travail indispensables. La disette, au sens le plus général du mot, est le terrain sur lequel croît le bolchevisme. (...) Je ne peux pas consentir à donner à donner à l’Italie ce qui serait la cause d’une séparation dangereuse entre le monde slave et l’Europe occidentale. Nous sommes devant une alternative : ou nous attirerons les slaves du sud vers l’Europe occidentale et vers la Société des Nations, ou nous les rejetterons vers la Russie et le bolchevisme. »
« 24 avril 1919
Président Wilson : Dans les villes (allemandes) il y a du bolchevisme. »
« 29 avril 1919
Vandervelde : Nous avons, à l’heure présente, 800.000 chômeurs survivent avec une allocation de 777 à 14 francs par semaine. La vie, en Belgique, est trois fois plus chère qu’en 1914. Cependant l’ordre et le calme n’ont cessé d’y régner. Ce qui les a maintenus, c’est d’abord l’organisation très forte de notre parti ouvrier dont je suis fier de dire qu’elle est la plus puissante garantie d’ordre qui existe dans notre pays (...). Je ne suis pas suspect de vues extrêmes (...) Dans le discours que j’ai prononcé en séance plénière sur les conditions de travail, j’ai dit que les ouvriers belges, ayant à choisir entre la méthode anglaise et la méthode russe, avaient choisi la méthode anglaise. Mr Lloyd George m’a dit qu’il était fier de voir que les ouvriers belges reconnaissaient l’excellence de la méthode britannique. Mais pour que cela dure, il est indispensable que vous nous aidiez : il y va de l’avenir de nos travailleurs et de notre pays même. ».
« 30 avril 1919
Lloyd George : Pour l’emploi du temps, il a été proposé d’étudier la semaine prochaine les questions relatives à la paix en Autriche. (...)
Ce qui me rallie à la proposition de M. Lloyd George, c’est l’effet moral que la convocation aura en Autriche. Les dépêches que nous recevons de Vienne indiquent l’urgence de soutenir le gouvernement actuel. La disette, le sentiment que la paix n’est pas en vue, créent un état d’esprit dangereux (...)
Lloyd George : Je propose d’entendre M. Tchaïkovsky le chef du gouvernement d’Arkhangel (...) Les renseignements que nous recevons indiquent que Koltchak avance et pourra sans doute rejoindre Arkhangel (...) et, d’autre part, que le gouvernement de Lénine est encore puissant, mais incline peu à peu vers une politique plus modérée.
Clemenceau : Nos informations tendent à montrer que la puissance des Bolcheviks décline.
Lloyd George : Ici nos informations diffèrent. (...)
Président Wilson : Un des éléments qui troublent la paix du monde est la persécution des Juifs. Vous savez qu’ils sont particulièrement mal traités en Pologne et qu’ils sont privés des droits de citoyen en Roumanie. (...) Rappelez-vous que, quand les Juifs étaient traités en hors la loi en Angleterre, ils agissaient comme des gens hors la loi. Notre désir est de les ramener partout dans la loi commune. (...) (Suite le 3 mai) Nos gouvernements, du moins les gouvernements britannique et américain, ont pris, vis-à-vis des Juifs, l’engagement d’établir en Palestine quelque chose qui ressemble à un Etat israélite, et les Arabes y sont très opposés.
(Suite le 17 mai) Ce n’est pas seulement un sentiment de bienveillance à l’égard des Juifs, mais par l’incertitude du danger que le traitement injuste des Juifs crée dans différentes parties de l’Europe. Le rôle des Juifs dans le mouvement bolcheviste est dû sans aucun doute à l’oppression que leur race a subi pendant si longtemps. Les persécutions empêchent le sentiment patriotique de naître et provoquent l’esprit de révolte. A moins que nous ne portions remède à la situation des Juifs, elle restera un danger pour le monde.
(Suite 6 juin) France, Italie, Grande Bretagne, Etats-Unis, ce n’est pas sur leurs territoires que l’on trouve cet élément juif qui peut devenir un danger pour la paix en Europe, mais en Russie, en Roumanie, en Pologne, partout où les Juifs sont persécutés.
Lloyd George : Cette difficulté subsistera jusqu’à ce que les Polonais deviennent assez intelligents pour savoir tirer parti de leurs Juifs, comme le font les Allemands.
(Suite 23 juin) Président Wilson Le plus important est d’apaiser les inquiétudes des Juifs. Je crains toujours de laisser subsister de ce côté un ferment dangereux. »
« 2 mai 1919
Lloyd George : On me fait savoir que, dans plusieurs villes d’Italie, des soldats anglais ont été insultés dans les rues. (...)
Président Wilson : En jetant un cristal dans un liquide, on le fait parfois cristalliser tout entier.
Lloyd George : Quelquefois aussi, on provoque une explosion.
Président Wilson : L’explosion s’est déjà produite. (...) l’attitude de l’Italie est indubitablement agressive. (...) »
« 7 mai 1919
Lloyd George : Je voudrai vous parler de la Russie La situation s’y transforme de la façon la plus remarquable : nous assistons à un véritable effondrement du bolchevisme, à tel point que le cabinet britannique sollicite de nous une décision immédiate sur notre politique en Russie. D’après nos renseignements, Koltchak est sur le point de joindre ses forces à celles d’Arkhangel ; il est possible aussi qu’il arrive à bref délai à Moscou et y établisse un nouveau gouvernement. (...)
Président Wilson : Que fournissez-vous à Koltchak et à Dénikine ?
Lloyd George : Des armes et des munitions. »
« 8 mai 1919
Président Wilson : Rien n’a été décidé sur les frontières de la Russie ou celles qu’il a lieu d’établir à l’intérieur de l’ancien empire russe. »
« 9 mai 1919
Président Wilson : Quand nous essayâmes pour la première fois d’envoyer des vivres aux populations russes (...) des troupes américaines ont assuré la police du chemin de fer entre le Pacifique et Irkoutsk. Notre gouvernement n’a pas confiance dans l’amiral Koltchak qui est soutenu par la France et l’Angleterre. (...) Dans ces conditions, nous devons ou prendre le parti de soutenir Koltchak et de renforcer notre armée d’occupation, ou nous retirer totalement. Mais si nous augmentons nos effectifs, le Japon fera de même. Quand nous sommes allés en Sibérie, nous nous étions entendus avec le Japon pour envoyer là-bas des forces équivalentes. En fait, nous avons envoyé 9000 hommes et le japon 12000. Mais, peu à peu, il a augmenté ses effectifs et les a porté à 70.000 hommes. (...) Si, d’autre part, nous renforçons les troupes qui gardent le chemin de fer, je crains une coalition entre les Cosaques et les Japonais contre nous. Pour moi j’ai toujours été d’avis de nous retirer de Russie (...)
Lloyd George : (...) Il devient nécessaire de nous entendre sur une politique commune en Russie. D’après nos renseignements, l’amiral Koltchak avance rapidement à l’ouest de l’Oural et cela semble démontrer que les Bolcheviks n’ont plus la force de résister, ou que les moyens de transport leur manquent complètement. Quelles sont les dernières nouvelles ?
Sir Maurice Hankey : Les derniers télégrammes montrent que l’amiral Koltchak envoie des forces à la fois dans la direction d’Arkhangel et vers le sud-ouest.
Président Wilson : Nous avons certainement le droit de demander à Koltchak quelles sont ses intentions.
Lloyd George : D’abord sur la question agraire, il faut lui demander s’il est bien résolu à ne pas reprendre la terre aux paysans.
Président Wilson : D’après les informations que j’ai reçues d’un homme qui connaît très bien la Russie et sa situation présente, les paysans se sont emparés de la terre irrégulièrement et au hasard. (...)
Lloyd George : Il faut se résigner à des irrégularité de ce genre dans une révolution : le fait s’est produit lors de la révolution française. (...)
Lloyd George : Si l’amiral Koltchak peut nous rejoindre, c’est la fin du bolchevisme. ( ..)
Président Wilson : Les troupes américaines d’Arkhangel ne sont pas bien sures. (...) Il est toujours dangereux de se mêler de révolutions étrangères. (...)
Lloyd George : Ici ce sont des Russes qui agissent et nous ne ferons que les seconder. (...)
Lord Robert Cecil : Le grand problème que nous avons à résoudre est de remettre l’Europe au travail. Partout, le chômage se développe, surtout dans les Etats nouveaux. Se borner à nourrir cette population de chômeurs serait presque sans effet au point de vue politique : s’ils sont nourris et sans travail, ils seront encore plus disposés à se révolter que dans la plus extrême détresse. (...) Ce qui est certain, c’est que si rien n’est fait, nous nous trouverons en présence du chaos et de l’anarchie. »
« 10 mai 1919
Président Wilson : Une intransigeance de notre part aurait pour résultat une révolution en Pologne. et, pour commencer, la chute de son gouvernement. (...)
Lloyd George : J’ai reçu ce matin un autre rapport qui me dit qu’à mesure que Koltchak avance, il se produit des désordres derrière lui. Les Bolcheviks ont quelques succès en Sibérie orientale. Cela ne veut-il pas dire que l’on croit que si Koltchak réussissait, le but final de son entourage serait le retour au passé ? Ne croit-on pas que c’est à cela que les Alliés veulent l’aider ? (...) »
« 17 mai 1919
Maharadjah de Bikaner : Nous ne pouvons que déconseiller de la manière la plus formelle tout partage de la Turquie (...) C’est avec tout le sentiment de ma responsabilité que j’appelle votre attention sur le danger de désordre et de haine que cette question contient, non seulement pour l’Inde mais pour le monde entier.
Montagu : Il y a un danger véritable chez les peuples musulmans. (...) Un Américain qui avait été prisonnier des Bolcheviks à Tachkent (...) a été frappé par l’attitude des Musulmans à l’égard des Alliés : le sentiment parmi eux était que la Conférence prenait position contre l’Islam. Je n’ai pas besoin de rappeler les événements récents qui se sont produits en Egypte et dans l’Afghanistan. Dans le Pendjab, des agitateurs hindous, excités par les Bolcheviks, provoquaient les populations à la révolte. (...) Il est sans exemple que l’on ait ainsi ouvert les mosquées à des prédicateurs ou à des orateurs qui n’appartenaient pas eux-mêmes à la religion musulmane. »
« 19 mai 1919
Président Wilson : La situation à Varsovie est certainement dangereuse. L’opinion est très montée et aux excitations nationalistes se mêlent des menaces de grève générale des postes et des chemins de fer. (...) Paderewski nous avertit qu’une intransigeance complète de notre part aurait pour résultat une révolution en Pologne et, pour commencer, la chute de son gouvernement. (...) Le seul moyen de régler la question hongroise est une intervention militaire. Il n’y aurait pas de résistance. (...) On nous conseille d’envoyer à Budapest une mission politique ayant à sa tête un homme comme le général Smuts pour assurer l’établissement d’un gouvernement stable. (...)
Lloyd George : Nous sommes au milieu des sables mouvants. (...) Avez-vous vu le télégramme de Lénine qui accuse les troupes de Denikine d’atrocités. J’ai bien peur qu’en fait les atrocités n’aient lieu des deux côtés. Que penser des victoires de Koltchak ? (...)
Président Wilson : Même incertitude au sujet de la Hongrie. Nous recevons des rapports sur l’impopularité de la dictature du prolétariat. (...) La conclusion de mon représentant est que le seul moyen de régler la question hongroise est une intervention militaire. (...)
Clemenceau : Il me paraît bien difficile d’occuper Budapest. Que nous demandera-t-on d’occuper ensuite ? Ce n’est pas la première fois qu’on nous invite à occuper telle ou telle partie de l’Europe. (...)
Président Wilson : J’ai donné au Département d’Etat l’instruction d’entrer directement en communication avec l’amiral Koltchak et de lui poser un certain nombre de questions, notamment sur ses intentions en ce qui concerne l’Assemblée Constituante et le régime agraire. »
« 20 mai 1919
Lord Robert Cecil : Lénine ne veut pas accepter la condition de suspension des hostilités. Après consultation avec le Conseil suprême économique, je conseille aux gouvernements de choisir entre deux politiques : il faut ou écraser les Bolcheviks ou imposer aux différents groupes belligérants de la Russie (...) qu’une Constituante soit immédiatement convoquée. En tout cas, il ne faut pas essayer de mêler les deux systèmes. (...)
Clemenceau : Si nous cessons d’envoyer des armes à Koltchak et à Denikine, ce n’est pas cela qui arrêtera Lénine. (...)
Lloyd George : D’un côté, nous avons des révolutionnaires violents et sans scrupules, de l’autre des gens qui prétendent agir dans l’intérêt de l’ordre, mais dont les intentions nous sont suspectes. Toutefois, nous avons le devoir de ne pas abandonner ceux dont nous avons eu besoin (...)
Lloyd George : Nous aurons aussi à examiner la question des provinces baltiques. (. ;) Comment faire fond sur ces populations ? Nous avons à un moment donné cherché à leur distribuer des armes pour combattre contre les Bolcheviks, mais nous y avons renoncé, parce que nous trouvions trop peu de gens en qui on pût avoir confiance. »
« 21 mai 1919
Lloyd George : Le monde musulman s’agite, vous savez nos difficultés en Egypte, l’Afghanistan est en état de guerre avec nous. Pendant la guerre nous avons levé dans les Indes plus d’un million d’hommes, presque tous musulmans, ce sont eux qui ont supporté presque tout le poids de la lutte contre la Turquie, quoique encadrés par des troupes blanches. Le monde musulman n’oublie pas cela. La division de la partie proprement turque de l’Asie Mineure serait injuste et impolitique (...)
Général Le Rond : Les Ukrainiens n’ont que médiocrement résisté aux Bolchevistes. (...) Les Polonais sont beaucoup plus capables qu’eux d’arrêter la marche en avant du bolchevisme.
Général Botha : Les Polonais, avec des munitions qu’ils reçoivent de nous, attaquent des gens qui ne sont pas nos ennemis (Ukraine). S’ils ont besoin de ce que nous leur donnons pour combattre les Bolchevistes, nous sommes prêts à continuer à le leur donner. (...) Si nous tolérons ce que la Pologne fait aujourd’hui, nous jetterons nous-mêmes le peuple ukrainien dans les bras des Bolcheviks.
Président Wilson : Si Paderewski tombe et que nous coupions les vivres à la Pologne, la Pologne elle-même ne deviendra-t-elle pas bolcheviste ? Le gouvernement de Paderewski est comme une digue contre le désordre, et peut-être la seule possible.
Lloyd George : Les Polonais estiment que le moyen de combattre les Bolchevistes n’est pas de s’unir avec les Ukrainiens contre eux, mais de supprimer les Ukrainiens. Quarante millions d’Ukrainiens, s’ils sont foulés aux pieds, se soulèveraient contre nous et pourraient créer un nouveau bolchevisme quand l’ancien se serait effondré. »
« 23 mai 1919
Orlando : Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir nier que l’état d’esprit en Italie est fort préoccupant. C’est un aveu qui me coûte beaucoup. L’exaspération de l’opinion italienne vient en partie de la fatigue de la guerre, en partie de la sensation d’anxiété provenant du fait que l’Italie ne voit pas les questions qui l’intéressent recevoir leur solution. (...) Il en est résulté une tension qui va, je le reconnais, jusqu’à la folie de la persécution ; et cela se tourne contre le gouvernement italien lui-même.
Président Wilson : N’est-ce pas l’Angleterre qui a fourni la plus grande partie des armes et des munitions à Koltchak et à Denikine ? Les Etats-Unis n’ont rien fourni, sauf aux Tchécoslovaques.
Lloyd George : C’est en effet la Grande-Bretagne qui a fait la plus grande partie de ces fournitures.
Clemenceau : Nous en avons fait aussi mais moins que vous.
Président Wilson : Notre rôle est différent. Nous n’avons fait que venir en aide aux Tchécoslovaques et assurer en partie la garde du chemin de fer transsibérien. (...)
Lloyd George : Il faut reprendre la question de l’armement des petits Etats de l’Europe centrale. (...)
Nous laisserons des troupes à la Pologne à cause du voisinage de la Russie. Nous laisserons des troupes à la Roumanie pour la même raison. »
« 24 mai 1919
Président Wilson : Nous craignons que l’amiral Koltchak, le général Denikine et le gouvernement d’Arkhangel ne soient soumis à des influences contre-révolutionnaires et que, s’ils n’ont pris aucun engagement vis-à-vis de nous, leur victoire n’aboutisse à une réaction qui conduirait sans doute à de nouveaux désordres et à une nouvelle révolution. (...)
Lloyd George : En Angleterre, le sentiment contre l’action de toute troupe britannique en Russie est de plus en plus fort. En revanche, nous pouvons laisser tous les individus qui, de leur propre gré, s’engageront au service d’un des gouvernements russes (Koltchak ou Denikine), leur fournir cette sorte d’assistance individuelle. En fait, lorsque nous avons demandé des volontaires pour notre corps d’occupation d’Arkhangel, nous en avons trouvé beaucoup. (...) D’ailleurs, ce qu’il faut en Russie, ce sont avant tout des spécialistes, artilleurs, aviateurs, etc… (…) Il est peut-être mieux de ne même pas mentionner ces volontaires dans notre dépêche (...).
Président Wilson : Ce n’est pas moi qu’il faut persuader mais le Congrès des Etats-Unis qui s’est montré jusqu’à présent hostile à l’idée de toute intervention en Russie. Je crois que cette attitude pourra changer si l’amiral Koltchak réponde d’une manière satisfaisante aux questions que nous allons lui poser. (...) Mais, pour aider l’amiral Koltchak dans sa marche vers l’ouest, nous ne lui fournissons que des moyens matériels, en laissant aux individus le droit de s’engager volontairement dans les armées russes. (...) Notre ambassadeur à Tokyo est en route pour Omsk ; il doit voir l’amiral Koltchak et se former une opinion sur lui et son entourage.
Lloyd George : Il serait bon d’envoyer quelqu’un faire la même enquête chez le général Denikine. (...) Denikine est entouré de bons officiers mais dont les méthodes sont brutales : ils ont fusillé quinze mille bolchevistes après les avoir fait prisonniers. »
« 26 mai 1919
Président Wilson : Le traité de Londres a été conclu dans des circonstances qu,i depuis, se sont modifiées. (...) L’opinion du monde elle-même s’est modifiée. (...) le monde n’avait pas encore compris qu’il y avait là une question qui le regardait (l’oppression des peuples colonisés menaçant de se joindre à la révolution russe et européenne) et dans laquelle son avenir même était en jeu, c’est ce qui n’a été compris que graduellement aux Etats-Unis et dans d’autres pays. (...) C’est alors que j’ai fait au Congrès mon discours sur nos buts de guerre (. ;) mes quatorze points (...). Le traité de Londres est fondé sur l’idée de l’ancienne politique européenne que la puissance la plus forte a le droit de régler le sort de la plus faible. (...) Si aujourd’hui cette idée était maintenue, elle provoquerait des réactions fatales à la paix du monde. »
« 28 mai 1919
Clemenceau : Nous allons discuter (...) pour tous les petits Etats (...) la question de la limitation de leurs armements (...)
Président Wilson : Il y a, dans cette partie du monde, un facteur inconnu : c’est la Russie. Ne pouvons-nous pas dire que, là où ce facteur peut se faire sentir, des forces militaires pourront être maintenues suffisantes pour parer à toute éventualité ?
Clemenceau : ce qu’il faut surtout, c’est ne pas trop hâter le désarmement des Etats d’Europe centrale.
Lloyd George : Je crains ce qui peut arriver si ces Etats ont des armées très supérieures à celle de l’Autriche. Je n’ai pas grande confiance dans la Roumanie, dans la Serbie.
Président Wilson : Il vaut mieux établir un régime provisoire tant que la période d’incertitude et de désordre continue. Il est impossible aujourd’hui, quand l’est de l’Europe est dans un état si critique, de militer définitivement les forces de chaque Etat. »
« 29 mai 1919
Lloyd George : En Russie, rien n’a plus contribué à rendre les Bolcheviks populaires que l’occupation étrangère. (En Europe centrale) il faut éviter que l’occupation irrite la population, accumule les haines et crée un danger pour l’Europe entière. »
« 2 juin 1919
Lloyd George : J’estime qu’il est de mon devoir de vous indiquer la situation de la délégation britannique en ce qui concerne le traité de paix. Elle est difficile. Notre opinion publique désire avant tout la paix (...) elle ne soutiendrait pas un gouvernement qui reprendrait la guerre. »
« 3 juin 1919
Lloyd George : Je crains que Koltchak n’ait subi un échec sérieux. » « 6 juin 1919
Le président Wilson donne lecture du télégramme de l’amiral Koltchak en réponse à la demande de garanties des Alliés : (...) « Il paraît impossible de rappeler l’assemblée de 1917 élue sous un régime de violence bolcheviste et dont les membres sont maintenant en majorité dans les rangs des Soviets. »
« 9 juin1919
Président Wilson : Je prie les membres du Conseil militaire interallié de nous faire connaître la situation militaire en Hongrie. (...)
Lloyd George : J’ai des informations récentes d’un Anglais, venu de Budapest, et d’ailleurs très hostile à Bela Kun. Il rejette toute la faute de ce qui est arrivé sur les Roumains. (...) Bela Kun, à ce moment, était perdu. Il était isolé dans Budapest. Sa situation pouvait se comparer à celle de la Commune de Paris immédiatement avant sa chute. L’avance des Roumains a soulevé le sentiment national hongrois et donné à Bela Kun une armée (...) J’ai reçu deux télégrammes de notre représentant militaire à Prague. Le premier dit que la situation est très grave, que les Tchèques manquent de munitions, que Presbourg est menacé et que le bolchevisme se développe en Slovaquie. Le second annonce qu’à la requête du Président Masaryk, le général Pellé a été placé à la tête de l’armée tchécoslovaque et la loi martiale proclamée à Presbourg. (...) Le général Franchet d’Esperey, qui nous représente tous, a donné une première fois aux Roumains ordre de s’arrêter. Cet ordre n’a pas été obéi. (...) Je propose d’arrêter tout envoi de matériel à la Roumanie jusqu’à ce qu’elle ait obéi à notre ordre. (...) La plus grande partie de nos difficultés vient de ce que les Etats qui sont nos amis refusent de suivre nos instructions. (...)
Président Wilson : Je n’aime pas jouer les dépôts de munitions. Cela peut produire des explosions. (...)
Lloyd George : Les Allemands ne savent plus où ils en sont. Ils ressemblent à un homme pris dans un cyclone, à qui l’on demanderait tout à coup : « à quel prix vendez-vous votre cheval ? » D’ailleurs nous sommes un peu dans la même situation. (...) Il faut aboutir. Nous ne pourrons tenir aucune des autres nations tant que nous n’aurons pas fait la paix avec l’Allemagne. »
« 10 juin 1919
Président Wilson : Nous vous avons convoqués, Messieurs, parce que nous sommes très préoccupés de la situation militaire en Hongrie et autour de la Hongrie. (...) Cette seconde offensive (roumaine) a eu comme conséquence la chute de Karolyi, dont l’attitude envers l’Entente était plus amicale que celle d’aucun autre homme d’Etat hongrois .C’est alors que Bela Kun s’empara du pouvoir. Son gouvernement n’était pas de nature à être accepté par les classes les plus établies de la population. Mais quand les Tchèques, à leur tour, attaquèrent le territoire hongrois. On nous rapporte que les officiers de l’ancienne armée hongroise eux-mêmes vinrent se ranger autour du gouvernement de Bela Kun. Celui-ci donc arrivé au pouvoir en conséquence de l’offensive roumaine y a été consolidé par l’offensive tchèque. Rien ne peut être plus fatal à notre politique. (...) Nous devons éviter de créer nous-mêmes le bolchevisme en donnant aux populations des pays ennemis de justes raisons de mécontentement. »
« 12 juin 1919
Lloyd George : En réponse à l’amiral Koltchak, nous ne pouvons faire plus que lui promettre notre appui. Il est impossible de reconnaître son gouvernement comme celui de toute la Russie. (...)
Orlando : Il y a en Italie une grève qui me préoccupe (...)
Lloyd George : J’ai eu quelques renseignements sur ce qui s’est passé à Rome pendant la visite de Ramsay MacDonald. Les socialistes italiens étaient d’avis de faire un coup, d’accord avec les groupes ouvriers de France et d’Angleterre. (...)
Orlando : L’agitation qui a lieu en Italie en ce moment est surtout dirigée contre la hausse des prix. Il y a eu quelques incidents sérieux à La Spezia : une personne a été tuée et deux blessées.
Lloyd George : Cette question des prix me préoccupe beaucoup et je crois que nous devrons bientôt faire un effort pour la résoudre en commun. A mon avis, il faudra établir un système d’achats interalliés. Autrement nous courrons à une révolution dans toute l’Europe. »
« 13 juin 1919
Lloyd George : Les moyens militaires à employer si les Allemands refusent de signer (la paix) ont été étudiés. Mais, à mon avis, le meilleur moyen d’obtenir la signature, c’est d’annoncer dès maintenant que nous nous préparons, en cas de refus, à reprendre le blocus. (...) Ce que je veux, c’est hâter la conclusion de la paix. Si la paix ne vient pas promptement, je crains un chaos qui serait bien pire que tout ce qu’ont pu faire des années de blocus (...) J’ai peur de trouver à Berlin un autre Moscou (...)
Président Wilson : La famine a produit ailleurs le chaos et je crains qu’elle ne le produise aussi en Allemagne.
Clemenceau : Lloyd George n’a pas envie d’aller à Berlin, moi non plus. »
« 17 juin 1919
Lloyd George : Le Conseil économique nous demande s’il n’y a pas lieu de lever le blocus de la Russie bolcheviste et de la Hongrie dès la signature du traité avec l’Allemagne. La question, en réalité, se borne à savoir si les allemands seront les seuls à avoir le droit de commercer avec la Russie. (...) Si je croyais que nous puissions écraser les Bolcheviks cette année, je serai d’avis de faire un grand effort auquel participeraient les flottes anglaise et française. Mais l’amiral Koltchak vient d’être repoussé à trois cent kilomètres en arrière. Une des ses armées est détruite. (...) Pour moi, l’amiral Koltchak ne battra pas Lénine. Il arrivera plutôt un moment où les adversaires se rapprocheront pour mettre fin à l’anarchie. Il semble que les affaires militaires des Bolcheviks soient bien conduites. Mais les observateurs qui nous renseignent disent que la pure doctrine bolcheviste est de plus en plus abandonnée et que ce qui se constitue là-bas, c’est un Etat qui ne diffère pas sensiblement d’un Etat bourgeois.
Clemenceau : Etes-vous sûr du fait ?
Président Wilson : Il est peut-être encore trop tôt pour le croire. (...)
Clemenceau : Il faut, en tout cas, tenir l’engagement que nous venons de prendre vis-à-vis de l’amiral Koltchak.
Lloyd George : Certainement. (...)
Président Wilson : Nous ne nous sommes engagés d’ailleurs qu’à l’aider en lui fournissant du matériel. (...) La question est celle-ci : sommes-nous en guerre avec la Russie bolcheviste ?
Lloyd George : Des troupes britanniques sont à Arkhangel. (...)
Président Wilson : Je vous signale que le Conseil interallié des transports maritimes a donné hier l’ordre d’arrêter les navires chargés de vivres à destination des ports de la Baltique (...) Je rappelle que j’ai beaucoup insisté pour que nous commencions par l’action militaire et que nous n’ayons recours au blocus qu’en dernier lieu. (...) Je ne suis pas d’avis de réduire à la famine la population d’un grand pays, sauf si c’est le dernier moyen d’action qui nous reste (...) »
« 23 juin 1919
Balfour : Une dépêche interceptée du gouvernement de Weimar à la délégation allemande de Versailles (...) : le gouvernement allemand se déclare prêt à signer. (...)
Lloyd George : M. Winston Churchill viendra sous peu vous parler du rapatriement des Tchèques par Arkhangel. On réclame instamment en Bohême le retour des troupes tchèques de Russie. M. Winston Churchill est surtout préoccupé d’établir, si cela est possible, des communications entre l’amiral Koltchak et Arkhangel, et les troupes tchèques sur le retour pourraient y aider. Mais il faut pour cela qu’elles soient remplacées le long du Transsibérien par des troupes japonaises et américaines. »
« 25 juin 1919
Clemenceau : Si nous prenons l’attitude qu’il faut, je crois qu’il y aura en Pologne des troubles locaux, mais pas de lutte armée. En tout cas, il ne faut pas laisser grandir le mouvement. (...) Le président Wilson nous prie de ne pas recommencer la guerre. Je le crois bien ! Mon pays a souffert plus que tout autre. Il s’élève en France un cri universel pour la démobilisation. (...) Toutefois, il y a un intérêt suprême qui s’élève au dessus du désir légitime d’en finir avec la guerre : il ne faut pas que les résultats de la guerre nous échappent par notre faiblesse. (...)
Lecture d’un rapport de la commission des affaires baltiques sur l’avance allemande qui se poursuit systématiquement. Le danger du côté des Bolcheviks n’est pas moins sérieux. (...) Un rapport annexe provenant des agents des Puissances alliées et associées dans la Baltique demande l’envoi d’une mission militaire interalliée sous le commandement d’un général anglais. Il demande également l’envoi d’instructeurs et d’armes. (...)
Lloyd George : Voilà des gens qui se battent pour leur liberté, et qui ne pourront pas continuer si nous ne leur envoyons pas d’argent. Pour ce qui est de les approvisionner en vivres et en munitions j’y suis prêt et je sui d’avis de leur envoyer la mission demandée. (...) Vous vous souvenez de l’échec et du recul de l’amiral Koltchak : il a perdu trois cent kilomètres de terrain. Mais en même temps Dénikine avance du côté du sud et les cosaques du Don se sont levés pour l’aider. (...) D’après un rapport, même si le front bolchevik était percé, les tchécoslovaques n’arriveraient pas à Arkhangel en temps voulu pour y être embarqués avant l’hiver. Nous pouvons leur proposer de faire un effort pour hâter leur libération mais nous courrons quelque risque si l’effort ne réussit pas. »
« 26 juin 1919
Clemenceau : J’ai reçu un télégramme de Bela Kun il y a quelques jours. Il demandait des garanties dont la première était la reconnaissance de la république des soviets. Je n’ai pas répondu. (...)
Lloyd George : Nous ne pouvons pas dire que nous ne reconnaîtrons jamais un gouvernement de soviets. Si défectueux que soit ce genre de gouvernement, il est, somme toute, plus représentatif que l’était celui du tsar.
Clemenceau : Cette reconnaissance présenterait ici des dangers réels. » « 28 juin 1919 (dernière réunion du Conseil des Quatre)
Président Wilson : Je ferai observer que nos délibérations ont eu le caractère de conversations privées.
Clemenceau : Assurément, publier ces comptes-rendus serait tout ce qu’il pourrait y avoir de plus dangereux.
Président Wilson : (...) Si j’avais pensé que cette question se poserait, je n’aurai jamais consenti à ce qu’on prît des notes. »
« Les délibérations du Conseil des Quatre »
Compte-rendu officiel des chefs d’Etat des grandes puissances
(Wilson président des Etats-Unis, Lloyd George chef du gouvernement anglais, Clemenceau chef du gouvernement français, Orlando chef du gouvernement italien, Paderewski chef du gouvernement polonais, Montagu secrétaire d’Etat pour l’Inde)
Edition du CNRS 1955




Messages
1. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 28 décembre 2011, 06:50, par MOSHE
« Croire que la révolution socialiste soit concevable sans explosions révolutionnaire d’une partie de la petite bourgeoisie avec tous ses préjugés, sans mouvement des masses prolétariennes et semi-prolétariennes politiquement inconscientes, contre le joug seigneurial, clérical, monarchiste, national, etc…, c’est répudier la révolution sociale. C’est s’imaginer qu’une armée prendra position en un lieu donné et dira : « Nous sommes pour le socialisme » et qu’une autre, en un autre lieu, dira : « Nous sommes pour l’impérialisme », et que ce sera alors la révolution sociale ! C’est seulement en procédant de ce point de vue pédantesque et ridicule qu’on pouvait qualifier injurieusement de « putsch » l’insurrection irlandaise. Quiconque attend une révolution sociale « pure » ne vivra jamais assez longtemps pour la voir. (…) La Révolution russe de 1905 a été une révolution démocratique bourgeoise Elle a consisté en une série de batailles livrées par toutes les classes, groupes et éléments mécontents de la population. (…) Objectivement, le mouvement des masses ébranlait le tsarisme et frayait la voie à la démocratie, et c’est pourquoi les ouvriers conscients étaient à la tête. La révolution socialiste en Europe ne peut pas être autre chose que l’explosion de la lutte des opprimés et mécontents de toute espèce. Des éléments de la petite bourgeoisie et des ouvriers arriérés y participeront inévitablement – sans cette participation, la lutte de masse n’est pas possible, aucune révolution n’est possible – et, tout aussi inévitablement, ils apporteront au mouvement leurs préjugés, leurs fantaisies réactionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs. Mais, objectivement, ils s’attaqueront au capital. »
Léon Trotsky
2. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 28 décembre 2011, 10:52, par F. Kletz
La Révolution russe de 1905 a été une révolution démocratique bourgeoise
Elle a consisté en une série de batailles livrées par toutes les classes, groupes et éléments mécontents de la population. (…)
Objectivement, le mouvement des masses ébranlait le tsarisme et frayait la voie à la démocratie, et c’est pourquoi les ouvriers conscients étaient à la tête.
La révolution socialiste en Europe ne peut pas être autre chose que l’explosion de la lutte des opprimés et mécontents de toute espèce.
Des éléments de la petite bourgeoisie et des ouvriers arriérés y participeront inévitablement – sans cette participation, la lutte de masse n’est pas possible, aucune révolution n’est possible – et, tout aussi inévitablement,
ils apporteront au mouvement leurs préjugés, leurs fantaisies réactionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs. Mais, objectivement, ils s’attaqueront au capital. »
3. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 11 novembre 2012, 08:57
Le Conseil des quatre grandes puissances à Paris le 26 mars 1919 :
– Lloyd George : Si les dirigeants allemands arrivent à la conclusion que ce qu’ils ont de mieux à faire est d’imiter la Hongrie et de faire alliance avec les Bolcheviks, s’ils préfèrent le risque d’une anarchie de quelques années à une servitude de trente-cinq ans que ferons-nous ? (...) Si nous avions à occuper un pays très peuplé, comme la Westphalie, tandis que l’Allemagne autour de nous se relèverait ou serait agitée par un bolchevisme contagieux, quels ne seraient pas nos dépenses et nos risques ? (...) Ma conviction est que les Allemands ne signeront pas les propositions qu’on envisage (...) L’Allemagne passera au Bolchevisme. (...)
– Président Wilson : Je ne puis qu’exprimer mon admiration pour l’esprit qui se manifeste dans les paroles de M.Lloyd George. Il n’y a rien de plus honorable que d’être chassé du pouvoir parce qu’on a eu raison. (...) le gouvernement de Weimar est sans crédit. S’il ne peut rester au pouvoir, il sera remplacé par un gouvernement tel qu’il sera impossible de traiter avec lui. (...) Nous devons à la paix du monde de ne pas donner à l’Allemagne la tentation de se jeter dans le Bolchevisme, nous ne savons que trop les relations des chefs bolcheviks avec l’Allemagne.
– Clemenceau : J’approuve fondamentalement M.Lloyd George et M. Wilson, mais je ne crois pas qu’il y ait désaccord entre eux et M.Loucheur qui, en homme d’affaires expérimenté, se garderait bien de rien faire qui pût tuer la poule aux œufs d’or. (...) Nous avons raison de craindre le bolchevisme chez l’ennemi (les pays vaincus) et d’éviter d’en provoquer le développement, mais il ne faudrait pas le répandre chez nous-mêmes. (...) soit en France soit en Angleterre. Il est bien de vouloir ménager les vaincus, mais il ne faudrait pas perdre de vue les vainqueurs. Si un mouvement révolutionnaire devait se produire quelque part, parce que nos solutions paraîtraient injustes, que ce ne soit pas chez nous.
– Lloyd George : (...) Je sais quelque chose du danger bolcheviste dans nos pays ; je le combat moi-même depuis plusieurs semaines (...) Le résultat, c’est que des syndicalistes comme Smilie, le secrétaire général des mineurs, qui auraient pu devenir un danger formidable, finissent par nous aider à éviter un conflit. Les capitalistes anglais –dieu merci ! – ont peur, et cela les rend raisonnables. Mais en ce qui concerne les conditions de paix, ce qui pourrait provoquer une explosion du bolchevisme en Angleterre, ce ne serait pas le reproche d’avoir demandé trop peu à l’ennemi, mais celui de lui avoir demandé trop. L’ouvrier anglais ne veut pas accabler le peuple allemand par des exigences excessives. (...) De toutes manières, nous allons imposer à l’Allemagne une paix très dure : elle n’aura plus de colonies, plus de flotte, elle perdra 6 ou 7 millions d’habitants, une grande partie de ses richesses naturelles : presque tout son fer, une grande partie de son charbon. Militairement, nous la réduisons à l’état de la Grèce, et au point de vue naval, à celui de la République Argentine. Et sur tous ces points nous sommes entièrement d’accord. (...) Si vous ajoutez à cela des conditions secondaires qui puissent être considérées comme injustes, ce sera peut-être la goutte d’eau qui fera déborder le vase. »
Le 27 mars 1919
– Président Wilson : Je ne crains pas dans l’avenir les guerres préparées par les complots secrets des gouvernements mais plutôt les conflits créés par le mécontentement des populations. (...)
– Maréchal Foch : Pour arrêter l’infiltration bolcheviste il faut créer une barrière en Pologne et en Roumanie, fermant la brèche de Lemberg, et assainir les points de l’arrière qui peuvent être infectés, comme la Hongrie, en assurant le maintien des communications par Vienne. En ce qui concerne particulièrement la Roumanie, les mesures nécessaires sont prévues en détail pour envoyer à son armée les effets et équipements qui lui manquent. Cette armée sera placée sous le commandement d’un général français. Vienne sera occupée par des troupes alliées sous un commandement américain. (...) Nous sommes d’accord sur l’aide à donner à l’armée roumaine et sur l’évacuation d’Odessa, qui est liée à notre actions en Roumanie. (...) Quant à l’idée d’opérer la jonction entre les forces polonaises et roumaines pour faire face à l’est, c’est le prélude d’une marche vers et cela nous conduit à la question d’une intervention militaire en Russie. Nous avons examiné cette question plus d’une fois et nous sommes chaque fois arrivés à la conclusion qu’il ne fallait pas penser à une intervention militaire. (...) L’évacuation d’Odessa est considérée comme le moyen de reporter des ressources, dont l’emploi à Odessa ne pouvait conduire à aucun résultat satisfaisant, sur la Roumanie pour compléter ses moyens de défense. (...)
– Maréchal Foch (chef des armées alliées) : Pour arrêter l’infiltration bolcheviste il faut créer une barrière en Pologne et en Roumanie, fermant la brèche de Lemberg, et assainir les points de l’arrière qui peuvent être infectés, comme la Hongrie, en assurant le maintien des communications par Vienne. (...) Contre une maladie épidémique, on fait un cordon sanitaire : on place un douanier tous les deux cent mètres et on empêche les gens de passer.
4. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 11 novembre 2012, 09:01
Les réunions à Paris des chefs des grands banditismes mondiaux avaient commencé ainsi :
Le 24 mars 1919
– Président Wilson (USA) : C’est en ce moment une véritable course contre la montre entre la paix et l’anarchie et le public commence à manifester son impatience. (...)
– Lloyd George (GB) : (...) Je propose donc, avec la Président Wilson, que nous nous réunissions entre chefs de gouvernements, deux fois par jour s’il le faut, pour aller plus vire, et que nous commencions dès demain. »
Le 25 mars 1919
– Général Alby : La question du ravitaillement d’Odessa est posé par une série de télégrammes des généraux Berthelot et Franchet d’Espérey (...) nous oblige à trouver le moyen de nourrir, à Odessa et autour de cette ville, un million de personnes. Si nous ne pouvons pas le faire, il est inutile de songer à garder Odessa.
– En réponse à une question posée par M. Lloyd George sur les effectifs alliés à Odessa, le général Alby répond qu’ils s’élèvent à environ 25.000 hommes.
– Clemenceau (France) : Ce matin même, le général d’Espérey a demandé qu’on lui envoie pour Odessa des troupes polonaises d’Italie. (...)
– Général Alby : L’Italie est disposée à envoyer 7.000 Polonais (...) Les autorités russes d’Odessa demandent qu’on leur fournisse du pain à raison de 1.000 tonnes par semaine, (...) 15.000 tonnes de charbon par mois sont absolument nécessaires, sans quoi le danger d’une révolte de la population serait très grand. (...)
– Président Wilson : Je suis frappé, dans des dépêches qu’on nous a lues, de ces mots : « La population d’Odessa nous est hostile ». S’il en est ainsi, on peut se demander à quoi sert de garder cet îlot entouré, presque submergé par le bolchevisme. (...) Cela me confirme dans ma politique, qui est de laisser la Russie aux Bolcheviks – ils cuiront dans leur jus jusqu’à ce que les circonstances aient rendu les Russes plus sages - et de nous borner à empêcher le bolchevisme d’envahir d’autres parties de l’Europe.
– Lloyd George : J’ai entendu tout récemment M.Bratiano qui considère que ce qu’il y a de plus important à faire en Roumanie : 1° de nourrir la population 2° d’équiper l’armée 3° de donner la terre aux paysans. Ce sont des moyens intelligents et efficaces de préserver la Roumanie du bolchevisme. Mais devons-nous nous obstiner à garder Odessa, dont la population se soulèvera dès que les Bolcheviks feront leur apparition ? Il vaut mieux concentrer tous nos moyens de défense en Roumanie et établir là notre barrière contre le bolchevisme. (...) La population sibérienne est-elle favorable à Koltchak ou non ?
– Général Thwaites : Koltchak paraît soutenu par la population ; mais un mouvement de mécontentement et une tendance au bolchevisme se produisent dans la région occupée par les Japonais.
– Lloyd George : Si Odessa tombe, qu’arrivera-t-il ?
– Général Thwaites : Les Bolcheviks attaqueront immédiatement la Roumanie.
– Colonel Kish : (...) L’occupation d’Odessa par les Bolcheviks donnera en Russie l’impression d’une grande victoire remportée par eux sur les Alliés. L’événement serait donc important du point de vue moral. Mais c’est la seule raison sérieuse que nous ayons de garder Odessa. (...)
– Clemenceau : Le péril bolcheviste s’étend en ce moment vers le sud et vers la Hongrie ; il continuera à s’étendre tant qu’il ne sera pas arrêté ; il faut l’arrêter à Odessa et à Lemberg. (...)
– Maréchal Foch : Abandonner Odessa, c’est abandonner la Russie du sud, mais à vrai dire elle est déjà perdue et nous ne la perdrons pas une seconde fois..
– Clemenceau : je demanderai au Maréchal Foch s’il a un nom à nous fournir pour le général qui prendrait le commandement de l’armée roumaine. »
5. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 11 novembre 2012, 09:11
28 juin 1919 (dernière réunion du Conseil des Quatre)
– Président Wilson : Je ferai observer que nos délibérations ont eu le caractère de conversations privées.
– Clemenceau : Assurément, publier ces comptes-rendus serait tout ce qu’il pourrait y avoir de plus dangereux.
– Président Wilson : (...) Si j’avais pensé que cette question se poserait, je n’aurai jamais consenti à ce qu’on prît des notes.
6. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 11 novembre 2012, 18:32
Le 10 juin 1919
– Président Wilson : Nous vous avons convoqués, Messieurs, parce que nous sommes très préoccupés de la situation militaire en Hongrie et autour de la Hongrie. (...) Cette seconde offensive (roumaine) a eu comme conséquence la chute de Karolyi, dont l’attitude envers l’Entente était plus amicale que celle d’aucun autre homme d’Etat hongrois. C’est alors que Bela Kun s’empara du pouvoir. Son gouvernement n’était pas de nature à être accepté par les classes les plus établies de la population. Mais quand les Tchèques, à leur tour, attaquèrent le territoire hongrois. On nous rapporte que les officiers de l’ancienne armée hongroise eux-mêmes vinrent se ranger autour du gouvernement de Bela Kun. Celui-ci donc arrivé au pouvoir en conséquence de l’offensive roumaine y a été consolidé par l’offensive tchèque. Rien ne peut être plus fatal à notre politique. (...) Nous devons éviter de créer nous-mêmes le bolchevisme en donnant aux populations des pays ennemis de justes raisons de mécontentement.
Le 12 juin 1919
– Lloyd George : En réponse à l’amiral Koltchak, nous ne pouvons faire plus que lui promettre notre appui. Il est impossible de reconnaître son gouvernement comme celui de toute la Russie. (...)
– Orlando : Il y a en Italie une grève qui me préoccupe (...)
– Lloyd George : J’ai eu quelques renseignements sur ce qui s’est passé à Rome pendant la visite de Ramsay MacDonald. Les socialistes italiens étaient d’avis de faire un coup, d’accord avec les groupes ouvriers de France et d’Angleterre. (...)
– Orlando : L’agitation qui a lieu en Italie en ce moment est surtout dirigée contre la hausse des prix. Il y a eu quelques incidents sérieux à La Spezia : une personne a été tuée et deux blessées.
– Lloyd George : Cette question des prix me préoccupe beaucoup et je crois que nous devrons bientôt faire un effort pour la résoudre en commun. A mon avis, il faudra établir un système d’achats interalliés.. Autrement nous courrons à une révolution dans toute l’Europe.
Le 13 juin 1919
– Lloyd George : Les moyens militaires à employer si les Allemands refusent de signer (la paix) ont été étudiés. Mais, à mon avis, le meilleur moyen d’obtenir la signature, c’est d’annoncer dès maintenant que nous nous préparons, en cas de refus, à reprendre le blocus. (...) Ce que je veux, c’est hâter la conclusion de la paix. Si la paix ne vient pas promptement, je crains un chaos qui serait bien pire que tout ce qu’ont pu faire des années de blocus (...) J’ai peur de trouver à Berlin un autre Moscou (...)
– Président Wilson : La famine a produit ailleurs le chaos et je crains qu’elle ne le produise aussi en Allemagne.
– Clemenceau : Lloyd George n’a pas envie d’aller à Berlin, moi non plus…
Le 17 juin 1919
– Lloyd George : Le Conseil économique nous demande s’il n’y a pas lieu de lever le blocus de la Russie bolcheviste et de la Hongrie dès la signature du traité avec l’Allemagne. La question, en réalité, se borne à savoir si les allemands seront les seuls à avoir le droit de commercer avec la Russie. (...) Si je croyais que nous puissions écraser les Bolcheviks cette année, je serai d’avis de faire un grand effort auquel participeraient les flottes anglaise et française. Mais l’amiral Koltchak vient d’être repoussé à trois cent kilomètres en arrière. Une des ses armées est détruite. (...) Pour moi, l’amiral Koltchak ne battra pas Lénine. Il arrivera plutôt un moment où les adversaires se rapprocheront pour mettre fin à l’anarchie. Il semble que les affaires militaires des Bolcheviks soient bien conduites. Mais les observateurs qui nous renseignent disent que la pure doctrine bolcheviste est de plus en plus abandonnée et que ce qui se constitue là-bas, c’est un Etat qui ne diffère pas sensiblement d’un Etat bourgeois.
– Clemenceau : Etes-vous sûr du fait ?
– Président Wilson : Il est peut-être encore trop tôt pour le croire. (...)
– Clemenceau : Il faut, en tout cas, tenir l’engagement que nous venons de prendre vis-à-vis de l’amiral Koltchak.
– Lloyd George : Certainement. (...)
– Président Wilson : Nous ne nous sommes engagés d’ailleurs qu’à l’aider en lui fournissant du matériel. (...) La question est celle-ci : sommes-nous en guerre avec la Russie bolcheviste ?
– Lloyd George : Des troupes britanniques sont à Arkhangel. (...)
– Président Wilson : Je vous signale que le Conseil interallié des transports maritimes a donné hier l’ordre d’arrêter les navires chargés de vivres à destination des ports de la Baltique (...) Je rappelle que j’ai beaucoup insisté pour que nous commencions par l’action militaire et que nous n’ayons recours au blocus qu’en dernier lieu. (...) Je ne suis pas d’avis de réduire à la famine la population d’un grand pays, sauf si c’est le dernier moyen d’action qui nous reste (...) »
7. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 11 novembre 2012, 18:51
« 22 avril 1919
– Lloyd George : J’ai peur d’une crise que nous ne puissions plus maîtriser (...) Notre pauvre Europe est comme un terrain semé de grenades ; si on y met le pied, tout saute. »
« 23 avril 1919
– Président Wilson : Il n’est pas possible de faire quoi que ce soit dans ce pays (l’Allemagne) avant que la population ait les vivres et les moyens de travail indispensables. La disette, au sens le plus général du mot, est le terrain sur lequel croît le bolchevisme. (...) Je ne peux pas consentir à donner à donner à l’Italie ce qui serait la cause d’une séparation dangereuse entre le monde slave et l’Europe occidentale. Nous sommes devant une alternative : ou nous attirerons les slaves du sud vers l’Europe occidentale et vers la Société des Nations, ou nous les rejetterons vers la Russie et le bolchevisme. »
« 24 avril 1919
– Président Wilson : Dans les villes (allemandes) il y a du bolchevisme. »
« 29 avril 1919
– Vandervelde : Nous avons, à l’heure présente, 800.000 chômeurs survivent avec une allocation de 777 à 14 francs par semaine. La vie, en Belgique, est trois fois plus chère qu’en 1914. Cependant l’ordre et le calme n’ont cessé d’y régner. Ce qui les a maintenus, c’est d’abord l’organisation très forte de notre parti ouvrier dont je suis fier de dire qu’elle est la plus puissante garantie d’ordre qui existe dans notre pays (...). Je ne suis pas suspect de vues extrêmes (...) Dans le discours que j’ai prononcé en séance plénière sur les conditions de travail, j’ai dit que les ouvriers belges, ayant à choisir entre la méthode anglaise et la méthode russe, avaient choisi la méthode anglaise. Mr Lloyd George m’a dit qu’il était fier de voir que les ouvriers belges reconnaissaient l’excellence de la méthode britannique. Mais pour que cela dure, il est indispensable que vous nous aidiez : il y va de l’avenir de nos travailleurs et de notre pays même. »
« 30 avril 1919
– Lloyd George : Pour l’emploi du temps, il a été proposé d’étudier la semaine prochaine les questions relatives à la paix en Autriche. (...)
– Ce qui me rallie à la proposition de M. Lloyd George, c’est l’effet moral que la convocation aura en Autriche. Les dépêches que nous recevons de Vienne indiquent l’urgence de soutenir le gouvernement actuel. La disette, le sentiment que la paix n’est pas en vue, créent un état d’esprit dangereux (...)
– Lloyd George : Je propose d’entendre M. Tchaïkovsky le chef du gouvernement d’Arkhangel (...) Les renseignements que nous recevons indiquent que Koltchak avance et pourra sans doute rejoindre Arkhangel (...) et, d’autre part, que le gouvernement de Lénine est encore puissant, mais incline peu à peu vers une politique plus modérée.
– Clemenceau : Nos informations tendent à montrer que la puissance des Bolcheviks décline.
– Lloyd George : Ici nos informations diffèrent. (...)
– Président Wilson : Un des éléments qui troublent la paix du monde est la persécution des Juifs. Vous savez qu’ils sont particulièrement mal traités en Pologne et qu’ils sont privés des droits de citoyen en Roumanie. (...) Rappelez-vous que, quand les Juifs étaient traités en hors la loi en Angleterre, ils agissaient comme des gens hors la loi. Notre désir est de les ramener partout dans la loi commune. (...) (Suite le 3 mai) Nos gouvernements, du moins les gouvernements britannique et américain, ont pris, vis-à-vis des Juifs, l’engagement d’établir en Palestine quelque chose qui ressemble à un Etat israélite, et les Arabes y sont très opposés.
– (Suite le 17 mai) Ce n’est pas seulement un sentiment de bienveillance à l’égard des Juifs, mais par l’incertitude du danger que le traitement injuste des Juifs crée dans différentes parties de l’Europe. Le rôle des Juifs dans le mouvement bolcheviste est dû sans aucun doute à l’oppression que leur race a subi pendant si longtemps. Les persécutions empêchent le sentiment patriotique de naître et provoquent l’esprit de révolte. A moins que nous ne portions remède à la situation des Juifs, elle restera un danger pour le monde.
– (Suite 6 juin) France, Italie, Grande Bretagne, Etats-Unis, ce n’est pas sur leurs territoires que l’on trouve cet élément juif qui peut devenir un danger pour la paix en Europe, mais en Russie, en Roumanie, en Pologne, partout où les Juifs sont persécutés.
– Lloyd George : Cette difficulté subsistera jusqu’à ce que les Polonais deviennent assez intelligents pour savoir tirer parti de leurs Juifs, comme le font les Allemands.
– (Suite 23 juin) Président Wilson Le plus important est d’apaiser les inquiétudes des Juifs. Je crains toujours de laisser subsister de ce côté un ferment dangereux. »
« 2 mai 1919
– Lloyd George : On me fait savoir que, dans plusieurs villes d’Italie, des soldats anglais ont été insultés dans les rues. (...)
– Président Wilson : En jetant un cristal dans un liquide, on le fait parfois cristalliser tout entier.
– Lloyd George : Quelquefois aussi, on provoque une explosion.
– Président Wilson : L’explosion s’est déjà produite. (...) l’attitude de l’Italie est indubitablement agressive. (...) »
« 7 mai 1919
– Lloyd George : Je voudrai vous parler de la Russie La situation s’y transforme de la façon la plus remarquable : nous assistons à un véritable effondrement du bolchevisme, à tel point que le cabinet britannique sollicite de nous une décision immédiate sur notre politique en Russie. D’après nos renseignements, Koltchak est sur le point de joindre ses forces à celles d’Arkhangel ; il est possible aussi qu’il arrive à bref délai à Moscou et y établisse un nouveau gouvernement. (...)
– Président Wilson : Que fournissez-vous à Koltchak et à Dénikine ?
– Lloyd George : Des armes et des munitions. »
« 8 mai 1919
– Président Wilson : Rien n’a été décidé sur les frontières de la Russie ou celles qu’il a lieu d’établir à l’intérieur de l’ancien empire russe. »
« 9 mai 1919
– Président Wilson : Quand nous essayâmes pour la première fois d’envoyer des vivres aux populations russes (...) des troupes américaines ont assuré la police du chemin de fer entre le Pacifique et Irkoutsk. Notre gouvernement n’a pas confiance dans l’amiral Koltchak qui est soutenu par la France et l’Angleterre. (...) Dans ces conditions, nous devons ou prendre le parti de soutenir Koltchak et de renforcer notre armée d’occupation, ou nous retirer totalement. Mais si nous augmentons nos effectifs, le Japon fera de même. Quand nous sommes allés en Sibérie, nous nous étions entendus avec le Japon pour envoyer là-bas des forces équivalentes. En fait, nous avons envoyé 9000 hommes et le japon 12000. Mais, peu à peu, il a augmenté ses effectifs et les a porté à 70.000 hommes. (...) Si, d’autre part, nous renforçons les troupes qui gardent le chemin de fer, je crains une coalition entre les Cosaques et les Japonais contre nous. Pour moi j’ai toujours été d’avis de nous retirer de Russie (...)
– Lloyd George : (...) Il devient nécessaire de nous entendre sur une politique commune en Russie. D’après nos renseignements, l’amiral Koltchak avance rapidement à l’ouest de l’Oural et cela semble démontrer que les Bolcheviks n’ont plus la force de résister, ou que les moyens de transport leur manquent complètement. Quelles sont les dernières nouvelles ?
– Sir Maurice Hankey : Les derniers télégrammes montrent que l’amiral Koltchak envoie des forces à la fois dans la direction d’Arkhangel et vers le sud-ouest.
– Président Wilson : Nous avons certainement le droit de demander à Koltchak quelles sont ses intentions.
– Lloyd George : D’abord sur la question agraire, il faut lui demander s’il est bien résolu à ne pas reprendre la terre aux paysans.
– Président Wilson : D’après les informations que j’ai reçues d’un homme qui connaît très bien la Russie et sa situation présente, les paysans se sont emparés de la terre irrégulièrement et au hasard. (...)
– Lloyd George : Il faut se résigner à des irrégularité de ce genre dans une révolution : le fait s’est produit lors de la révolution française. (...)
– Lloyd George : Si l’amiral Koltchak peut nous rejoindre, c’est la fin du bolchevisme. ( ..)
– Président Wilson : Les troupes américaines d’Arkhangel ne sont pas bien sures. (...) Il est toujours dangereux de se mêler de révolutions étrangères. (...)
– Lloyd George : Ici ce sont des Russes qui agissent et nous ne ferons que les seconder. (...)
– Lord Robert Cecil : Le grand problème que nous avons à résoudre est de remettre l’Europe au travail. Partout, le chômage se développe, surtout dans les Etats nouveaux. Se borner à nourrir cette population de chômeurs serait presque sans effet au point de vue politique : s’ils sont nourris et sans travail, ils seront encore plus disposés à se révolter que dans la plus extrême détresse. (...) Ce qui est certain, c’est que si rien n’est fait, nous nous trouverons en présence du chaos et de l’anarchie. »
« 10 mai 1919
– Président Wilson : Une intransigeance de notre part aurait pour résultat une révolution en Pologne. et, pour commencer, la chute de son gouvernement. (...)
– Lloyd George : J’ai reçu ce matin un autre rapport qui me dit qu’à mesure que Koltchak avance, il se produit des désordres derrière lui. Les Bolcheviks ont quelques succès en Sibérie orientale. Cela ne veut-il pas dire que l’on croit que si Koltchak réussissait, le but final de son entourage serait le retour au passé ? Ne croit-on pas que c’est à cela que les Alliés veulent l’aider ? (...) »
« 17 mai 1919
– Maharadjah de Bikaner : Nous ne pouvons que déconseiller de la manière la plus formelle tout partage de la Turquie (...) C’est avec tout le sentiment de ma responsabilité que j’appelle votre attention sur le danger de désordre et de haine que cette question contient, non seulement pour l’Inde mais pour le monde entier.
– Montagu : Il y a un danger véritable chez les peuples musulmans. (...) Un Américain qui avait été prisonnier des Bolcheviks à Tachkent (...) a été frappé par l’attitude des Musulmans à l’égard des Alliés : le sentiment parmi eux était que la Conférence prenait position contre l’Islam. Je n’ai pas besoin de rappeler les événements récents qui se sont produits en Egypte et dans l’Afghanistan. Dans le Pendjab, des agitateurs hindous, excités par les Bolcheviks, provoquaient les populations à la révolte. (...) Il est sans exemple que l’on ait ainsi ouvert les mosquées à des prédicateurs ou à des orateurs qui n’appartenaient pas eux-mêmes à la religion musulmane. »
« 19 mai 1919
– Président Wilson : La situation à Varsovie est certainement dangereuse. L’opinion est très montée et aux excitations nationalistes se mêlent des menaces de grève générale des postes et des chemins de fer. (...) Paderewski nous avertit qu’une intransigeance complète de notre part aurait pour résultat une révolution en Pologne et, pour commencer, la chute de son gouvernement. (...) Le seul moyen de régler la question hongroise est une intervention militaire. Il n’y aurait pas de résistance. (...) On nous conseille d’envoyer à Budapest une mission politique ayant à sa tête un homme comme le général Smuts pour assurer l’établissement d’un gouvernement stable. (...)
– Lloyd George : Nous sommes au milieu des sables mouvants. (...) Avez-vous vu le télégramme de Lénine qui accuse les troupes de Denikine d’atrocités. J’ai bien peur qu’en fait les atrocités n’aient lieu des deux côtés. Que penser des victoires de Koltchak ? (...)
– Président Wilson : Même incertitude au sujet de la Hongrie. Nous recevons des rapports sur l’impopularité de la dictature du prolétariat. (...) La conclusion de mon représentant est que le seul moyen de régler la question hongroise est une intervention militaire. (...)
– Clemenceau : Il me paraît bien difficile d’occuper Budapest. Que nous demandera-t-on d’occuper ensuite ? Ce n’est pas la première fois qu’on nous invite à occuper telle ou telle partie de l’Europe. (...)
– Président Wilson : J’ai donné au Département d’Etat l’instruction d’entrer directement en communication avec l’amiral Koltchak et de lui poser un certain nombre de questions, notamment sur ses intentions en ce qui concerne l’Assemblée Constituante et le régime agraire.
« 20 mai 1919
– Lord Robert Cecil : Lénine ne veut pas accepter la condition de suspension des hostilités. Après consultation avec le Conseil suprême économique, je conseille aux gouvernements de choisir entre deux politiques : il faut ou écraser les Bolcheviks ou imposer aux différents groupes belligérants de la Russie (...) qu’une Constituante soit immédiatement convoquée. En tout cas, il ne faut pas essayer de mêler les deux systèmes. (...)
– Clemenceau : Si nous cessons d’envoyer des armes à Koltchak et à Denikine, ce n’est pas cela qui arrêtera Lénine. (...)
– Lloyd George : D’un côté, nous avons des révolutionnaires violents et sans scrupules, de l’autre des gens qui prétendent agir dans l’intérêt de l’ordre, mais dont les intentions nous sont suspectes. Toutefois, nous avons le devoir de ne pas abandonner ceux dont nous avons eu besoin (...)
– Lloyd George : Nous aurons aussi à examiner la question des provinces baltiques. (. ;) Comment faire fond sur ces populations ? Nous avons à un moment donné cherché à leur distribuer des armes pour combattre contre les Bolcheviks, mais nous y avons renoncé, parce que nous trouvions trop peu de gens en qui on pût avoir confiance. »
« 21 mai 1919
– Lloyd George : Le monde musulman s’agite, vous savez nos difficultés en Egypte, l’Afghanistan est en état de guerre avec nous. Pendant la guerre nous avons levé dans les Indes plus d’un million d’hommes, presque tous musulmans, ce sont eux qui ont supporté presque tout le poids de la lutte contre la Turquie, quoique encadrés par des troupes blanches. Le monde musulman n’oublie pas cela. La division de la partie proprement turque de l’Asie Mineure serait injuste et impolitique (...)
– Général Le Rond : Les Ukrainiens n’ont que médiocrement résisté aux Bolchevistes. (...) Les Polonais sont beaucoup plus capables qu’eux d’arrêter la marche en avant du bolchevisme.
– Général Botha : Les Polonais, avec des munitions qu’ils reçoivent de nous, attaquent des gens qui ne sont pas nos ennemis (Ukraine). S’ils ont besoin de ce que nous leur donnons pour combattre les Bolchevistes, nous sommes prêts à continuer à le leur donner. (...) Si nous tolérons ce que la Pologne fait aujourd’hui, nous jetterons nous-mêmes le peuple ukrainien dans les bras des Bolcheviks.
– Président Wilson : Si Paderewski tombe et que nous coupions les vivres à la Pologne, la Pologne elle-même ne deviendra-t-elle pas bolcheviste ? Le gouvernement de Paderewski est comme une digue contre le désordre, et peut-être la seule possible.
– Lloyd George : Les Polonais estiment que le moyen de combattre les Bolchevistes n’est pas de s’unir avec les Ukrainiens contre eux, mais de supprimer les Ukrainiens. Quarante millions d’Ukrainiens, s’ils sont foulés aux pieds, se soulèveraient contre nous et pourraient créer un nouveau bolchevisme quand l’ancien se serait effondré. »
8. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 13 octobre 2013, 19:29, par Robert Paris
Lénine dans « La maladie infantile du communisme » :
« Pendant les premiers mois qui suivirent la conquête du pouvoir politique par le prolétariat en Russie (25 octobre - 7 novembre 1917), il pouvait sembler que les différences très marquées entre ce pays arriéré et les pays avancés d’Europe occidentale y rendraient la révolution du prolétariat très différentes de la nôtre.
Aujourd’hui nous avons par devers nous une expérience internationale fort appréciable, qui atteste de toute évidence que certains traits essentiels de notre révolution n’ont pas une portée locale, ni particulièrement nationale, ni uniquement russe, mais bien internationale.
Et je ne parle pas ici de la portée internationale au sens large du mot : il ne s’agit pas de certains traits, mais tous les traits essentiels et aussi certains traits secondaires de notre révolution ont une portée internationale, en ce sens qu’elle exerce une action sur tous les pays. Non, c’est dans le sens le plus étroit du mot, c’est à dire en entendant par portée internationale la valeur internationale ou la répétition historique inévitable, à l’échelle internationale, de ce qui c’est passé chez nous, que certains traits essentiels ont cette portée.
Certes, on aurait grandement tort d’exagérer cette vérité, de l’entendre au-delà de certains traits essentiels de notre révolution. On aurait également tort de perdre de vue qu’après la victoire de la révolution prolétarienne, si même elle n’a lieu que dans un seul des pays avancés, il se produira, selon toute probabilité, un brusque changement, à savoir : la Russie redeviendra, bientôt après, un pays, non plus exemplaire, mais retardataire (au point de vue "soviétique" et socialiste).
Mais en ce moment de l’histoire, les choses se présentent ainsi : l’exemple russe montre à tous les pays quelque chose de tout à fait essentiel, de leur inévitable et prochain avenir. Les ouvriers avancés de tous les pays l’ont compris depuis longtemps, mais le plus souvent ils ne l’ont pas tant compris que pressenti avec leur instinct de classe révolutionnaire.
D’où la "portée" internationale (au sens étroit du mot) du pouvoir des Soviets, et aussi des principes de la théorie et de la tactique bolcheviques. Voilà ce que n’ont pas compris les chefs "révolutionnaires" de la II° Internationale, tels que Kautsky en Allemagne, Otto Bauer et Friedrich Adler en Autriche, qui, pour cette raison, se sont révélés des réactionnaires, les défenseurs du pire opportunisme et de la social-trahison. Au fait, la brochure anonyme intitulée la Révolution mondiale (Weltrevolution), parue à Vienne en 1919 ("Sozialistische Biicherei", Heft II ; Ignaz Brand), illustre avec une évidence particulière tout ce cheminement de la pensée, ou plus exactement tout cet abîme d’inconséquence, de pédantisme, de lâcheté et de trahison envers les intérêts de la classe ouvrière, le tout assorti de la "défense " de l’idée de "révolution mondiale". »
9. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 4 novembre 2013, 19:49
Trotsky en 1905 :
Par la tâche directe et immédiate qu’elle se donne, la révolution russe est proprement " bourgeoise ", car elle a pour but d’affranchir la société bourgeoise des entraves et des chaînes de l’absolutisme et de la propriété féodale. Mais la principale force motrice de cette révolution est constituée par le prolétariat, et voilà pourquoi, par sa méthode, la révolution est prolétarienne. Ce contraste a paru inacceptable, inconcevable à de nombreux pédants qui définissent le rôle historique du prolétariat au moyen de calculs statistiques ou par des analogies historiques superficielles. Pour eux, le chef providentiel de la révolution russe, ce doit être la démocratie bourgeoise, tandis que le prolétariat qui, en fait, a marché à la tête des événements pendant toute la période d’élan révolutionnaire, devrait accepter d’être tenu en lisières par une théorie mal fondée et pédantesque. Pour eux, l’histoire d’une nation capitaliste répète, avec des modifications plus ou moins importantes, l’histoire d’une autre. Ils n’aperçoivent pas le processus, unique de nos jours, du développement capitaliste mondial qui est le même pour tous les pays auxquels il s’étend et qui, par l’union de conditions locales avec les conditions générales, crée un amalgame social dont la nature ne peut être définie par la recherche de lieux communs historiques, mais seulement au moyen d’une analyse à base matérialiste...
Dans la révolution dont l’histoire fixera le début à l’année 1905, le prolétariat s’est mis en marche pour la première fois sous un étendard qui lui appartenait en propre, vers un but qui était bien à lui. Et, en même temps, il est hors de doute qu’aucune des anciennes révolutions n’a absorbé autant d’énergie populaire et n’a donné aussi peu de conquêtes positives que la révolution russe jusqu’à l’heure présente. Nous sommes loin de vouloir prophétiser, nous ne croyons pas pouvoir annoncer les événements qui se produiront dans les semaines ou les mois qui vont suivre. Mais, pour nous, une chose est claire : la victoire n’est possible que sur la voie indiquée, formulée en 1849 par Lassalle. De la lutte de classe à l’unité de la nation bourgeoise, il n’y a pas de retour. Le " manque de résultats " de la révolution russe montre seulement un aspect passager de son caractère social le plus profond. Dans cette révolution " bourgeoise " sans bourgeoisie révolutionnaire, le prolétariat, par la logique même des événements, est conduit à prendre l’hégémonie sur la classe paysanne et à lutter pour la conquête du pouvoir souverain. Le premier flot de la révolution russe s’est brisé contre la grossière incapacité politique du moujik qui, dans son village, dévastait le domaine du seigneur pour mettre la main sur ses terres et qui ensuite, revêtu de l’uniforme des casernes, fusillait les ouvriers. Tous les événements de cette révolution peuvent être considérés comme une série d’impitoyables leçons de choses, au moyen desquelles l’histoire inculque violemment au paysan la conscience du lien qui existe indéfectiblement entre ses besoins locaux et le problème central du pouvoir. C’est à l’école des conflits violents et des défaites cruelles que s’élaborent les premiers principes dont l’adoption déterminera la victoire révolutionnaire...
10. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 18 octobre 2015, 10:54
« L’exacerbation de la lutte de classe commencée déjà pendant la guerre, a amené la rupture du front impérialiste sur son secteur le plus vulnérable, en Russie. Ainsi, la Révolution d’Octobre accomplie par le prolétariat de Russie, qui renversa le régime bourgeois grâce à des conditions particulièrement favorables, a ouvert l’ère de la révolution prolétarienne universelle dont elle est le premier chaînon.
Les insurrections prolétariennes qui ont suivi et qui, après un succès passager, se sont terminées par la défaite du prolétariat (Finlande, Hongrie, Bavière) ou ont été arrêtées à mi-chemin par la trahison de la social-démocratie, ennemie active du communisme révolutionnaire (Autriche, Allemagne) ont été dans le développement de la Révolution internationale des étapes au cours desquelles se sont évanouies les illusions bourgeoises du prolétariat et se sont concentrées les forces de la révolution communiste.
Le seul fait de l’existence de l’Union soviétiste, centre organisateur du mouvement prolétarien universel, revêt donc une importance exceptionnelle. L’Union Soviétiste, par sa seule existence, est un coin enfoncé dans le système capitaliste, en maintenant sur la sixième partie du globe un régime opposé par principe au régime capitaliste. D’autre part, elle est le détachement le plus ferme du mouvement prolétarien, car la classe ouvrière y a à sa disposition tous les moyens et ressources.
Dans la révolution internationale en voie de développement, la social-démocratie avec les syndicats qu’elle dirige est devenue le facteur contre-révolutionnaire le plus important. Elle ne s’est pas bornée à trahir pendant la guerre les intérêts des ouvriers en soutenant dans chaque pays « son » gouvernement impérialiste (social-patriotisme, social-chauvinisme) ; elle a défendu les traités de rapines (Brest-Litovsk, Versailles) ; elle a été une force active aux côtés des généraux pendant la répression sanglante des insurrections prolétariennes (Noske) ; elle a combattu par les armes la première République prolétarienne (Russie) ; elle a vendu le prolétariat arrivé au pouvoir (Hongrie) ; elle est entrée dans l’association de brigandage qui a nom « la Société des Nations » (Thomas). Elle s’est rangée ouvertement du côté des maîtres contre les esclaves coloniaux (le Labour Party anglais). L’aile pacifiste de la social-démocratie (centre) a démoralisé la classe ouvrière par toutes sortes d’illusions pacifistes et par sa propagande de non-résistance par quoi elle a donné au capital, principalement dans les moments critiques de la révolution, la meilleure des armes. Ainsi donc, la social-démocratie est la dernière réserve de la société bourgeoise, son plus ferme rempart. Au même titre que la social-démocratie par l’intermédiaire et au moyen de laquelle la bourgeoisie réprime les ouvriers ou endort leur vigilance, le fascisme est une autre forme d’exploitation du mécontentement des masses, orientant ce mécontentement dans la voie contre- révolutionnaire. Ces deux méthodes, inconnues du capitalisme « normal », manifestent la crise générale du capitalisme et, en même temps, entravent la marche de la Révolution. »
Boukharine, Projet de programme de l’Internationale Communiste, 1924
11. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 6 novembre 2016, 08:55, par R.P.
Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?
Retenons d’abord et avant tout qu’elle a échoué parce que la social-démocratie a préféré pactiser avec la réaction militaire et avec le fascisme, comme avec les Etats impérialistes, plutôt que de permettre au prolétariat de prendre le pouvoir or, à l’époque, la social-démocratie, qui incluait les syndicats, était de loin le plus grand parti ouvrier ce qui n’est plus le cas du tout.
12. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 13 janvier 2018, 06:59
En 1919, la bourgeoisie européenne était en plein désarroi ; c’était pour elle une époque de terreur panique, réellement folle, devant le bolchevisme qu’elle s’imaginait sous une forme vague et d’autant plus menaçante, et que les affiches, à Paris, montraient sous les traits d’un homme au couteau entre les dents. En réalité, la bourgeoisie européenne personnifiait dans le fantôme bolchevik au couteau la peur du châtiment pour les crimes commis par elle pendant la guerre. Elle savait, en tout cas, à quel point les résultats de la guerre ne répondaient pas aux promesses qu’elle avait faites. Elle connaissait exactement l’étendue des sacrifices en hommes et en biens. Elle craignait le règlement des comptes. L’année 1919 fut, sans aucun doute, l’année la plus critique pour la bourgeoisie. En 1920 et 1921, on voit son assurance lui revenir de plus en plus, et en même temps son appareil gouvernemental qui, immédiatement après la guerre dans certains pays, en Italie par exemple, s’est trouvé en pleine décomposition, se renforce sans aucun doute. L’aplomb de la bourgeoisie a pris sa forme la plus frappante en Italie après la lâche trahison du parti socialiste, au mois de septembre. La bourgeoisie croyait rencontrer sur son chemin des brigands menaçants et des assassins ; et elle s’est aperçue qu’elle n’avait devant elle que des poltrons... Une maladie m’ayant empêché, ces temps derniers, de m’adonner à un travail actif, j’ai eu la possibilité de lire en grand nombre les feuilles étrangères et j’ai amassé tout un dossier de coupures qui caractérisent clairement le changement de sentiments de la bourgeoisie et son appréciation nouvelle de la situation politique mondiale. Tous les témoignages se réduisent à un seul : le moral de la bourgeoisie est en ce moment, sans aucun doute, beaucoup meilleur qu’en 1919 et même qu’en 1920. Ainsi, par exemple, les correspondances publiées dans une feuille suisse sérieuse et nettement capitaliste, la Neue Züricher Zeitung, sur la situation politique en France, en Italie et en Allemagne, sont très intéressantes sous ce rapport. La Suisse, dépendant de ces pays, s’intéresse beaucoup à leur situation intérieure. Voici, par exemple, ce qu’écrivait ce journal au sujet des événements de mars en Allemagne :
« L’Allemagne de 1921 ne ressemble plus à celle de 1918. La conscience gouvernementale s’est raffermie partout, à ce point que les méthodes communistes rencontrent actuellement une vive résistance dans toutes les couches de la population, bien que la force des communistes, qui n’étaient représentés pendant la révolution que par un petit groupement d’hommes résolus, ait augmenté depuis de plus de dix fois ».
En avril, le même journal, à l’occasion des élections au parlement italien, peint la situation intérieure de l’Italie de la façon suivante :
« Année 1919 : la bourgeoisie est en désarroi, le bolchevisme attaque en rangs serrés. Année 1921 : le bolchevisme est battu et dispersé, la bourgeoisie attaque en rangs serrés ».
Un journal influent français, Le Temps, a écrit à l’occasion du 1er. Mai de cette année que pas une trace n’est restée de cette menace d’un coup d’état révolutionnaire qui avait empoisonné l’atmosphère en France au mois de mai de l’année passée, etc.
Ainsi le fait que la classe bourgeoise ait repris courage n’est pas douteux, comme n’est pas non plus douteux le renforcement de l’appareil policier des Etats après la guerre. Mais ce fait, tout important qu’il soit, ne résout nullement le problème, et nos ennemis en tout cas se pressent un peu trop d’en tirer des conclusions au sujet de la faillite de notre programme. Assurément, nous avons espéré que la bourgeoisie serait par terre en 1919. Mais il est évident que nous n’en étions pas sûrs, et que certainement ce n’est pas en vue de cette échéance précise que nous avons fondé notre plan d’action. Quand les théoriciens des Internationales 2 et 2 1/2 disent que nous avons fait faillite en ce qui concerne nos prophéties, on peut croire qu’il s’est agi de prédire un phénomène astronomique : que nous nous sommes trompés dans notre calcul mathématique, suivant lequel une éclipse aurait lieu à une certaine date, et il est apparu ainsi que nous étions de mauvais astronomes. Cependant, en réalité, il ne s’agit nullement de cela : nous n’avons pas prédit une éclipse de soleil, c’est-à-dire un phénomène en dehors de notre volonté et du champ de notre action. Il s’agissait d’un événement historique qui devait s’accomplir et qui s’accomplira avec notre participation. Lorsque nous parlions de la révolution qui devait résulter de la guerre mondiale, cela signifiait que nous tentions et que nous tentons encore d’exploiter les suites de cette guerre, afin d’accélérer l’avènement d’une révolution universelle. Si la révolution n’a pas eu lieu jusqu’à ce jour dans le monde entier ou du moins en Europe, cela ne signifie nullement que « l’I.C. ait fait faillite », son programme n’étant pas basé sur des dates astronomiques. Ceci est clair pour tout communiste qui a analysé tant soit peu son point de vue. Mais la révolution n’étant pas venue sur les traces chaudes de la guerre, il est tout à fait évident que la bourgeoisie a profité d’un moment de répit sinon pour réparer, du moins pour masquer les conséquences les plus terribles et les plus menaçantes de la guerre. Y a-t-elle réussi ? Elle y a réussi en partie. Dans quelle mesure ? C’est le fond même de la question qui touche le rétablissement de l’équilibre capitaliste.
Léon Trotsky, Nouvelle étape
13. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 25 janvier 2018, 04:10, par alain
Les bolcheviks n’avaient-ils pas surestimé la vague révolutionnaire en Europe pour miser exclusivement sur ce pari douteux ?
14. Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?, 25 janvier 2018, 04:10, par Robert Paris
A cette époque, le pouvoir capitaliste ne tenait qu’à un fil. Le premier ministre anglais Lloyd George écrivait dans un mémorandum à Clemenceau, chef d’Etat français :
« Toute l’Europe est remplie d’un esprit révolutionnaire. Il existe parmi les travailleurs un sentiment profond non seulement de mécontentement mais de colère et de révolte contre les conditions de l’avant-guerre. Tout l’ordre existant, dans ses aspects politiques, sociaux et économiques, est mis en question par la masse de la population d’un bout à l’autre de l’Europe. »
Un article du journal anglais « Times » du 19 juillet 1918 écrivait :
« L’esprit de désordre domine le monde entier. De l’Amérique à l’ouest jusqu’à la Chine, de la mer Noire à la mer Baltique, aucune société, aucune civilisation n’est assez assurée, aucune constitution assez démocratique, pour se dérober à son influence néfaste. Partout existent des signes montrant que les liens élémentaires de la société sont déchirés et décomposés par une longue fatigue. »